9 octobre2025

Collectif, La grande encyclopédie pour tout savoir sur les animaux, traduit de l’anglais par Élodie Porlier et Bruno Porlier, Paris, Éditions Gallimard Jeunesse, coll. Les yeux de la découverte, 2025, 272 pages, 44,95 $.
1,2 million d’espèces animales connues
et beaucoup d’autres
à découvrir
Les invertébrés, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères
vous intéressent ? Pour étancher votre soif de connaissances, je vous recommande La grande encyclopédie pour tout savoir
sur les animaux.
Avec plus de 1000 photographies,
cet ouvrage vous invite à observer des centaines d’animaux dans leur habitat. Chaque double page aborde une famille ou une espèce animale, d’une manière claire et structurée, pour bien connaître le nom
des animaux, leurs particularités (anatomie, comportement, reproduction, alimentation, etc.) et leurs interactions.
Après avoir parcouru quelques pages sur l’évolution et la classification des animaux, j’ai glané quelques renseignements dans chacune des sections, en commençant par les invertébrés. Ils constituent 97 % des espèces animales, et la plupart d’entre eux sont des insectes.
Symboles de poésie, les papillons ont surtout un rôle indispensable de pollinisa-teurs. Aussi fragiles soient-ils, leur rôle consiste à maintenir les habitats floraux et végétaux en bonne santé.
Comptant environ 37 000 espèces,
les poissons représentent la moitié des espèces de vertébrés. Parmi les adaptations qu’ils ont développées, certaines sont propres à la prédation, d’autres au camouflage, ou encore à la marche. Ils ont une mémoire à long terme qui peut durer plusieurs jours, semaines ou mois, selon
les espèces.
Les requins-marteaux peuvent compter jusqu’à 17 rangées de dents sur chacune
de leurs mâchoires. Un des plus grands poissons est le cavalo féroce qui peut atteindre 2 mètres de long.
Les crapauds et les grenouilles représentent près de 90 % des espèces d’amphibiens.
Les serpents comptent, dans leur colonne vertébrale, plus de vertèbres que tout autre animal vertébré sur Terre, ce qui confère à leur corps une souplesse sans pareille.
Si les tortues diffèrent par leur mode de vie, terrestre ou non, elles se caractérisent toutes par la présence de leur carapace, leur bec dur et leur peau écailleuse
Les oiseaux, premiers animaux volants à plumes, sont apparus il y a environ 160 millions d’années. De nos jours, ils occupent tous les continents et tous les milieux de
la planète. L’enjambée d’une autruche peut atteindre 4,88 m de long. Un condor peut absorber le sixième de son poids en un seul repas et parvenir encore à décoller !
Du rongeur à la chauve-souris,
de l’éléphant à la baleine, il existe plus de
6 600 espèces de mammifères. Il y a un peu plus de 10 000 ans, les hommes commencèrent à domestiquer des mammi-fères sauvages pour la production de lait et de viande, comme moyens de transport ou comme simples compagnons.
Le guépard, l’animal terrestre le plus rapide du monde, peut atteindre et dépasser 110 km/h en quelques secondes lorsque lancé derrière une proie. Quant aux grands singes, ils sont les plus intelligents et ceux qui vivent le plus longtemps de la famille
des primates.
La plus grande partie des espèces de marsupiaux actuelles vivent en Australie
et dans les îles qui les entourent. Leur particularité est de mettre bas des petits à un stade inachevé, qui vont terminer leur développement dans la poche ventrale de leur mère.
Tous les ours sont plantigrades (ils marchent sur la plante des pieds), ont une courte queue, de petites oreilles, un odorat très fin, mais une ouïe et une vue relativement faibles. La plupart sont omnivores. Quant aux éléphants (les plus grands des mammifères terrestres actuels), ils combinent la force à d’incroyables sens de l’odorat et du toucher, et à une mémoire étonnante.
Pour chaque chapitres, l’encyclopédie propose un ou deux quiz où il faut identifier une trentaine d’animaux. Vous devrez aussi trouver l’intrus qui s’est glissé dans chaque jeu…
4 octobre2025

Jess French, Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles, album illustré par Angela Rizza et Daniel Long, traduit de l’anglais
par Sylvie Lucas et Emmanuelle Pingault, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025,
226 pages 32,95 $.
Immersion captivante
dans l’univers des bibittes
Des abeilles aux coléoptères,
des grillons aux mille-pattes, sans oublier les araignées, Jess French présente 90 des plus fascinantes bestioles du monde dans Anthologie illustrée des insectes et autres bestioles. Certains de ces spécimens ont été découverts tout récemment.
Sans les insectes, rien ne fonctionnerait sur notre planète. Ils décomposent les déchets, pollinisent les plantes, transportent
les graines et éliminent les organismes nuisibles. Il y a des bestioles qui portent
des noms rares comme uropyge géant, rhysse cannelle, fulgore porte-lanterne, halobate, xylocope bleu ou varroa.
L’anthologie s’ouvre sur le ver œuf au plat qui peut mesurer plus de 30 cm. Découvert aux Philippines en 2001, il est d’un bleu très foncé et couvert de taches qui rappellent étonnamment des œufs au plat.
Imaginez un papillon qui aurait l’envergure d’un merle et un corps aussi long qu’une cuillère à café ! « Eh bien, c’est l’ornithop-tère de la Reine Alexandra ! Il n’y a qu’un lieu sur terre où l’on peut trouver cette espèce à l’état sauvage : les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. »
L’auteur souligne que la limace léopard (Europe) est dotée de quatre tentacules placés sur le devant de la tête, qui lui confèrent les sens de la vue, de l’odorat,
du goût et du toucher.
Il nous apprend que la sangsue médicinale méditerranéenne a passé près de 300 millions d’années à se nourrir du sang d’autres animaux. Après un bon repas,
elle peut survivre pendant plus d’un an sans se nourrir. Elle porte bien son nom
car les médecins l’ont été utilisées pendant des milliers d’années pour prélever du sang chez leurs patients.
Un des insectes les plus anciens s’appelle poisson d’argent. Apparu il y a plus de
400 millions d’années, il vit partout de par le monde, sauf en Arctique et Antarctique. Le poisson d’argent a la mauvaise habitude de s’attaquer aux aliments, au tissu et aux livres.
Quand on pense aux scarabées, des images de l’Afrique du Nord viennent à l’esprit.
Or, il existe environ 30 000 espèces partout sur la planète, dans des environnements très divers. Elles sont dotées d’exosquelettes durs, de forme ovale, qui brillent souvent
de couleurs scintillantes.
Connaissez-vous l’osmie bicolore ? Cette abeille solitaire pond uniquement dans
les coquilles vides de certaines espèces d’escargots. « La femelle est très exigeante : cette coquille doit être de la bonne taille,
ni trop obscure ni trop lumineuse. »
Vous savez sans doute que la mouche tsé-tsé peut provoquer la maladie du sommeil. Ce qui est moins connu, c’est que, en une seule piqûre, cet insecte d’Afrique centrale et occidentale peut absorber l’équivalent
de son poids en sang.
Selon les Éditions Hurtubise, cette anthologie est le cadeau idéal à offrir aux enfants de
8 ans et plus, curieux ou passionnés par les petits invertébrés. Des illustrations et photographies à couper le souffle en font une immersion captivante dans l’univers
des bibittes.
28 septembre2025

Évelyne Ferron et par Jordanne Maynard, Histoires d’aliments voyageurs, album, Montréal, Éditions Fides, coll. Civilisations, 2025, 48 pages, 24,95 $.
Les aliments ne connaissent pas de frontières
Issus de la cueillette, de la chasse
ou de l’agriculture, les aliments sont devenus, au fil des siècles,
une source de créativité. Voilà ce que Évelyne Ferron et Jordanne Maynard démontrent avec brio dans Histoires d’aliments voyageurs.
Nos ancêtres de la Préhistoire, l’homme de Néandertal et Homo Sapiens, mangeaient-ils des fruits de mer ? Dans des grottes d’Asie et d’Europe, les archéologues ont découvert de très anciens restes de repas « contenant des coquillages et écailles provenant de divers mollusques et crustacés, comme
les palourdes, les crabes, les crevettes et
les moules ! »
Il y a près de 2000 ans, la ville de Pompéi
a été ensevelie par les cendres lors de l’éruption d’un volcan. Les archéologues ayant fouillé les vestiges ont découvert
des restaurants et ont appris que les gens
y mangeaient du canard autant que de
la viande de chèvre et même de la girafe. « Certains des aliments consommés provenaient d’aussi loin que l’Afrique ! »
L’une des plus anciennes céréales semées
et récoltées est l’orge. Ce sont les Égyptiens de l’époque des pharaons qui ont le plus cultivé et cuisiné cet aliment. Ils en
faisaient de la farine, puis confectionnaient des gâteaux dont la forme ressemblait étrangement à celle des grandes pyramides. « D’ailleurs, le mot pyramide vient du grec ancien et signifie gâteau. »
Le riz a beaucoup voyagé. Il est si important que certains peuples vouent un culte à
la déesse associée à cette céréale, Dewi Sri. « À Bali, des agriculteurs lui réservent encore aujourd’hui un petit espace sacré dans leurs champs pour qu’elle protège
les cultures. »
Le pois chiche fait partie de la famille
des légumineuses et est cuisiné depuis
des millénaires. Les premières traces de sa consommation ont été découvertes dans
le nord de la Syrie, il y a plus de 8000 ans. « Un des plus anciens plats connus faits à base de cette légumineuse est le houmous, un mot qui veut simplement dire pois chiche en langue arabe. »
C’est au Moyen Âge, il y a plus de 1000ans, qu’on a commencé à la cultiver la canne à sucre pour une production en grande quantité, ce qui nécessitait une main-d’œuvre importante. « C’est malheureuse-ment l’une des raisons pour lesquelles
les colons ont exploité plusieurs populations en les soumettant à l’esclavage. »
On retrouve la tomate depuis plus de 900 ans dans des pays comme le Mexique ou
le Guatemala. Elle fut introduite beaucoup plus tard en Europe, notamment en Italie vers 1540. « C’est au 18e siècle, dans la ville de Naples, qu’on a eu la bonne idée de garnir un pain plat d’une sauce tomate appelée marinara, l’ancêtre de la célèbre pizza napolitaine. »
En Amérique centrale, les Aztèques réduisaient les fèves de cacao en poudre, puis y ajoutaient de l’eau chaude et du piment. Les premiers chocolats chauds n’étaient pas sucrés, mais très amers et épicés. C’est environ 400 ans passés que
des religieuses espagnoles ont eu la bonne idée de mélanger le sirop de cacao noir avec du sucre et de la crème, ce qui deviendra une boisson très populaire.
En 1894, John Harvey Kellogg a fait bouillir du maïs, puis a oublié le mélange qui a refroidi. Cela a donné une pâte un peu étrange pouvant s’émietter une fois aplatie. Il suffisait ensuite de faire griller le tout pour obtenir des flocons de céréales.
« Les Corn Flakes ont donc été inventées… un peu par accident. »
Au fil de ces pages, nous découvrons que les aliments que nous consommons aujourd’hui ont tous quelque chose à raconter.
15 septembre2025

Mélanie Calvé, Les sœurs Drainville, roman, Montréal, Éditions Fides, 2025, 240 pages, 27,95 $.
Roman fleur bleue
de Mélanie Calvé
Comme j’ai eu une sœur jumelle,
un roman mettant en scène des jumeaux ou des jumelles pique toujours ma curiosité. J’ai été bien servi par Les sœurs Drainville,
de Mélanie Calvé qui campe deux filles inséparables… jusqu’au jour où l’une d’elles ressent le besoin de suivre son propre chemin.
Les sœurs Drainville est le neuvième roman de Mélanie Calvé Je vous ai parlé, plutôt cette année, d’Éveline dont l’histoire était campée dans le Québec des années 1920. Cette fois, l’action se déroule toujours dans la Belle Province, mais au milieu des années 1930.
Juliette et Simone sont physiquement identiques, partagent la même chambre et travaillent toutes deux à la manufacture Wabasso Cotton à Trois-Rivières. Elles rêvent de se marier le même jour; d’ici là, les jumelles Drainville vivent des jours calmes, chaleureusement entourées de
leur famille.
Comme on peut s’y attendre, un nuage se pointe à l’horizon lorsqu’arrive un oncle inconnu des jumelles. Léo, le père de Juliette et Simone, est en colère en voyant son frère Jean-Marie refaire surface. Ce dernier a été un déserteur lors de la Première Guerre mondiale alors que Léo a combattu au front.
Ce rebondissement permet à la romancière de souligner comment plusieurs soldats sont revenus brisés. « Si c’est pas la tête qui l’est, c’est le corps, sinon le cœur. » Elle ajoute que certains soldats auraient préféré mourir au front plutôt que vivre avec tout ce qu’ils avaient vu. « La vraie guerre, c’était pas là-bas, c’est après. »
Le père des jumelles a parfois le verbe haut, surtout en parlant à son frère, et échappe alors un juron. Un calvince n’est pas surprenant. Ce qui étonne, ce sont les Saint-Jéritole-de-poivre-bleu, calvaire du Saint-Crème et saint bâtard de bœuf noir.
Une tante des jumelles joue un rôle secondaire. Elle se croit atteinte de toutes sortes de maux qui sont neuf fois sur dix
le fruit de son imagination. Mélanie Calvé écrit que cette tante Pauline est « du genre à chercher des nouilles dans la soupe aux pois ».
La romancière brosse un portrait fort intéressant de Clara, la mère. On découvre une femme pondérée qui a trop à faire pour se lamenter sur son sort. Elle a un mari à raisonner, un beau-frère à aider, une belle-sœur à réconforter et un mariage à préparer.
La recherche d’un futur mari occupe
une large place dans Les sœurs Drainville. L’approche est différente, plus égocentrique et frivole chez Simonne, plus généreuse et réfléchie chez Juliette. Cette dernière est
la première à dénicher la perle rare,
au grand dam de sa jumelle.
Juliette rencontre les parents de son fiancé au Restaurant français, mais elle ne comprend pas grand-chose au menu : escargots de Bourgogne, escalope de veau au beurre noir, ris de veau Clamart, suprême de volaille Alexandra. Après une gorgée de vin, elle trouve cela dégoûtant, voire infect. Heureusement, les convives s’entendent à merveille.
À l’image d’une robe des jumelles, Mélanie Calvé signe un roman fleur bleue. Ce qui sauve la mise, c’est son art d’illustrer comment les relations familiales peuvent être mises à rude épreuve, même au tout début d’un mariage.
11 septembre2025

Katherine Girard, Helena, tome 2,
Les bonheurs vacillants, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 366 pages, 27,95 $.
Un couple qui sait compter l’un sur l’autre
Helena est de retour. Dans son tome 2 intitulé Les bonheurs vacillants, Katherine Girard campe de nouveau cette femme volontaire, intelligente
et entêtée. Le projecteur est autant braqué sur François, un mari également volontaire, intelligent
et entêté.
Bien que l’époux d’Helena fût l’arrière-grand-père de l’auteure, « il faut considérer cette histoire comme un roman, non comme une biographie, écrit Katherine Girard dans une Note aux lecteurs et lectrices, et ne pas ne pas me tenir rigueur des possibles dérives de mon imagination. »
L’action se déroule principalement à Héberville-Station, au Lac-Saint-Jean, entre 1924 et 1942. Helena, très jeune veuve et mère d’un fils, a épousé François Bouchard, celui qui a été le premier à faire battre
son cœur à tout rompre. Il lui donnera
une bonne douzaine d’enfants en vingt-
cinq ans.
Autant elle exprime facilement son amour pour son mari, autant il ne lui est pas facile d’agir ainsi envers ses enfants. « Avouer qu’on aimait, c’était courir le risque de voir le vent tourner… Mieux valait garder profile bas […] et prier en secret pour que tout
le monde reste en santé et trouve son petit bonheur. »
Dès le premier chapitre, la romancière décrit comment les habitants d’Hébertville-Station réagissent au tremblement de terre survenu le 28 février 1925, un des plus forts séismes du XXe siècle au Canada (magnitude 6,2), dont l’épicentre était situé à l’embouchure du Saguenay.
Une des rares scènes à ne pas se dérouler au Lac-Saint-Jean est un voyage du couple à Montréal le 24 juin 1926. Outre le défilé de la Saint-Jean, on assiste au dévoilement du monument destiné à honorer la mémoire des Patriotes, œuvre sculptée par l’artiste Alfred Laliberté.
Comme dans le premier tome, le curé clame haut et fort que l’union charnelle ne doit servir qu’à la procréation et que le seul rôle de la femme est d’élever une famille nombreuse (entendez un enfant à tous
les deux ans). Or, pour Helena et François,
la fusion de leurs corps fait monter
le plaisir « à mesure que leurs mouvements devenaient frénétiques, puis vint l’apogée,
le désir explosé, la jouissance ultime ».
Le plaisir de la chair est loin d’être
un péché pour eux.
Avant de devenir cinquantenaire, Helena accouchera 14 fois (elle en perd quelques-uns). Sa vie se résume à langer, cuisiner, nourrir, nettoyer, filer, tricoter, repriser, nettoyer et jardiner. Autant de verbes engageants qui entravent sa démarche
vers la liberté.
La romancière décrit comment les habitants survivent coûte que coûte à la Dépression. « Désormais, on effectuait du troc, échangeant les œufs contre la farine,
et le lait frais contre la laine; on se prêtait des outils, on échangeait des services : l’argent n’avait presque plus de valeur. »
Le roman nous apprend que, à Montréal,
250 000 personnes vivent alors des secours directs (soupe populaire, bons alimentaires). À la grandeur du Québec, le taux de chômage est de trente pour cent.
À la campagne, « au moins, on a nos champs et nos animaux ».
Helena se targue d’avoir une intuition féminine spéciale, ce qui agace son mari
qui la traite de sorcière. Il trouve que
son épouse est trop préoccupée par
des fantômes secrets et par des angoisses connues d’elle seule.
N’empêche qu’Helena a le pressentiment d’un incendie. Quelques jours plus tard,
le feu détruit trente-cinq bâtisses, jetant
une vingtaine de familles à la rue. Comme on peut s’y attendre, dans ce village,
« les gens s’entraidaient. Ils étaient tissés bien serré. »
Bon an mal an, le lien entre François et Helena demeure fort. Même s’ils ne sont pas toujours au diapason, ils savent se retrouver et compter l’un sur l’autre. On n’a pas fini d’entendre parler d’Helena puisqu’un troisième et dernier tome est en préparation.
31 août2025

Josée Mongeau, Le Cabaret de la Folleville, tome 1, Anne Lamarque, l’insoumise, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 440 p., 29,95 $.
Conjuguer mari et amant en Nouvelle-France
La Nouvelle-France a eu des pionnières de la trempe de Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys.
S’il n’en tient qu’à Josée Mongeau,
on peut ajouter Anne Lamarque au chapitre des relations… extraconjugales. Voilà ce que
le premier tome du Cabaret de l
a Folleville clame haut et fort.
L’action débute en 1662 à Bordeaux (France) et se termine en 1673 à Ville-Marie (Montréal). Anne Lamarque n’a que 13 ans lorsque son père manifeste l’intention de la marier à un veuf quinquagénaire qui lui répugne vivement. Accompagnée de son frère Jacques, qui a juré de la protéger, elle décide de fuir là où ses parents ne pourront la retrouver : en Nouvelle-France.
La traversée est une succession de hauts-fonds, écueils et rochers de surface qui personnifient autant de dangers. Rien n’est
à l’épreuve de celle qui réussit à fuir un mariage imposé et à devenir maîtresse de son destin.
Comme il y a peu de femmes à Québec pour satisfaire colons et soldats, Anne est courtisée, puis harcelée. Le refus de l’adolescente conduit à un viol. Ayant perdu sa virginité, elle craint d’engendrer un enfant non désiré. La romancière décrit comment Anne est soulagée de voir ses mois reprendre.
« Jamais elle n’avait été aussi heureuse de saigner. Avec le sang qui coulait, s’échap-paient aussi le fiel et les idées noires. Tout comme la saignée, ces menstrues allaient rééquilibrer les humeurs et ramener la paix dans son cœur. »
Anne et Paul Lamarque s’établissent à Ville-Marie en 1665. Les maisons de bois y sont construites au petit bonheur, celle du gouverneur de Maisonneuve est presque
en ruine, il n’y a aucune rue. Ce n’est pas une ville, plutôt une bourgade.
Comme à Québec, Anne subit la rustre galanterie des homme célibataires à Ville-Marie. Elle se fait accoster par des « Eh ma jolie, on va s’ébattre dans le foin, toi et moi ? », ou encore par des « Toi, je labourerais bien tes champs ! »
Ayant fui Bordeaux pour éviter un mariage abhorré, Anne Lamarque jette son dévolu sur Charles Testard de Folleville. Cet homme timide, solitaire et sans grand courage devient son mari de nom. C’est vers un autre homme qu’elle va chercher « amour, passion et réconfort qui lui manquaient tant ».
Josée Mongeau ficelle son intrigue pour décrire comment il était possible pour une femme mariée, dès les premières heures de la colonie, de perdre toutes ses craintes, toutes ses objections, toute sa pudeur pour s’abandonner sans retenue dans les bras d’un partenaire illégitime qui savait si bien éveiller ses sens.
La romancière illustre aussi comment une épouse avec quatre enfants peut avoir des journées remplies de travaux utiles, certes, mais insignifiants. Anne ne vibre que pour le cabaret qu’elle a ouvert. Il devient
« sa raison de vivre et sa fierté d’accomplir quelque chose par elle-même ». Anne entend mener sa vie sans avoir constam-ment « un enfant dans le ventre ou à
la mamelle ».
Parce que Josée Mongeau adore les mots, elle a saupoudré son roman d’expressions surannées et de termes peu usités de nos jours, pour lesquels une définition se trouvent à la fin du livre. En voici quelques exemples : blessure pour désigner une fausse-couche, viduité pour veuvage (surtout chez les femmes), butor pour parler d’une personne stupide et faquin pour faire référence à un homme qui pose des gestes indignes de son statut.
Un appendice d’une quinzaine de pages permet de démêler le vrai du faux, le réel du romanesque et les hypothèses imaginées. On y apprend que le tremblement de terre de 1663 a été le plus important qu’a connu le Québec jusqu’à maintenant; c’était un séisme de magnitude 7,3 à 7,8 sur l’échelle de Richter.
Moins d’une dizaine des quelque quarante personnages sont fictifs. Anne Lamarque, son frère Jacques, son mari Charles et
son amant Amédée sont tous réels. Parmi
les personnalités de l’époque, on trouve François-Marie Perrot, gouverneur de Montréal et le très jeune Pierre Lemoyne d’Iberville.
17 août2025

Alexis Riopel, Reportages hawaiens, Décadence naturelle, renaissance culturelle, essai, Montréal, Éditions Somme toute –
Le Devoir, 2025, 126 pages, 18,95 $.
S.O.S. Hawaï
Isolées du reste du monde pendant des lustres, les îles hawaïennes sont maintenant confrontées à de vives menaces. Dans ses Reportages hawaïens, le journaliste Alexis Riopel se penche à la fois sur
la décadence naturelle et
la renaissance culturelle de cet archipel dont la population se chiffre à 1,4 million et dont le nombre
de visiteurs est au moins sept fois plus élevé.
De septembre 2023 à août 2024, Alexis Riopel a eu la chance d’explorer Hawaï.
Il a publié des reportages dans Le Devoir, L’actualité, Liberté, Québec Science, Nouveau projet, Curium et Le Monde. Son recueil
les inclut presque tous.
Le constat de l’auteur est alarmant.
La nature indigène disparaît au profit d’espèces envahissantes. La langue hawaïenne et l’agriculture traditionnelle
ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes.
Les feux de brousse menacent la population.
Dans « Restaurer le paradis hawaïen » (Québec Science, septembre 2024), Riopel explique comment la flore qui a évolué dans l’archipel volcanique est maintenant
au bord de l’abîme. Des écologistes tentent de regénérer ces milieux avant qu’il ne soit trop tard.
Dans « La revivance de la langue hawaïenne » (Le Devoir, 12 juin 2024),
on apprend que cette langue a l’un des systèmes sonores les plus restreints au monde, avec seulement 14 sons. Chaque
mot signifie différentes choses à la fois.
Leur sens dépend beaucoup du contexte.
Avant les années 1970, l’hawaïen suscitait
le dédain et l’indifférence. Aujourd’hui,
une nouvelle génération de locuteurs revitalise cette langue. « Près de 2 400 élèves du primaire et du secondaire fréquentent les écoles d’immersion intégrale en langue hawaïenne, soit 50 % plus qu’il y a 10 ans. »
Dans « Le hula, fierté de la jeunesse hawaïenne » (Curium, juillet-août 2025),
on apprend que cette danse traditionnelle, jadis interdite par les colonisateurs, fait revivre les histoires anciennes du royaume d’Hawaï. « Il permet à ses interprètes d’apprendre la langue du pays, de découvrir sa culture, d’étudier son histoire, de vivre
un moment spirituel. »
La prospérité d’Hawaï n’est pas durable.
Ses ingrédients d’effondrement sont
les mêmes qu’à l’échelle planétaire.
Ils n’apparaissent que plus clairement dans un microcosme insulaire : dépendance au pétrole, incapacité de se nourrir soi-même, vulnérabilité aux catastrophes naturelles.
En conclusion, Riopel écrit qu’une question cruciale demeure en suspens. Jusqu’où, se demande-t-il, ira la renaissance hawaïenne ? « Sa cadence actuelle peut-elle se maintenir jusqu’à ce que la culture hawaïenne redevienne dominante dans l’archipel ? »
Alexis Riopel est journaliste au Devoir depuis 2018. Il couvre l’environnement, l’énergie et les sciences. En 2024, il publiait Singapour, laboratoire de l’avenir avec
le photographe Valérian Mazataud.
11 août2025

Jo Furniss, Arrêt de mort, roman traduit de l’anglais par Vincent Guilluy, Boulogne-Billancourt, Éditions Hugo & Cie, coll. Impact, 2025, 432 pages, 32,95 $.
Freiner le crime sur
une autoroute endiablée
La Britannique Jo Furniss a récemment publié un polar qui a piqué ma curiosité et stimulé mon ego d’enquêteur. J’ai lu son Arrêt
de mort en cherchant constamment
une réponse aux questions que chaque personnage suscitait.
Belinda Kidd, alias Billy The Kidd, entre dans la police à 19 ans. Aujourd’hui sergent à
51 ans, elle songe à une retraite anticipée.
En revenant de vacances en Australie, Billy se trouve coincée dans un embouteillage
sur une autoroute en banlieue de Londres.
C’est un vendredi torride. Quand elle sort
de sa voiture pour se dégourdir les jambes, Billy the Kidd découvre que le conducteur de la berline voisine est mort derrière
son volant, une sorte de pic planté dans
la nuque.
L’intrigue se dénoue 5 ou 6 minutes à la fois pendant 45 chapitres, soit de 17 h à 21 h 59. Le sergent Kidd n’est pas dans une voiture de patrouille bien équipée. Identité policière, uniforme, matraque, gants de caoutchouc, sachets sécurisés, gaz lacrymo, radio, Billy n’a rien de tout ça. « Elle allait devoir improviser. Et être prudente. »
Ce sont des attentats terroristes qui ont déclenché l’arrêt de circulation et l’embouteillage monstre, d’abord à la guerre ferroviaire à 16 h 30, puis dans le tunnel
de Deadwall à 17 h. Billy est certaine que
le tueur est dans l’une des voitures immobilisées autour de la sienne. Comment le trouver…?
En communiquant avec son collègue Dominic Day, alias D-Day, au commissariat, Billy The Kidd apprend qu’elle roulait sur une des rares sections autoroutières du pays qui ne soient point surveillées. Pas de caméra, un énorme angle mort pendant
plus de deux kilomètres. De quoi rendre
son enquête plus problématique sur cette autoroute endiablée.
Les documents dans la berline indiquent que le mort est un Américain qui voyage sous un faux nom. De fil en aiguille, on apprend qu’il a causé la mort d’un piéton anglais quelques mois plus tôt, et qu’il a pu éviter la justice britannique en rentrant aux États-Unis via une base militaire. Son retour et sa mort soudaine sur l’autoroute soulèvent l’hypothèse d’une vengeance…
Le sergent Billy mène plusieurs interrogatoires et identifie des pistes inattendues. Or, si la circulation se résorbe, elle risque de perdre le, la ou les suspects. L’horloge tourne, mais la policière ne sait pas à quelle vitesse.
Le style de Jo Furniss est entraînant. On ne s’éternise pas dans de longues et pénibles descriptions. J’ai remarqué quelques comparaisons originales : « blanche comme un paquet de kétamine », « mon doigt me lance comme un petit oiseau assommé », « il avait les dents d’un blanc holly-woodien », « disparue dans la nuit comme si elle venait de tomber d’une falaise ».
Les pensées font faire des choses aux gens. Jo Furniss illustre comment elles peuvent être à la source d’une crise de panique,
d’un suicide, d’un meurtre aussi.
26 juillet2025

Pierre-Alexandre Bonin, L’incroyable aventure de Jacques Cartier, explorateur
du Canada, album illustré par Sam Trouillas Guillem, Montréal, Éditions Bayard Jeunesse Canada, coll. Les romans-docs, 2025,
48 pages, 12,95 $.
Les explorations de Jacques Cartier en bref et avec brio
Pour initier les jeunes de 9 ans
et plus à l’histoire de leur pays, l’écrivain Pierre-Alexandre Bonin et l’illustrateur Sam Trouillas Guillem décrivent trois importants voyages dans L’incroyable aventure de Jacques Cartier, explorateur du Canada. Ce sont les expéditions
de 1534, 1535-1536 et 1541-1542.
On sait que Jacques Cartier quitta Saint-Malo le 20 avril 1534 et traversa l’Atlantique en vingt jours. L’album nous apprend que, après avoir longé le détroit de Belle-Isle,
il planta une croix à havre Saint-Servan « afin qu’elle serve de repère de navigation ».
C’est donc avant la croix de trente pieds,
aux armes de la France, plantée à Gaspé le 14 juillet 1534. Cette dernière lui permettra d’affirmer : « Je prends ainsi possession de cette terre au nom de mon roi. »
Le monarque est François 1er.
Au début de ce mois de juillet, Cartier arrive d’abord à des îles dont certaines sont reliées par des bancs de sable. Il nomme cette région Araynes (du latin arena, qui signifie sable). Une note en bas de page indique
que ce sont les îles de la Madeleine.
Toujours au début de juillet 1534, l’explorateur entre dans une baie où
le climat lui semble plus chaud encore que celui d’Espagne. « C’est pourquoi je la baptise “baie des Chaleurs”. »
L’album souligne que Cartier a été envoyé par le roi pour rapporter des richesses. Il sera plutôt le premier Français à découvrir un nouveau continent et à rencontrer pour les les peuples qui y vivent. Ses rapports avec les autochtones sont révélateurs de
la place de la colonisation dans l’histoire
de France.
En plus de décrire brièvement les trois voyages de l’explorateur, cartes et itinéraires à l’appui, l’album fournit en appendice des renseignements sur l’exploration et la colonisation du Nouveau Monde par des prédécesseurs comme Vasco de Gama, Christophe Colomb et Fernand de Magellan. Un tableau dresse une synthèse des voyages au Canada après Cartier, de 1507 à 1806.
Un autre appendice explique comment, au XVIe siècle, les voyages d’exploration étaient des périples longs et souvent dangereux.
On fournit des notes sur les outils pour
la navigation, sur les genres de navires,
sur les vivres nécessaires pour nourrir
un équipage, et sur la tâche de cartographe qui s’ajoute à celle d’explorateur.
17 juillet2025

Hervé Gagnon, Les Jours où j’ai tué Emma, roman, Montréal, Éditions Hugo Québec, 2025, 150 pages, 15,95 $.
Roman jeunesse sur
la théorie des multivers
Quand une idée met plus de
45 ans à germer dans la tête
d’un romancier, il ne faut pas
se surprendre qu’elle éclose dans une variété de possibles. Hervé Gagnon en fait la preuve avec
un court roman intitulé Les jours
où j’ai tué Emma.
C’est à travers les enquêtes de Joseph Laflamme (Maria, Adolphus, Susan) et
les romans jeunesse La Cage 1 et 2 que j’ai connu l’écrivain Hervé Gagnon. Comme
les trois thrillers historiques et les deux ouvrages pour un jeune lectorat m’avaient plu, je me suis laissé tenter par Les Jours
où j’ai tué Emma. Le résultat a été pour le moins déroutant.
En 1978, Hervé Gagnon était en troisième secondaire et bien trop timide pour parler à une fille formidable de son école. Il se base sur ce fait vécu pour concocter non pas
une autofiction mais plutôt une science-fiction, genre qui n’a jamais vraiment piqué ma curiosité.
L’intrigue des Jours où j’ai tué Emma
repose sur la théorie des multivers. Qu’est-ce que cela mange en hiver? Il s’agit de
la coexistence d’une infinité d’univers parallèles où toutes les variantes possibles de tous les événements existent. Il s’agit tout simplement de trouver le bon…
Les protagonistes du roman sont Frédéric
et Emma, deux élèves en quatrième secondaire. C’est « une version nettement améliorée d’Emma Boivin » que Frédéric
a sous les yeux. Une version femme.
Le sentiment qu’il éprouve est « à la fois violent, enivrant, terrifiant et vertigineux ».
Je n’ai jamais été dans une telle situation pour deux raisons. Un, je suis attiré par
les mecs. Deux, j’ai découvert cette orientation bien après le secondaire.
Quand Emma dit à Fred « Je t’aime énormément, mais pas “comme ça”… »,
je dois faire appel à mon imagination,
ce qui demeure possible, bien entendu.
Ce qui s’avère bizarre cependant, c’est l’infinité d’univers parallèles où toutes
les variantes possibles de tous les événe-ments existent. L’évolution psychologique
de Frédéric et d’Emma est assez mince puisque l’auteur choisit constamment de tout recommencer. Il aborde les thèmes
avec une plume fluide, mais il y a peu de place pour les traiter en profondeur.
Comme Frédéric est incapable d’aborder Emma, de lui déclarer ses sentiments, cette dernière se lasse et se met à fréquenter Maurice. Peu après, Fred apprend leur décès dans un accident de moto. La nouvelle l’anéantit.
Or, la théorie des multivers fait tout disparaître. Nouveau départ, nouvel échange entre Fred et Emma ! Encore et encore et encore… J’ai décroché. Peut-être aurais-je persévéré si Fred avait rencontré un mec
la deuxième ou la troisième fois...
Je peux juste espérer que le prochain roman jeunesse d’Hervé Gagnon lui fournira une occasion d’être plus inclusif.
6 juillet2025

Roger Turenne, Dans la cour des grands,
Le parcours audacieux d’un Franco-Manitobain, autobiographie, Saint-Boniface, Éditions du Blé, 2025, 512 pages, 32,95 $.
Minutieuse autobiographie franco-manitobaine
Un petit gars de Saint-Pierre-Jolys (Manitoba) raconte son parcours audacieux, surtout comme agent
au ministère des Affaires extérieures, puis à titre d’architecte des politiques linguistiques de deux premiers ministres manitobains. C’est Dans
la cour des grands que Roger Turenne nous révèle tout avec
une rigoureuse minutie.
Dès le premier chapitre, l’auteur précise que ses mémoires traiteront autant d’aventures imprévues que de caprices du hasard.
Il entend s’attarder aux divers choix qu’il
a dû effectués avec circonspection.
Né en 1943, Roger fait son cours classique au Collège de Saint-Boniface, puis obtient une maitrise en sciences politiques de l’Université du Manitoba. Il passe des mois
à fouiller les archives pour « comprendre comment les francophones du Manitoba naviguaient sur les écueils politiques
en tant que minorité assiégée ».
Turenne appuie des candidats franco-manitobains aux élections provinciales.
L’un d’eux est mon premier patron René Préfontaine qui subit une défaite même si
le gouvernement de Duff Roblin est réélu. Quelques années plus tard, Préfontaine déménage à Ottawa pour diriger
le programme d’aide aux minorités de langue officielle. Il m’engage comme responsable des Activités jeunesse.
Le premier emploi de Turenne est guide
de l’Assemblée législative. Il a visité tous
les édifices législatifs du pays et affirme
que « le siège du gouvernement du Manitoba les éclipse tous ». C’est là qu’il accueille trois futurs premiers ministres québécois : Daniel Johnson père, Daniel Johnson fils, Pierre-Marc Johnson.
Aux Affaires extérieures, le jeune fonctionnaire doit coordonner la visite du président du Niger, Hamani Diori. Cela lui permet d’être « témoin des premiers pas
de la participation du Canada à la Francophonie internationale ».
Turenne obtient un poste à l’étranger parce que personne ne veut aller en République démocratique du Congo. De là, il rayonne
au Congo-Brazzaville, au Rwanda et au Burundi. Chacune de ses missions est décrites avec force détails.
Le diplomate en profite pour visiter l’Afrique du Sud. Lire sur la ségrégation raciale est une chose, la confronter à chaque tournant en est une autre. « Les affiches obscènes se trouvaient partout, devant les magasins,
les pharmacies, les arrêts de bus, les toilettes publiques, les bancs, les parcs publics et
les plages. »
Lorsque Turenne passe de Kinshasa à Stockholm, il passe du plus corrompu-chaotique-répressif au plus progressiste-démocratique-égalitaire. En tant que chef de la section politique de l’ambassade, il est responsable de tout ce qui ne relève pas
du commerce ou de l’immigration.
De retour au Manitoba, Roger Turenne est témoin d’une révolution tranquille. Le Centre culturel franco-manitobain est une société d’État, « le seul du genre au Canada hors
du Québec ». Le Cercle Molière présente
des pièces de dramaturges franco-manitobains. Des auteurs-compositeurs débordent les frontières. Deux maisons d’édition sont à l’œuvre avec brio.
Il sillonne la province et se documente pour publier Mon pays noir sur blanc. Cela va changer le cours de sa vie. Son livre sert
de carte de visite lorsque le gouvernement cherche un conseiller spécial pour l’aider
à mettre sur pied des services en français
et pour assurer la liaison entre
le gouvernement et la communauté francophone.
Dans une nouvelle carrière, Turenne analyse les situations, formule des politiques, fournit des conseils menant à des décisions et négocie les résultats. Il peut se targuer d’avoir joué un rôle-clef afin que les fondements juridiques et institutionnels de la communauté francophone du Manitoba soient désormais « protégés, financés et acceptés socialement ».
30 juin 2025

Pierre Calvé, Le français grandeur nature. Portrait et défense d’une langue vivante, essai, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2025, 180 pages, 21,95 $.
Le français en jeans,
t-shirt, veston et cravate
Le français est probablement
la langue la plus surveillée, réglementée et critiquée sur terre. Pierre Calvé se porte à la défense d’une langue vivante dans
Le français grandeur nature et démontre qu’elle a autant le droit
de se promener en jeans et t-shirt qu’en veston et cravate.
« Le présent ouvrage, écrit-il, vise à mieux faire connaître la langue parlée naturelle,
à bien la distinguer des usages soignés, “surveillés”, parlés et écrits, et à déterminer les critères d’acceptabilité sociale et linguistique qui reviennent à chacun de
ces usages. »
Les censeurs aiment s’attaquer aux archaïsmes, jugés fautifs parce qu’ils ne sont généralement plus en usage ou en voie de disparition. Or, il faut faire une distinction entre archaïque et familier. Peignure, barbier et trâlée (ribambelle) ne sont pas des mots fautifs; ils sont géographiquement et socialement acceptables.
Les langues fourmillent d’expressions qu’on ne peut traduire littéralement sans qu’elles perdent tout leur sens ou deviennent loufoques. Exemple : I quit smoking cold turkey – J’ai arrêté de fumer dinde froide. C’est ce qu’on appelle des idiotismes. Calvé propose un quiz portant sur une quinzaine d’idiotismes, dont To pull one’s leg, Une entente à l’amiable, That’s the last straw,
À la bonne franquette.
L’auteur souligne à plus d’une reprise que 42 % des quelque 60 000 mots contenus dans Le Petit Robert ont été empruntés à d’autres langues. Outre le latin, le français
a emprunté des mots au grec, à l’italien,
à l’allemand et même à la langue celte (alouette, cervoise, chêne, sapin).
« Il faut rappeler toutefois, souligne Calvé, que cette intégration s’est faite sur
une longue période, contrairement à de nombreux anglicismes qui continuent d’envahir le français et dont l’intégration
est loin d’être assurée. »
Dans un très court texte sur le libre-échange français-anglais, l’auteur souligne la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, en 1066. Durant les quelques 300 ans qu’a duré cette occupation, l’aristocratie anglaise parlait le français, langue qui a continué pendant des siècles à dominer la diplomatie.
Les anglicismes occupent quelques pages
de cet ouvrage, bien entendu. Plusieurs ont « fait leur lit » sans que personne ne les remette en question : barbecue, camping, hot-dog, tee-shirt, boycott, pickpocket.
La perception est différente selon que
l’on soit Franco-Canadien ou Français de l’Hexagone. Les anglicismes tendent généralement à s’imposer par leur omniprésence au Canada. En France, ils sont plus souvent librement adoptés pour des questions de mode et parfois de snobisme.
En résumé, une langue sert essentiellement à quatre choses : 1. à communiquer;
2. à penser, réfléchir, élaborer des idées;
3. à acquérir et emmagasiner de l’information; 4. à se forger une identité
en tant que membre d’une communauté humaine particulière. C’est la perte de l’une de ces caractéristiques qui conduit à l’assimilation.
Pierre Calcé est détenteur d’un doctorat en linguistique. Il a été professeur à l’Université d’Ottawa, notamment doyen de la Faculté d’éducation. Sa carrière a surtout été consacrée à la didactique du français et
à la linguistique franco-canadienne.
25 juin 2025
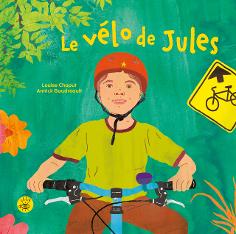
Louise Chaput, Le vélo de Jules, album illustré par Annick Gaudreault, Montréal, Éditions de l’Isatis, coll. Clin d’œil, 2025,
24 pages, 17 $.
Le vélo de
la connivence
Je crois bien que la marque de ma première bicyclette était CCM, probablement de seconde main mais en meilleur état que Le vélo de Jules, titre de l’album signé par Louise Chaput et illustré par Annick Gaudreault. On suggère une lecture
à partir de 2 ans.
Le père de Jules trouve un vélo dans
les poubelles, au bout de la ruelle.
Il convainc son fils que cet engin a encore une belle vie devant lui. Pas à pas, le petit Jules et son père vont réparer le vélo qui, après un bon nettoyage et quelques coups de pinceau, a déjà plus fière allure.
Après avoir regonflé les pneus, changé
les patins de freins et fait quelques réglages, le vélo est prêt à rouler. Jules embarque sur sa selle et s’élance dans les flaques et sur
la piste cyclable avec entrain.
Louise Chaput raconte l’histoire à coups de pinceau, à coups de pédale, à coups de rime, dont voici un exemple : « Un coup de torchon / sur le guidon et les rayons. /
Sur le cadre abîmé, / je pose ma couleur préférée. » Cet album joyeux fait du vélo une belle aventure.
Les deux dernières pages présentent la petite histoire du vélo en 7 brèves capsules. Cela va de 1817 (invention du vélocipède) à 1997 (adaptation du vélo pour les petits).
On y apprend que John Dunlop fait passer les pneus de fer ou de bois à des pneus à air en 1888.
Les illustrations d’Annick Gaudreault montrent que tenir le guidon d’un vélo, tout petit, c’est déjà gagner en autonomie. Elles célèbrent le plaisir de sentir le vent sur son visage en choisissant ce mode de transport actif.
D’une page à l’autre, ce court album fait
des clins d’œil à l’écologie, à l’environne-ment, à la consommation responsable et
à la liberté. À mon avis, le jeune lectorat retiendra surtout l’harmonieuse relation parent-enfant. Louise Chaput célèbre avec brio la connivence entre le père et Jules qui donnent une seconde vie à un objet.
En lisant Le vélo de Jules je n’ai pas pu
faire autrement que me remémorer
les excursions dans mon village natale de Saint-Joachim (sud-ouest ontarien),
mes courses à l’épicerie pour une pinte
de lait ou un pain, puis mes randonnées
le long du canal Rideau et à travers
la Ferme expérimentale à Ottawa, et enfin les heures de détente sur les pistes cyclables et sur les sentiers des îles à Toronto, parfois en compagnie de Martine Rheault.
14 juin 2025

Sébastien Dulude, Amiante, roman, Montréal, Éditions La Peuplade, 2024, 224 pages,
27,95 $.
Roman phare
sur l’amitié ambivalente
Après trois recueils de poésie, Sébastien Dulude signe un premier roman où il aborde l’enfance avec brio. Intitulé Amiante, cette prose finement ciselée porte sur une amitié particulière, avec juste ce qu’il faut de non-dits et d’ellipses.
Les protagonistes du roman sont Steve Dubois, 9 ans, et Charlélie Poulin, 10 ans.
Ces deux garçons vivent à Thetford Mines, ville phare de l’industrie de l’amiante québécoise. L’action se déroule d’abord durant l’été 1986, période où les deux garçons s’abandonnent aux plaisirs
de l’amitié.
La première fois que Steve rencontre le petit Poulin, il remarque d’abord un garçon à la dégaine polissonne, puis « l’ami que je cherchais désespérément ». Devenus inséparables, les deux enfants passent l’été en enfourchant leurs vélos ou allongés dans leur cabane dressée dans un pin.
Leurs sentiments se forgent parmi
« le frisson aigu des grillons, les trilles
des passereaux et le sifflement des couleuvres ». Très tôt dans le roman, Steve sent la peau de la cuisse de Charlélie contre la sienne. « Une électricité chaude reliait nos chairs… »
L’air de leur bouche s’échange. Le faîte
du slip de Charlélie semble tendu, voire palpitant. Steve empoigne doucement le sexe de son ami et apprécie l’étrange humidité qui se forme à la pointe. « Bruissement d’ailes d’un oiseau en envol. Nous nous sommes éveillés. Ça n’avait rien d’éternel. »
Le narrateur Steve est manifestement amoureux de Charlélie. Le romancier
mêle poésie et rudesse du paysage minier pour dépeindre une amitié aussi profonde qu’ambivalente. Le texte de Sébastien Dulude m’a séduit par son écriture sensorielle, par sa façon d’illustrer comment l’enfance s’effrite sur l’adolescence.
Le roman comprend deux parties
d’environ cent pages chacune. Il y a d’abord la rencontre amicale-amoureuse en 1986, puis nous assistons cinq ans plus tard à
la reconstitution d’un paradis évanoui.
Entre ces deux périodes, il y une tragédie qui affecte le cours de la vie de Steve.
Réflexion faite, l’adolescent ne sait plus si à neuf ans il ressentait consciemment « que le beau visage renaré de Charlélie Poulin,
le calme anémone de ses longs cils et
le cyan à ses lèvres étroites » lui inspiraient un ordre de sentiments fiévreux.
La mère de Steve est plus à l’aise en anglais. Mom ne dépose pas un bisou mais plutôt un kissy sur la joue de son fils. Elle prépare pea soup & soda crackers. Elle dit à son mari : « change de canal, Pierre, this isn’t for his age ».
Pierre Dubois travaille à la mine.
Il n’apprécie pas les posters d’hommes aux torses nus, tatoués et vêtus de cuir moulant sur les murs de la chambre de son fils : « tu vas m’enlever tes photos de tapettes ». Qu’aurait-il dit s’il avait su que Steve gardait la photo de Charlélie dans son portefeuille…?
De 1986 à 1991, les confidences de Steve « se meuvent de crique en ruisseau en rivière ». Il voit cela comme un seul territoire dans lequel ses émotions et
ses sensations circulent librement, indistinctement, à feu doux.
Le romancier écrit que les mains de Charlélie soulageaient l’humeur en vrille de Steve, le rattrapaient. « Même maladroites, approximatives, ses caresses s’infusaient sous ma peau et me consolaient, comme tous les gestes de mon ami, ses paroles,
ses regards. Il savait m’attiédir. »
Amiante a été trois fois lauréat, notamment pour le Prix des libraires du Québec, et douze fois finaliste, y inclus pour le Prix littéraire Le Monde. Je reprends les mots
du critique Dominic Tardif (La Presse), qui estime que ce roman a été écrit dans une langue « qui traduit certes le quotidien alangui de son personnage, mais peut-être davantage ce qui bourgeonne dans son esprit et son cœur ».
6 juin 2025

Kim Ho-Yeon, Le Vagabond de Seoul, roman coréen traduit par Yeong-hee Lim et Catherine Biros, Arles, Éditions Picquier, 2025, 320 pages, 40,95 $.
Super roman sur
une supérette coréenne
Un employé de nuit dans
une épicerie de quartier réussit à accomplir des merveilles avec
la seule force de sa sincérité et
de sa bienveillance. Tel est
le protagoniste du Vagabond de Seoul, roman de Kim Ho-Yeon qui
a conquis le cœur de plus d
’un million et demi de Coréens.
Madame Yeom, vieille dame très digne et énergique qui veille avec sollicitude sur
le bien-être des employés de sa supérette Always, perd sa pochette contenant ses biens les plus précieux dans la gare de Séoul. Dokgo, sans-abri bourru à l’identité mystérieuse, va la retrouver et la lui rendre. Madame Yeom engage cet ours pataud qui devient rapidement un chien fidèle.
Dokgo est un vagabond abîmé par la vie, qui a mystérieusement oublié son passé.
Il est aussi un homme intelligent qui se fait une idée très précise du bien et du mal, comme vont le découvrir un père de famille au bout du rouleau, une jeune dramaturge en panne d’inspiration et un détective vieillissant un peu paumé. Dokgo va leur donner une clé pour dénouer chaque situation.
Divers clients imaginent, chacun à leur façon, ce qu’a bien pu être le passé de Dokgo. « Certains voient en lui
un malfaiteur, d’autres un prisonnier ou
un réfugié de Corée du Nord, d’autres encore un homme ayant pris une retraite anticipée, ou même un extraterrestre ! »
Pendant ce temps, l’air de rien, le vagabond de Séoul recommande à ses clients des produits peu connus, comme cette infusion aux barbes de maïs, qui donne l’impression de boire de l’alcool à cause de sa couleur. « J’étanche à la fois ma soif et mes envies d’alcool. »
Le prix des produits est indiqué en wons, monnaie sud-coréenne depuis 1962.
Les montants cités sont énormes puisque
1 $ CAN = 995 wons. À la supérette de madame Yeom, une canette de bière coûte environ 2 500 wons.
Le manger est souvent désigné en coréen, rarement avec traduction. On devine par
des bouts de phrase que le ramyeon est
un gobelet de nouilles, qu’un sundubu jjigae est un ragoût de tofu épicé et que le soju est un spiritueux fait traditionnellement à partir de riz (son degré d’alcool le plus commun est 20 %).
Quant au samgap kimbap, il s’agit d’un en-cas très populaire composé de riz blanc, d’huile de sésame grillé et de divers autres ingrédients, l’ensemble étant roulé dans
une algue séchée. Il ressemble au sushi japonais mais ne contient en général pas
de poisson cru.
En décrivant la rencontre de Dokgo avec une jeune dramaturge en panne d’inspiration, Kim Ho-Yeon mentionne
la célèbre romancière sud-coréenne Park Kyung-ri (1926-2008) et son œuvre la plus remarquable, La terre. Une recherche m’a indiqué qu’il s’agit d’une saga en cinq parties et seize volumes sur l’histoire coréenne des XIXe et XXe siècles, qui fut adaptée par la suite en film et en opéra.
Dans ce roman, certains clients trouvent
que la supérette n’est pas super parce
qu’on n’y trouve pas une très grande
variété de marques. Chose certaine,
le roman Le Vagabond de Seoul est super parce que Kim Ho-Yeon se démarque par
sa recherche originale, sa profonde réflexion et son dire poétique.
Kim Ho-Yeon, 50 ans, a été scénariste de cinéma, auteur de manhwa, éditeur, puis auteur de cinq romans, tous récompensés par de nombreux prix littéraires en Corée.
24 mai 2025

Freida McFadden, La Prof, roman traduit
de l’anglais par Karine Forestier, Paris, City Éditions, 2025, 392 pages, 36,95 $.
Thriller à l’intrigue débridée
J’ai rarement été rivé à mon fauteuil ou à mon lit en lisant un thriller. Freida McFadden a réussi ce tour de force en campant une singulière histoire d’amour enseignant-élève dans son roman La Prof. Attendez-vous à voir couler des larmes
et du sang…
Les trois principaux personnages de ce roman sont l’époux Nate, professeur d’anglais, 38 ans; l’épouse Eve, professeure de mathématiques, 30 ans; Addie, élève
de 16 ans qui excelle en anglais et qui est médiocre en mathématiques. Chaque chapitre est écrit au je par l’un d’eux.
Nate et Eve ont leur routine : « trois bisous par jour et des rapports sexuels une fois par mois ». Ils sont devenus des étrangers l’un pour l’autre. L’abîme qui les sépare s’élargit un peu plus chaque jour.
Eve se sent coincée dans ce qui lui apparaît de plus en plus comme un mariage sans amour. Elle n’a aucune chance d’être avec l’homme qu’elle aime vraiment. L’épouse se trouve un amant et l’époux se tourne vers des adolescentes.
Lorsque le père d’Addie est mort après avoir déboulé dans l’escalier et lorsqu’un prof est soupçonné d’avoir entretenu une relation avec Addie, cette dernière a prétendu avoir tout raconter à la police, « enfin, pas tout » parce qu’elle n’est pas complètement idiote. Selon la prof de mathématique, Addie est une fille perturbée.
L’adolescente est le souffre-douleur de l’élève la plus populaire et la plus canon du high school. Chaque fois qu’elle pense avoir vécu la pire journée de sa vie, le lendemain s’avère plus atroce encore. Les coups bas sont parfois d’une mesquinerie inouïe.
Nate invite Addie à joindre l’équipe qui publie une revue de poésie. Il lui fait un clin d’œil qui devient rapidement un regard séduisant; il lui donne un coup de main qui se transforme en une caresse. Le prof finit par avouer à l’élève qu’il ne s’est « jamais senti connecté avec quelqu’un comme avec elle ».
Et Addie dans tout ça? « Je pense exacte-ment la même chose. » La romancière Freida McFadden précise que Nate découvre pour la première fois son âme sœur à 38 ans, et elle n’a que 16 ans. Le prof lui remet ce poème :
La vie m’a presque échappé
Puis elle
Jeune et vivante
Avec des mains douces
Et des joues roses
M’a révélé à moi-même
M’a volé mon souffle
Avec des lèvres rouge cerise
M’a redonné la vie
À l’adolescence, il n’est pas rare de voir
un coup de foudre entre élève et prof. McFadden fait dire à Nate que la plupart
des gens ne comprennent pas ce que c’est que d’avoir de belles jeunes filles qui se jettent sur vous année après année, ajoutant « je ne suis pas de marbre »…
Personne ne connaît la véritable Addie ou ne soupçonne ses secrets qui pourraient détruire des vies. L’adolescente est prête à tout pour garder le silence. Et quand la prof de mathématiques commence à comprendre qui est véritablement son élève et ce qu’elle cherche à cacher, il est déjà trop tard…
La romancière Freida McFadden est
connue pour ses thrillers psychologiques, notamment la série La femme de ménage. Dans La Prof, ses rebondissements se logent à l’enseigne de l’imagination la plus débridée.
5 mai 2025

Alban Berson, Monstres et merveilles du monde : huit siècles de cartes ornées, essai, Québec, Éditions du Septentrion, 2025,
192 pages, 39,95 $.
Quand les cartes géographiques étaient
des viviers de symboles
Depuis environ 1180, des créatures occupent une place de choix sur
les cartes géographiques. Alban Berson dévoile le sens de ces serpents cosmiques, anges révoltés, dragons, sirènes, licornes et géants anthropophages dans Monstres et merveilles du monde : huit siècles de cartes ornées.
La cartographie, écrit Berson, « déploie une imagerie qui lui est propre et qui puise à des sources diverses : mythologie, religion, récits de voyage, sciences, techniques, réflexions théoriques et imaginaire créatif ».
Parfois, les ornements sont assimilables à des représentations dotées d’un signification univoque. Ainsi, le perroquet évoque l’Amérique; un visage joufflu, le vent.
Il arrive parfois que l’ornement soit
un symbole, « la synthèse picturale de significations pluridimensionnelles, équivoques et mêmes contradictoires ».
Il est d’abord question d’une mappemonde tirée d’un petit octavo manuscrit de la fin du XIIe siècle (circa 1180) produit chez
les Augustins d’Indersdorf en Bavière.
La Terre y est divisée en cinq zones climatiques parallèles encerclées par l’océan. Notre regard est happé par un serpent ceignant la Terre qu’il sépare des océans en avalant sa propre queue pour former un cercle complet.
La Carte de l’Atlas catalan, dressée par Cresques Abraham en 1375, présente un territoire s’étendant « des côtes scandinaves au nord au Sahara au sud et des îles Canaries à l’ouest à la mer de Chine à l’est ». Cela représente la totalité du monde alors connu.
C’est au Suédois Olaus Magnus qu’on doit
la Carte marine et description des pays septentrionaux et des merveilles qu’on y trouve, faite avec zèle et application en l’an du Seigneur 1539. Elle est célèbre pour ses ornements aussi captivants que foisonnants, et pour son exactitude de la représentation de l’Europe du Nord.
La Carte des Amériques de Diego Gutiérrez (1562) fait la part belle aux navires. Elle présente vingt-sept galions et caravelles, deux galères et un canot. Ces ornements sont une ode aux navigateurs de l’ère
des Grandes découvertes.
Les ornements de la carte America du Flamand Jodocus Hondius (1606) renferment une richesse documentaire : « Autochtones affairés autour d’un pot de terre ou sur des canons, oiseaux tropicaux, navires familiers ou plus exotiques et quelques monstres marins ». Cette iconographie contribue à étoffer la vision du Nouveau Monde au début du XVIIe siècle.
La Carte d’Amérique divisée en ses principaux pays, dressée par Jean Baptiste Louis Clouet en 1788, présente dans ses bordures vingt vignettes décrivant des évènements importants de l’histoire du continent tels que l’exploration du fleuve Saint-Laurent par Cartier ou la fondation
de Québec par Champlain.
La carte la plus moderne est d’Edward Everett Henry: The Voyage of the Pequod from the Book Moby Dick by Herman Melville (1956). Il reprend plusieurs éléments symboliques du roman comme le poing vengeur du capitaine Achab ou le cercueil servant de canot de sauvetage.
Alban Berson a consulté près de 200 ouvrages pour produire Monstres et merveilles du monde. Il réussit à nous convier à un voyage à travers des routes
de papier et des mers de parchemin.
23 avril 2025

Tamara Juric, Noirceurs de l’âme, nouvelles, Ottawa, Éditions L’Interligne, 2024, 86 pages, 22,95 $.
Huit nouvelles
d’une nouvelle autrice
Après un recueil de poèmes publié sur Amazon en 2020, la jeune auteure québécoise Tamara Juric fait son entrée aux Éditions L’Interligne (Ottawa) en lançant un recueil de nouvelles intitulé Noirceurs de l’âme, où la fantasy et le fantastique occupent une place de choix.
La principale différence entre la fantasy
et le fantastique réside dans le fait qu’un événement surnaturel ou magique soit
vécu comme une normalité dans un récit
de fantasy, alors qu’il fait peur dans un récit fantastique, car justement, il ne peut pas être expliqué.
On peut se demander si les personnages de Noirceurs de l’âme perdent la raison ou
s’il existe des forces surnaturelles qui les manipulent… Les huit nouvelles présentent au moins autant de personnages différents, colorés, que tout oppose. Autant de personnages à l’âme « sombre, sobre et glauque ».
Tamara Juric nous fait percevoir le plus subtil des bruissements de l’âme, et réussit instinctivement à faire reconnaître ce qui
le provoque. Elle ne se contente pas de tremper sa plume dans une fade encore noire, elle en choisit une de couleur
« dunes lunaires ».
Dans une nouvelle, un tsunami de gens se noient dans la terreur ambiante, face à un ennemi invisible, sans nom, et insaisissable. Ailleurs, un personnage est aspiré par une vieillotte machine à café et propulsé en 1855. Souvent, « dans la stratosphère du dépravé, le weirdo est majoritaire ».
Le style est très imagé. Pour décrire une boîte aux lettres, la nouvelliste écrit qu’elle « était piquée sur un poteau comme une cerise dans un martini », ajoutant que cette boîte « brillait d’une leur si maléfique qu’elle semblait avoir été forgée dans les flammes de l’enfer ».
En empruntant les mots à la nouvelle intitulée « Le style à l’encre rouge »,
je dirais que les docteurs n’ont jamais aimé Tamara Juric « parce que ça les renvoyait à leurs propres limites, à leur impuissance,
à leur incapacité de tout savoir, expliquer, cataloguer ».
L’écriture est la drogue de Juric. Quand
elle cisèle ses textes, l’autrice cherche à immortaliser une pensée, une sensation,
une impression, une émotion.
Je dois signaler que la mise en page de ce recueil est malheureusement ratée. Il n’y a pas de table des matières, il n’y a pas de titres courants. Les caractères sont trop petits et dans une fonte difficile à lire.
Les mots sont souvent trop tassés sur
une même ligne. C’est dommage, car tout
le pouvoir de l’imagination entre en jeu dans ces nouvelles.
17 avril 2025

Évelyne Ferron, Histoires de véhicules extraordinaires, album illustré par Jordanne Maynard, Montréal, Éditions Fides,
coll. Civilisations, 2025, 48 pages, 22,95 $.
Aller plus loin
et plus vite
Le cheminement des êtres humains est lié à leur déplacement. Évelyne Ferron l’illustre bien dans Histoires de véhicules extraordinaires,
un album dont l’objectif est
de mieux comprendre l’univers
dans lequel se trouve notre planète.
Elle présente 17 moyens de transport,
de la pirogue à la navette spatiale.
Ils s’échelonnent de la Préhistoire à l’Époque contemporaine, en passant par l’Antiquité,
le Moyen âge et l’Époque moderne.
Nos ancêtres étaient des chasseurs, mais aussi des pêcheurs. Pour rendre cette activité plus efficace, il faut s’éloigner du rivage. Ainsi naît la pirogue, simple tronc d’arbre creusé à la hache pour pouvoir s’asseoir au centre. La plus ancienne connue a été découverte aux Pays-Bas et date d’environ 9000 ans.
Pendant l’Antiquité, la civilisation d’Uruk, où se trouve l’actuel Irak, cherche à se déplacer plus rapidement sur les fleuves le Tigre et l’Euphrate. Elle invente le bateau à voile il y a plus de 5000 ans. Il va aussi servir à faire la guerre.
À la même époque, en Inde, on pose une simple boîte de bois sur deux roues reliées par un essieu pour inventer la charrette. Tirée par des bœufs ou des chevaux,
elle permet de déplacer des choses plus lourdes et plus rapidement.
Certains moyens de transport servent à montrer l’importance de la personne qui
les utilise. Le palanquin en est un bon exemple : cabine de bois rectangulaire avec fenêtres et siège confortable à l’intérieur, soulevée à l’aide de deux longues poutres
et portée par un minimum de quatre personnes. Les plus impressionnants remontent au Moyen Âge, il y a plus 1000 ans, en Chine.
Un moyen de transport aujourd’hui érigé dans des sites historiques fut d’abord associé à la guerre : le funiculaire il y a plus de 600 ans. L’un d’eux servait à approvisionner en armes et en équipements la forteresse de Hohensalzburg en Autriche.
L’être humain a toujours rêver de voler.
Ce sont un coq, un canard et un mouton qui ont été les premiers à s’envoler… à bord d’une montgolfière le 19 septembre 1783 au château de Versailles. Elle tient son nom
des frères Joseph et Étienne Montgolfier.
D’abord inventée en Angleterre il y a plus
de 200 ans, la locomotive à vapeur occupe une place très importante dans l’histoire.
On n’a qu’à penser aux colons américains qui ont pu étendre les frontières des États-Unis vers l’Ouest.
L’album d’Évelyne Ferron nous apprend que deux types de voitures ont été inventées avant l’automobile à essence, l’une à vapeur (1875), l’autre à batterie (1890). Avec l’arrivée du moteur à combustion, les automobiles
à essence (1875) sont devenues plus populaires, car elles offraient de meilleures performances.
Vous connaissez sans doute Joseph-Armand Bombardier, mécanicien québécois qui a fabriqué le premier véhicule sur chenilles doté de skis à l’avant et d’un moteur à essence. Il imagine l’autoneige dans
les années 1930 et la première motoneige
en série sort en 1959.
Sur terre, en mer ou dans les airs, l’humain peut aujourd’hui voyager partout grâce à toutes sortes de véhicules et aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. Les moyens de transport répondent depuis toujours au besoin de se nourrir, à la nécessité de transporter des marchandises, à l’envie de découvrir de nouveaux horizons, ou encore au plaisir de meubler ses loisirs.
7 avril 2025

Emrah Çoraman, Atlas des oiseaux, illustrations de Rubiye Ulusan et
traduction du turc par Melek Kaniyolu, Montréal, Éditions Québec Amérique,
coll. Documentaire jeunesse, 2025, 112 pages, 32,95 $.
Invitation à découvrir
le monde fascinant
des oiseaux
Voyagez sur sept continents et familiarisez-vous avec 52 espèces d’oiseaux grâce à l’Atlas des oiseaux préparé par Emrah Çoraman
et illustré par Rubiye Ulusan. Découvrez ainsi un monde
qui regorge de faits curieux
et fascinants.
Deux pages sont consacrées à chaque espèce. Une capsule précise son continent, son pays, sa taille, son poids, son nom scientifique et une caractéristique
(ex. : le pitohui bicolore est venimeux).
Pour l’Afrique, je m’arrête à l’autruche,
le plus grand et le plus rapide des oiseaux. Les bébés atteignent la taille d’un adulte
18 mois après leur éclosion. L’œuf de l’autruche est tellement solide que même si une personne pesant 100 kilos se mettait debout dessus, il ne se casserait pas. L’autruche vit dans des régions très chaudes comme la Namibie; elle ouvre son bec et déploie ses ailes pour se rafraîchir.
Place au faucon pèlerin pour l’Asie. Il est l’oiseau national des Émirats arabes unis.
Ses yeux peuvent voir 8 fois mieux que ceux des êtres humains, ce qui lui permet de repérer même les petits oiseaux à des kilomètres de distance. Sa plus haute vitesse enregistrée a été de 389 km à l’heure. Dans la mythologie égyptienne, le dieu du soleil Ra est représenté avec un corps humain et la tête d’un faucon pèlerin.
Le héron cendré est une espèce répandue dans l’ensemble de l’Europe. Il se nourrit
de tout ce qu’il peut attraper : insectes, grenouilles, serpents, souris, poissons et petits oiseaux. Le héron cendré peut ressembler à une cigogne lorsqu’il vole; mais alors que cette dernière garde son cou droit, le héron cendré le courbe pendant
le vol. Durant la saison de reproduction,
il arbore une longue crête noire, donnant l’impression qu’il s’est coiffé les cheveux en arrière.
Le cardinal rouge est un oiseau très répandu en Amérique du Nord. Les couleurs frappantes de ses plumes et son expression facile colérique attirent l’attention. Le rouge est unique au mâle, la femelle arborant plutôt des tons de bruns. Le mâle a une tache noire autour du bec, semblable à
un masque. Les petits sont nourris exclusivement d’insectes. Le cardinal rouge a un riche répertoire de chants pour protéger et défendre son territoire.
Pour l’Amérique du Sud et Centrale, j’ai choisi le colibri d’Elena, le plus petit oiseau de la planète, de 5 à 6 cm. Les mâles pèsent légèrement moins de 2 grammes, soit une pièce de 10 cents. Le colibri d’Elena vit uniquement à Cuba et se nourrit de nectar; il peut visiter 1 500 fleurs différentes par jour. Malgré son gabarit réduit, il peut battre des ailes de 50 à 80 fois par seconde. D’autres espèces de colibris sont parfois appelés oiseaux-mouches.
Vivant uniquement en Australie, l’oiseau-lyre est une espèce endémique de l’Océanie. Il tire son nom de l’instrument de musique puisque la forme des plumes de sa queue rappelle la silhouette d’une lyre. La pièce
de 10 cents australiens présente son image.
Le chant de l’oiseau-lyre peut être entendu à presque un kilomètre de distance. Plus
le répertoire du mâle est riche, plus il peut impressionner les femelles.
La patrie de l’albatros hurleur est l’Antarctique. La femelle pond seulement
un œuf tous les deux ans; la période d’incubation dure 11 semaines, soit la plus longue de toutes les espèces d’oiseaux.
Le calmar et le poulpe font partie des plats préférés de l’albatros hurleur. Il peut filtrer le sel de l’eau de mer et ainsi vivre pendant une longue période sans avoir besoin d’eau potable. On estime que l’albatros hurleur
vit environ 40 ans.
4 avril 2025

Suzanne Myre, Ils sont parmi nous, nouvelles, Longueuil, Éditions L’instant même, 2025, 200 pages, 25,95 $.
Importance des minous parmi nous
Camus, Embolie, Pluto, Iouri, Platonne, Bonbon, autant de chats qui jasent où font jaser dans Ils sont parmi nous, le nouveau recueil de nouvelles de Suzanne Myre.
La présence des minous est une occasion de parler de leurs maîtres, bien entendu.
Plusieurs nouvelles ont d’abord paru dans des revues comme XYZ, Moebius, Lettres québécoises, Zinc, Virages ou Les écrits.
Dans la préface, Suzanne Myre signale son « jeu de mot moyen » (que je n’avais pas
le moindrement remarqué) : Ils sont parmi nous, parmi nous, minous.
Un contenu lubrique assaisonne plusieurs de ces 21 nouvelles. Le texte intitulé « James, bande James ! » peut faire penser à James Bond, mais le James ici est un mari qui ne bande plus. On y lit que la compagnie
d’un chat peut devenir la réponse à toutes les femmes frustrées par les hommes.
Les ébats ou leurs tentatives donnent lieu à un joli jeune de mot : « Cet homme m’avait plus souvent masturbée que mes dix-neuf amants précédents mis à la queue leu leu. »
« De haut en bas, de gauche à droite,
vu de dos et de profil », le narrateur d’une nouvelle est extrêmement laid, tellement que même les chats détalent à son approche. Un soir, il se promène dans
le Village gai et rencontre un homme qui l’excite, un homme qui veut lui montrer ses tatouages, après avoir nourri Iouri. Son corps est couvert de visages laids que le narrateur explore passionnément pour se faire répondre : « Je t’ai longtemps cherché. »
Dans « Bisbille à Rosemonthill », Mafilda interdit à son mari de fumer la pipe car cela empoisonne Platonne, une chatte siamoise transgenre. Pas question de « pomper sa pipe ». Y voyez-vous un double sens? Quant à Platonne, elle se pourlèche de foie de Périgord prélevé de la réserve du mari.
La nouvelle « Tétée salvatrice » commence par un accouchement. La narratrice se plaint d’avoir maintenant des varices et vergetures. Le bébé ne fait pas ses nuits, alors elle non plus. Impatiente, la mère se venge à coups de pieds sur le chat. « Je ne sais pas pourquoi je ne m’en suis pas contentée. Il ne m’aurait pas déformé
les hanches, lui. »
Suzanne Myre entrecoupe parfois une nouvelle de recommandations sur les bienfaits d’avoir un chat. On y apprend que leur présence augmente notre espérance de vie et chasse les mauvais esprits dans une maison. « Il paraît que le ronronnement
du chat réduit le stress et apaise le rythme cardiaque. » On rencontre même le chat Bonbon qui est doué pour abaisser
la pression sanguine.
L’auteure glisse aussi quelques remarques sur l’écriture. Elle signale que la nouvelle correspond à une manière nerveuse de s’exprimer. Myre note que recevoir un prix et un chèque constitue « un certificat
de santé littéraire ». Elle est d’avis que
la présence d’un chat dans un texte est
de nature à séduire un éventuel lectorat féminin. Enfin, l’auteure rappelle que Michel Lord (anciennement de l’Université de Toronto) « a passé sa vie à étudier et louanger le style de la nouvelle ».
Si les êtres humains dont parle Suzanne Myre sont exaltés, amoureux, désagréables ou encore capables des sentiments les plus nobles, la présence continue des chats nous ramène toujours au quotidien banal, à ce qui nous unit dans un univers éclaté.
28 mars 2025

Benoit Prieur, Acadie et Provinces maritimes, guide mis à jour par Annie Gilbert, Montréal, Guides Ulysse, 2024, 288 pages, 26 cartes, 29,95 $.
Invitation à savourer l’extrême est du Canada
Au Canada, les provinces maritimes forment une région pittoresque qui conjugue la splendeur de milliers
de kilomètres de paysages côtiers
à de riches traditions locales et à
un art de vivre fascinant. Pas étonnant que les Guides Ulysse aient récemment publié une mise à jour d’Acadie et Provinces maritimes.
Précisons, au départ, que les provinces maritimes canadiennes sont le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Les côtes de ces trois provinces baignent dans le golfe du Saint-Laurent ou dans l’océan Atlantique.
L’Île-du-Prince-Édouard est la plus petite de toutes les provinces canadiennes; elle compte la plus haute densité de population au pays, soit 30 habitants au kilomètre carré.
Le guide nous invite à visiter :
- 7 endroits pour sortir des sentiers battus, dont la réserve du parc national de l’Île-de-Sable (N.-É.);
- 8 endroits et événements pour les passionnés de culture, dont le Festival international de musique baroque de Lamèque (N.-B.);
- 9 plages pour la baignade et le farniente, dont la plage de l’Aboiteau près de Cap-Pelé (N.-B.);
- 10 endroits pour découvrir les traditions maritimes, dont l’Éco-Musée de l’huître à Caraquet (N.-B.);
- 11 activités pour les amateurs de sports, dont le kayak de mer autour de l’île du Cap-Breton (N.-É.);
- 12 occasions d’aller à la rencontre de
la culture acadienne, dont le Pays de
la Sagouine à Bouctouche (N.-B.);
- 13 lieux pour revivre la riche histoire de la région, dont le Lieu historique national de Port-Royal (N.-É.);
- 14 attraits pour les amants de la nature, dont le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton(N.-É.);
- 15 endroits où prendre des photos mémorables, dont Peggy’s Cove (N.-É.).
Dans la section Art et culture du guide,
on apprend que « c’est en Acadie qu’est présentée en 1606 la toute première pièce de théâtre en Amérique du Nord :
Le Théâtre de Neptune, de Marc Lescarbot ». On souligne que La Sagouine d’Antonine Maillet a été incarnée par Viola Léger (1930-2023) plus de 3 000 fois partout
au Canada.
Un encadré donne quelques exemples
du français acadien. Voici des expressions typiques : être bénaise (heureux, content), espérez-moi un p’tit élan (attendez-moi
un instant), paré (prêt), marionnettes (aurores boréales), mitan (milieu, centre).
Le guide fournit un lexique français-anglais d’environ 400 mots ou expressions traitant aussi bien de magasinage ou d’hébergement que de température ou de gastronomie.
Agrémenté de splendides photographies, Acadie et Provinces maritimes suggère
une panoplie de découvertes et de coups
de cœur. Ce guide finement architecturé offre aussi des conseil pratiques et inclut une trentaine de cartes très précises pour mieux y organiser ses déplacements.
14 mars 2025

Collectif, Le Québec à pied, 50 itinéraires
de rêve, Montréal, Guides Ulysse, 2025,
208 pages, 51 cartes, 39,95 $.
Contempler le Québec
sans lui nuire
Troquer son empreinte carbone pour une kyrielle de circuits pédestres, voilà ce que Le Québec à pied,
50 itinéraires de rêve, offre aux amateurs de marches pèlerines,
de promenades contemplatives, d’itinéraires urbains ou de longues randonnées dans l’arrière-pays.
Le collectif de ce guide Ulysse propose des itinéraires allant de 1 à 24 jours, de 4 à
478 km. La plus courte excursion couvre l
es lieux de culte du quartier historique et centre-ville de Montréal; la plus longue propose une exploration de la voie du Saint-Laurent, de Sainte-Luce-sur-Mer
à Percé.
Règle générale, les parcours comptent de
15 à 20 km par jour. Il est souhaitable de s’entraîner plusieurs semaines avant
le départ en marchant avec un sac à dos d’un poids équivalent à celui que vous apporterez, incluant l’eau et la nourriture.
Pour tester sa capacité physique et son équipement, le guide invite à parcourir
la distance entre Ottawa et Montréal, soit
Le chemin des Outaouais. Ce trajet de village en village d’un côté et de l’autre de la rivière des Outaouais, frontière naturelle séparant l’Ontario et le Québec, réserve de nombreuses possibilités d’hébergement,
de restauration et de ravitaillement.
Les 50 itinéraires de rêve se répartissent comme suit : 19 chemins de marche pèlerine, 6 promenades contemplatives,
10 marches urbaines et 15 longues randonnées dans l’arrière-pays. Pour chacun d’eux, le guide indique le niveau
de difficulté à prévoir (sur une échelle de
1 à 5).
Parmi les chemins de marche pèlerine,
je retiens Le P’tit Train du Nord, entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier. Cette ancienne voie ferrée a été transformée en large piste cyclable et piétonnière, qui s’étend sur plus de 200 km. Les étapes incluent Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Tremblant et Labelle.
Dans les promenades contemplatives, il y a l’île d’Orléans, l’île Perrot, l’île aux Coudres et l’île aux Lièvres. Je choisis de vous signaler un trajet du Québec à pied commence au… Nouveau-Brunswick. Il s’agit du Petit-Témis, un parcours de 134 km en
6 jours, qui retrace l’ancienne voie ferrée reliant Edmundston et Rivière-du-Loup.
Six des dix marches urbaines ont lieu à Montréal. L’écrivain en moi opte pour Trois-Rivières, ville de poésie et d’histoire. L’itinéraire de deux jours (21,4 km) s’étend du Musée Pop/Vielle Prison au Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice, en passant par le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
Malgré son nom, les longues randonnées dans l’arrière-pays varient entre 2 et 7 jours seulement. La plus courte (18 km) permet d’explorer le parc national du Mont-Mégantic; la plus longue (103 km) offre une traversée de Charlevoix, de refuge en refuge.
Ce guide truffé de photographies inspirantes s’accompagne de plans et d’encadrés qui dévoilent des anecdotes ou des coups de cœur partagés par les membres du collectif.
En encourageant le voyage local, doux pour la planète et pour soi, Le Québec à pied nous accompagne, du rêve à l’élan, dans
le choix de l’aventure qui nous convient
afin d’embrasser cette activité simple et accessible qu’est la marche, et dont
les bienfaits sont aussi nombreux que
les chemins pour explorer la Belle Province.
5 mars 2025

Marielle Brie de Lagerac, L’Art de l’objet.
Une histoire culturelle de notre quotidien, essai, Paris, Éditions Pyramyd, 2024,
272 pages, 57,95 $.
Passer du matériau et
de la forme à l’esthétique
Connaissez-vous l’origine des cloches et grelots, des œufs de Pâques, de l’échiquier ou même des godemichets ? Dans L’Art de l’objet, Marielle Brie de Lagerac propose l’histoire culturelle de 50 objets avec lesquels nous cohabitons sans véritablement les connaître.
« De la cuisine à la salle de bains, du cabinet de curiosités feutré aux plaisirs ensoleillés du jardin d’été, en passant par
les festivités qui rythment le décor
des maisons, les objets inscrivent leurs propriétaires dans une histoire vaste, intime, publique et inattendue. »
Pour la cuisine, l’autrice lève le voile sur
la bouteille, la poêle, le pot de confiture, la chocolatière, le panier et le balai. On y apprend que l’art fragile du verre (bouteille) naît en Orient avec l’invention de la canne
à souffler au 1er siècle avant notre ère. Quant à la poêle, elle a bel et bien existé de la Mésopotamie à la Grèce antique, parfois richement ornementée.
Marielle Brie de Lagerac écrit que « cloches et grelots sont le prélude à l’immanence de l’inhabituel dans l’environnement quotidien. Les deux sont l’apanage de personnages équivoques et inquiétants : le Diable, le Père Noël ou encore le terrifiant et fantomatique Hellequin (mythique chasseur à cheval). » Depuis fort longtemps, leur tintinnabulement annonce l’inhabituel et l’extraordinaire.
Au sujet de l’échiquier, l’autrice note que
les plus anciens jeux de plateau connus à
ce jour ont été découverts dans la région
du croissant fertile, en Mésopotamie, et sont datés du VIIIe siècle avant notre ère. « L’homme n’avait pas encore inventé
le tour de potier qu’il jouait déjà. »
La décoration des œufs est associée à Pâques. Vous faites sans doute le lien
entre œuf (vie) et résurrection (Jésus).
De nombreux œufs décorés ou incisés ont été trouvés lors de fouilles. Cela remonte aussi loin qu’aux « œufs déposés dans
des tombes sumériennes, comme celui découvert à Ür et daté de la dynastie archaïque III (vers 2600-2340 avant
notre ère) ».
L’objet qui pique votre curiosité est sans doute le godemichet. La pièce de théâtre Lysistrata, d’Aristophane (446-386) y fait référence. La ville de Milet (Grèce) encourageait les respectables citoyennes à user de l’olisbos (nom donné à ce jouet singulier) pour préserver leur réputation
en leur « évitant d’aller folâtrer ailleurs
que dans le lit conjugal ».
Comme le souligne l’autrice de L’Art de l’objet, un inconscient culturel s’ancre profondément lorsque la maîtrise du matériau et celle de la forme s’amalgament à l’esthétique et au symbolisme ».
Diplômée en histoire de l’art en France et
en Italie, Marielle Brie de Lagerac se spécialise pour le marché de l’art chez Christie’s et à l’Hôtel Drouot. Cette enseignante est l’autrice de recherches et d’articles spécialisés pour les institutions
et le secteur privé, en France et au Japon, rédactrice de la chronique du Glossaire
de la Gazette Drouot, et intervenante pour Radio France et le groupe France Télévision.
16 février 2025

Bertrand Galic et Jandro, Marcel Cerdan,
le cœur et les gants, bande dessinée, Paris, Éditions Delcourt, coll. Coup de tête, 2024, 104 pages, 38,95 $.
Une lecture KO sur
le boxeur Marcel Cerdan
Quand j’ai vu le nom Marcel Cerdan, je n’avais pas la moindre idée
qu’il s’agissait d’un boxeur, voire d’une légende du sport français.
Je vous invite à le découvrir avec Bertrand Galic au scénario et Jandro aux dessins et à la couleur dans Marcel Cerdan, le cœur et les gants.
Marcel Cerdan est né le 22 juillet 1916 à Sidi Abbès, en Algérie française. En 1922, il suit sa famille au Maroc, alors sous protectorat français. Il ne jure que par le football,
mais son père le dirige manu militari vers
la boxe.
Ballotté entre un père autoritaire et une mère courage, le petit Marcel n’a que 8 ans lorsqu’il combat pour la première fois,
à Casablanca. Entre 1924 et 1949, ce boxeur émérite participe à 114 combats officiels.
Il totalise 110 victoires, dont 65 par KO.
Le parcours de Marcel Cerdan est raconté en détails et illustré de dessins où les couleurs sombres priment : noir, gris, brun, ocre, roux, bleu acier. Jusqu’ici, aucun album de bande dessinée n’avait été consacré à Marcel Cerdan. Un seul roman a abordé sa vie : Constellation d’Adrien Bosc.
À 19 ans, Marcel perd sa mère. Avant chaque combat, il murmurait toujours « p’tite maman, fais-moi gagner ». Au fil des victoires, le boxeur devient le bombardier marocain, une icône de la résistance antifasciste. Quelques dessins illustrent Herr Cerdan qui affronte le Kommandantur.
En 1946, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Marcel rencontre Édith Piaf. Débute alors une idylle passionnée entre l’enfant pauvre de Casablanca et l’artiste de rue. Le seul film sur la vie de Cerdan est Édith et Marcel de Claude Lelouch.
La carrière du boxeur se lit comme livre
de records. Il est champion de France poids welters (1938-1941), champion d’Europe poids welters (1939-1942), champion de France poids moyens (1945-1946), champion d’Europe poids moyens (1947-1948) et champion du monde poids moyens (1948-1949).
Sa vie d’une intensité folle sera toutefois brève puisqu’il meurt tragiquement, au sommet de la gloire, lors de l’accident du vol Paris-New York survenu dans la nuit
du 27 au 28 octobre 1949 dans l’archipel
des Açores. Il n’a que 33 ans.
Jusqu’ici, aucun album de bande dessinée n’avait été consacré à Marcel Cerdan. Je ne suis pas un amateur de bandes dessinées, mais force est de reconnaître que Bertrand Galic s’est appuyé sur des faits historiques précis pour nous raconter avec brio la vie du plus grand boxeur français de tous
les temps.
En volant le jeu de mot à un critique français, je peux affirmer que les dessins coups de poing de Jandro réussissent à
offrir une lecture qui risque de mettre plus d’un lecteur knock out!
6 février 2025

James Patterson et Maxime Paetro, 21e anniversaire, roman traduit de l’anglais par Carole Delporte, Paris, Éditions JC Lattès, coll. Women’s Murder Club, 2024, 368 pages,
37,95 $.
Thriller complexe
et compliqué
James Patterson est l’auteur de thrillers le plus lu au monde, avec au-delà de 300 millions de livres vendus. Après 20 enquêtes du Women’s Murer Club, il nous livre 21e anniversaire, un thriller où
les jurés auront à discerner le vrai meurtrier à travers un écran de mensonges entourant un père
et son fils.
Lorsqu’une mère désemparée demande à Cindy Thomas, journaliste au San Francisco Chronicle, d’enquêter sur la disparition de
sa fille Tara et de sa petite-fille Lorrie,
Cindy fait immédiatement appel au sergent Lindsay Boxer du San Francisco Police Department, à Claire Washburn, médecin légiste et à l’assistante du procureur Yuki Castellano. C’est quatre femmes forment
le Women’s Murder Club.
21e anniversaire comprend 119 chapitres, souvent de 2-3 pages seulement.
Cela donne à la lecture un rythme, un ton saccadé, qui nous tient en haleine. Il ne
faut pas plus de quelques chapitres pour découvrir le meurtre de la petite Lorrie,
puis celui de sa mère Tara, juste avant
son 21e anniversaire.
Le principal suspect est le mari de Tara, Lucas Burke. Ce prof d’anglais dans
une école secondaire dépeint Tara comme une épouse volage et non comme
une personne disparue. Est-ce un cas tragique de violence domestique ? C’est plus complexe, car une troisième victime s’ajoute à Lorrie et Tara : la jeune maîtresse de Lucas.
Après examen des corps, la médecin légiste est formelle. Quel que soit le mobile, l’assassin est calculateur et manipulateur. « Il tue de manière délibérée, avec précision et fourberie. Ce type ne ressent pas l’amour. Ni la haine. Il aime tuer des femmes. »
Si Lucas Burke est le tueur, il est extrêmement rigoureux. Trop. Et c’est inquiétant. Les meurtres suivent le schéma suivant : gorge tranchée accompagnée
d’une constellation d’entailles sur les seins. Les quatre amies du Women Murder Club auront besoin les unes des autres pour démêler la vérité d’un véritable tissu
de mensonges.
Lindsay Boxer dirige l’enquête. Elle déteste rester dans les clous et suivre le règlement à la lettre. Boxer se sent en droit d’aller à l’encontre d’un ordre direct. Son partenaire de longue date est du même avis. Il s’agit
de l’agent Conklin, « le frère que je n’avais jamais eu, l’ami à qui je confiais ma vie comme il me confiait la sienne ».
J’ai mentionné au tout début un écran de mensonges entourant un père et son fils. Evan Burke est prêt à avouer les meurtres dont son fils Lucas est accusé. Il se prétend serial killer et n’hésite pas à abattre une jeune catin quand la police se présente.
21e anniversaire est un thriller complexe
et compliqué. Attendez-vous à voir deux hommes tordus vriller le cerveau de Lindsay Boxer et Yuki Castellano durant
le procès, sans parler du brillant avocat de la défense.
27 janvier 2025

Kathleen Perricone, Taylor Swift, le guide ultime, essai traduit par Laura Ance et illustré par Adrian Valencia, Paris, Éditions Larousse, 2024, 160 pages, 33,95 $.
Avez-vous un statut
de Swiftie irréprochable ?
Une seule chanteuse peut se targuer d’avoir plus de 200 millions de Swifties à travers le monde! Dans Taylor Swift, le guide ultime, Kathleen Perricone explore
les sources d’inspiration et l’univers kaléidoscopique de l’artiste la plus populaire et la plus influente
de sa génération.
Née le 13 décembre 1989 à Reading (Pennsylvanie), Taylor Alison Swift est
une autrice-compositrice-interprète américaine, ainsi qu’une actrice et réalisatrice de clips musicaux. La sortie
de son premier album intitulé Taylor Swift (2006) lance sa carrière en Amérique du Nord dans le genre country alors qu’elle n’a que seize ans.
«Selon un sondage datant de 2023, plus
de la moitié des adultes aux États-Unis se considèrent comme des Swifties. Pami eux, 23% sont des baby-boomers, nés entre 1946 et 1954. Taylor Swift transcende les âges
et donne à tous le sentiment d’avoir éternellement vingt-deux ans.»
Le tiers du livre est consacré à la produc-tion des onze albums en studio entre 2006 et 2024: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, folklore, evermore, Midnights et The Tortured Poets Department. Cela comprend exactement
205 chansons.
«Le public dispose d’une discographie intemporelle traitant d’amour, de décon-venues, d’amitié, de famille, de rivalités et d’une vengeance mythique, mais aussi de
la difficulté de grandir, du temps qui passe et des retours de karma.»
En déchiffrant les messages cachés et autres indices que l’artiste distille entre les lignes de ses 205 chansons, Kathleen Perricone fait en sorte que Taylor Swift n’aura bientôt plus aucun secret pour vous.
Pour chaque album, le guide indique
les records battus. Voici quelques exemples :
- Taylor Swift (2006), il est sept fois disque platine (avec l’équivalent de 7 millions d’albums vendus) et fait de Taylor Swift
la première artiste country solo à écrire ou coécrire la totalité d’un premier album certifié platine.
- Fearless (2008), Swift devient la plus jeune artiste (20 ans) à remporter
un Grammy Award.
- Speak Now (2010) se vend à 1 047 000 exemplaires la semaine de sa sortie, ce qui en fait l’album le plus vendu en une semaine par une artiste féminine country.
- Red (2012) passe sept semaines à la première place du Billboard 200.
- folklore (2020) bat le record du monde Guinness de l’album d’une artiste féminine
le plus streamé le jour même de sa sortie (10,6 millions sur Spotify).
- Midnights (2022) est l’album le plus écouté les premières 24 heures, avec 186 millions de streams.
En 2023, Taylor Swift est nommée personnalité de l’année par le magazine Time, tout un honneur pour une vedette
de 34 ans!
Le dernier chapitre du guide présente non pas un horoscope mais un Taylorscope.
Né sous le signe du Capricorne, j’apprends que mon ambition n’a aucune limite, que
je fonce sans jamais m’arrêter.
«Une fois ton objectif fixé, rien ne peut t’en détourner, qu’il s’agisse de te procurer
des billets pour l’Eras Tour ou d’attirer l’attention de l’objet de ton désir. Si tu étais une chanson, tu serais Vigilante Shit.»
Taylor Swift, le guide ultime, révèle tout ce qu’il faut connaître pour prétendre au statut de Swiftie irréprochable!
15 janvier 2025

Ken Follett, Peur blanche, roman traduit de l’anglais, Paris, Les Éditions Retrouvées, 2024, 528 pages, 24,95 $.
La chaleur des personnages d’un roman glacial
Un vent de panique souffle sur
la Grande Bretagne lorsqu’un échantillon d’un puissant virus disparaît d’un laboratoire le jour
de Noël. S’installe alors
une Peur blanche, titre du roman
de Ken Follett.
Originaire du Pays de Galles, Follett a publié quelque 35 ouvrages vendus à plus de 195 millions d’exemplaires. Son roman Whiteout paraît d’abord en 2004 chez Macmillan Publishers. Un an plus tard, les Éditions Robert Laffont publie Peur blanche,
une traduction établie par Jean Rosenthal.
En 2024, Laffont autorise Les Éditions Retrouvées à publier une version en plus gros caractères. C’est celle-là que j’ai lue. Étrangement, le nom du traducteur n’y est pas mentionné.
Le virus en question est Madoba-2 et
le laboratoire est Oxenford, en Écosse.
Entre les mains de terroristes, ce virus peut devenir l’une des armes biologiques les plus efficaces qui soit, contaminant une ville en quelques heures et entraînant la mort de tous ses habitants.
Antonia Gallo (Toni), ex-flic devenue chef de la sécurité du laboratoire Oxenford, dispose de 48 heures pour retrouver
sa trace. Craignant le pire, Toni se rend aussitôt chez Stanley Oxenford, patron du laboratoire.
Le piège se referme aussitôt sur elle.
Les criminels l’ont non seulement devancée, ils séquestrent déjà le patron et sa famille afin de leur extorquer des informations.
Les heures sont comptées. Tandis qu’au-dehors la tempête de neige fait rage, Toni doit agir vite. Qui sont les preneurs d’otages? Que veulent-ils? Commencent alors les quarante-huit heures les plus explosives de son existence…
Tel un chercheur observant des souris
dans leur cage, Ken Follett s’est penché sur ses personnages pris en otages pour en dresser des portraits d’une saisissante acuité. Pour pondre un thriller magistral et convaincant, il a visité deux laboratoires d’un haut niveau de sécurité, notamment
le Centre scientifique canadien pour
la santé humaine et animale de Winnipeg.
L’action de Whiteout se déroule sur deux jours seulement : la veille de Noël et le jour de Noël. Un épilogue nous projette dans
le temps, environ un an plus tard. Si vous figurez parmi les fans du genre thriller,
une lecture captivante vous attend.
Follett excelle dans l’art de mettre en scène ses personnages. Il nous pousse à nous soucier d’eux tous, les bons comme
les méchants. Tous les personnages, sans exception, sont frais et excitants. Le roman suit plusieurs points de vue et contribue
à une lecture dynamique.
L’auteur développe si bien ses personnages que nous recherchons la valeur, la chaleur, le bénéfice ou l’avantage que chacun d’eux peut apporter, peu importe de quel côté
de la clôture ils se situent.
Petit conseil : vous feriez mieux de sortir vos couvertures avant de lire ce roman,
car les personnages se débattent dans
une tempête de neige pendant une bonne partie du livre. Vous pourriez avoir froid
en lisant certaines descriptions.
4 janvier 2025

Anne Jacobs, Café Engel, les années fatidiques, roman traduit de l’allemand
par Corinna Gepner, Paris, Éditions Harper Collins, 2024, 592 pages, 36,95 $.
Vivre au rythme des espoirs et des passions
Les gens qui n’ont pas été tués par la guerre continuent souvent d’en être hantés bien après le retour de
la paix. Voilà le nuage qui plane sur les personnages que la romancière allemande Anne Jacobs met en scène dans Café Engel, les années fatidiques. Le soleil de l’amour réussira-t-il à chasser
cette ombre…?
La Seconde Guerre mondiale est terminée. Nous sommes à Wiesbaden (Allemagne) en 1951. Tandis que la ville se relève lentement de ses décombres, un grand nombre de gens se retrouvent entre amis, s’accordant parfois une pâtisserie au Café Engel.
Ce café est situé dans le quartier des thermes, juste en face du théâtre national.
Il a été le premier à s’implanter à quelques pas du bâtiment thermal et des colonnades. Il aime faire les choses en grand, surtout qu’un café rival vient d’ouvrir ses portes juste à côté.
Le Café Engel est tenu par la famille Koch depuis des décennies. La fille Hilde tente
de convaincre ses parents de rénover l’entreprise familiale, mais ses ambitions se heurtent à celles de son mari français Jean-Jacques.
Son frère August n’est pas mieux loti. Lorsqu’il rentre enfin de Russie où il était retenu prisonnier, il n’est pas seul.
À ses côtés se trouve une femme russe dont l’arrivée menace de déchirer la famille…
Dès les premières pages, quelques mots apparaissent en caractères italiques et une note indique qu’ils sont en français dans
le texte original allemand. Cela se produit très fréquemment lorsque Jean-Jacques entre dans la discussion.
Voici quelques exemples : ma petite colombe, je l’aime tant, c’est si loin d’ici,
mon chou, petit coq, plus vite, c’est une chance qu’il faut saisir, quelle bonne idée,
de temps en temps, pommes frites, mais bien sûr, ma chérie.
À travers une histoire peu compliquée, Anne Jacobs décrit comment beaucoup de gens pensaient ne jamais pouvoir se débarrasser des cruels souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. On voit des personnages reprendre une sensation qu’ils croyaient à jamais perdue, « cette légèreté qui accompagne le bonheur, […] l’impression
de planer au-dessus du sol au lieu d’être écrasé par un sombre fardeau ».
Il y des intrigues amoureuses, bien entendu. Et Éros, le petit effronté avec son carquois et ses flèches, sait atteindre un couple en plein cœur. Dieu seul sait ce qui adviendra de tout cela.
Ce ne sont plus les terribles images de
la guerre qui empêchent un amoureux de trouver le sommeil. À présent, ce sont
le trouble et l’émoi. « Soudain, l’avenir lui paraissait digne d’être vécu. »
Autour de l’emblématique Café Engel gravitent des musiciens, des artistes, des acteurs, pour le plus grand plaisir des Koch et de ses habitués. Secrets, passions et espoirs animent les uns et les autres dans
ce roman choral bien étoffé. On assiste à une douce et joyeuse célébration de la vie.
Autrice dont on ignore le véritable nom, Anne Jacobs est une écrivaine née en Allemagne en 1941. Elle a écrit plus de
80 romans, dont la majorité sont des sagas historiques ou des histoires familiales. Vendue à plus de trois millions d’exemplaires, sa série La Villa aux étoffes
l’a propulsée au rang d’autrice best-seller, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.
24 décembre 2024

Rick Mofina, Son dernier adieu, roman traduit de l’anglais par Pascal Raud, Montréal, Éditions Alire, 2024, 472 pages, 29,95 $.
Brillant polar de
l’Ontarien Rick Mofina
Un couple qui vit des moments difficiles, une épouse qui disparaît, des soupçons qui pèsent sur le mari, une preuve irréfutable de décès qui s’avère fausse, autant de pistes qui confèrent au roman Son dernier adieu, de l’Ontarien Rick Mofina,
le titre de véritable page-turner.
Alors que le soleil se lève sur la grande région de Buffalo, Greg Griffin n’a pas
le choix; il doit appeler la police et signaler la disparition de sa femme Jennifer, qui n’est pas rentrée après la réunion de son club
de lecture le soir précédent. Une vaste campagne de porte-à-porte dans la région ne donne aucun résultat probant.
Greg est soumis à des empreintes digitales, au polygraphe et à un test d’ADN; ses appareils électroniques sont perquisitionnés et son domicile est passé au peigne fin.
On lui dit que tout cela est fait au nom de « la procédure habituelle ». Le mari estime pour sa part que les détectives savent quelque chose qu’ils ne lui révèlent pas…
Pour collecter des preuves irréfutables,
la police suit plusieurs indices dans divers États, espérant pouvoir dévoiler la vérité.
Or, cette dernière semble devenir plus floue à chaque rebondissement. Rick Mofina termine souvent un chapitre sur une phrase qui accentue le suspens.
Le mystère entourant l’affaire de la femme disparue à Buffalo s’épaissit. D’un rebon-dissement à l’autre, l’enquête ressemble à des poupées russes. Un brouillard irréel de tourments enveloppe Greg et son fils de
6 ans, refusant de se dissiper de leurs vies.
Un des rebondissements est de taille colossale. Une femme trouve la mort en courant sur une autoroute à Cleveland, frappée par un camion-citerne qui embrase les lieux. Des tests d’ADN démontrent qu’il s’agit de Jennifer. Les funérailles ont lieu et, quelques chapitres plus loin, on apprend qu’il ne s’agissait pas de Jennifer.
L’auteur laisse souvent ses détectives réfléchir tout haut. On apprend qu’il est crucial de garder l’esprit ouvert à tous
les scénarios. « Si l’histoire nous a bien montré quelque chose, c’est qu’il y a trop d’affaires dans lesquelles l’enquête est
restée ciblée sur le mauvais suspect. Nous n’écartons rien ni personne. Nous suivons les indices, où qu’ils nous mènent. »
Il est aussi dangereux de formuler
des conclusions puis de tenter de faire concorder les faits. Cela s’avère assez difficile, ici, car chercher Jennifer équivaut
à vouloir essayer d’attraper le vent. Quant
à Greg, les enjeux sont multiples. S’il veut retrouver sa femme et sauver son mariage,
il doit d’abord prouver son innocence, et chasser les démons qui le hantent.
Le roman renferme quelques échanges de textos qui donnent une touche familiale intéressante. Ainsi, une détective écrit à s
on fils d’être plus gentil avec son petit frère. Il accepte en demandant si on peut avoir de la pizza pour souper. La réponse : « – Avec des ailes de poulet? – Oui! »
On a déjà écrit que le succès d’un roman policier dépend du bon dosage entre pouvoir, argent et sexe. Mofina inclut
un personnage qui est dévoré par une faim insatiable de femmes. « De vraies femmes à l’état sauvage. » Jennifer figure dans sa mire, bien entendu.
À la fin du livre, dans ses remerciements, Rick Mofina s’adresse aux lecteurs : « sans vous, le récit ne prendrait jamais vie et resterait une histoire jamais racontée. Merci de mettre votre vie sur pause pour faire
le voyage. »
Né à Belleville, Ontario, Mofina a travaillé au Toronto Star avant d’embrasser la carrière de journaliste au Ottawa Citizen, au Calgary Herald et à l’agence Southam News. Depuis son premier roman en 2000, il a publié
une trentaine de titres distribués dans plus de vingt pays.
13 décembre 2024

Évelyne Ferron, Histoires d’inventions épatantes, album illustré par Jordanne Maynard, Montréal, Éditions Fides,
coll. Civilisations, 2024, 48 pages, 22,95 $.
Toujours améliorer
notre quotidien
Quelles soient prodigieuses ou ludiques, les inventions ne sont jamais inutiles. On n’a qu’à penser à l’imprimerie, aux lunettes, à l’aiguille à coudre, au piano, aux dés à jouer ou au beurre d’arachides. Évelyne Ferron nous éclaire sur le sujet dans Histoires d’inventions épatantes.
Les humains sont de si extraordinaires inventeurs qu’ils améliorent depuis toujours leur quotidien. Au fil des siècles, ils ont conçu des outils pour se nourrir efficace-ment, ont construit des machines pour mieux communiquer entre eux et ont
même élaboré des jeux pour se divertir.
L’agriculture a permis à nos ancêtres de devenir sédentaires et de cultiver pour se nourrir. Ils ont dû trouver une manière
de conserver leurs récoltes et d’éviter que les souris les mangent. « C’est pour cette raison qu’ils fabriquent les premiers pots. Certains historiens pensent même que
le plus ancien métier au monde est celui
de potier! »
Pour mieux comprendre les différentes façons de vivre des civilisations et expliquer leur évolution, les historiens divisent l’histoire de l’humanité en cinq grandes périodes, qu’on appelle aussi des époques.
1. Préhistoire : plus de 3 millions d’années à environ 3500 avant notre ère;
2. Antiquité : environ 3500 ans avant notre ère à 476 de notre ère;
3. Moyen Âge : de 476 à environ 1492;
4. Époque moderne : de 1492 à 1789;
5. Époque contemporaine : de 1789 à aujourd’hui.
Évelyne Ferron présente quelques inventions pour chacune de ces époques,
17 en tout et partout. Jordanne Maynard
les illustre avec brio. Dans le cas de
la Préhistoire, il est question de l’aiguille
à coudre et du filet de pêche.
L’Antiquité connaît un grand nombre d’inventions, dont l’écriture, les dés à jouer, les momies et l’éventail pliable. C’est au Japon que ce dernier voit le jour. Les pliures du papier sont inspirées par les ailes des chauves-souris. L’éventail pliable est alors un objet de luxe, dont le manche est fait d’ivoire ou d’ébène. Il est réservé aux gens les plus riches, qui font peindre des paysages sur le papier.
Le Moyen Âge est évidemment connu pour l’invention de l’imprimerie. On doit aussi à cette période les lunettes, le parfum et le cerf-volant. C’est en Italie qu’on a découvert comment travailler le verre de manière à créer des lentilles. « Si on ignore qui a inventé les lunettes sur monture, on se doute qu’il s’agit probablement d’un moine. Pourquoi ? Au Moyen Âge, ce sont eux qui savent lire et qui copient des textes pendant des heures afin d’en faire des livres (avant l’invention de l’imprimerie.
L’autrice ne présente que trois inventions pour l’Époque moderne : piano, sextant et crème glacée. Dans le cas du piano, c’est l’Italien Bartolomeo Cristofori qui a l’idée de fabriquer un système où les cordes sont frappées à l’aide de petits marteaux, plutôt que pincées comme pour la harpe ou le clavecin.
C’est l’Époque contemporaine qui voit naître la toilette à chasse d’eau, la fermeture à glissière, les crayons de couleur en bois et… le beurre d’arachides. Pharmacien et chimiste québécois, Marcellus Gilmore Edson invente la première pâte à tartiner à base d’arachides à la fin du 19e siècle. Quelques dizaines d’années plus tard, un Américain commercialise cette création canadienne.
« Chaque jour, des inventions transforment notre vie. On peut penser à l’arrivée des téléphones intelligents, des voitures électriques, des jeux de réalité virtuelle, alouette ! »
8 octobre2025

Collectif, Complètement nature, encyclopédie traduite de l’anglais par Bruno Porlier, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 360 pages, 39,95 $.
La nature dans
toute sa créativité
et son ingéniosité
La vie est apparue sur Terre il y a plus de 3,7 milliards d’années.
Les quelque 1,9 millions d’espèces d’organismes vivants décrits à ce jour par la science sont divisés en sept règnes, tels que végétal et animal. L’encyclopédie visuelle Complètement nature décortique cela avec brio.
Tous les êtres vivants mènent une lutte permanente pour produire une descen-dance. Alors que l’éléphant peut avoir seulement cinq petits au cours de sa vie, certaines grenouilles produisent – tenez-vous bien – 20 000 têtards chaque année !
Le plan de ce volumineux album aux photographies époustouflantes est le suivant : Micro-organismes et champignons, Végétaux, Invertébrés, Poissons, Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Habitats naturels. Un glossaire de 120 mots et
un index figurent en appendice.
Première surprise : « Les champignons ne sont pas des plantes; ils forment un règne distinct du monde vivant. La plupart se nourrissent à partir de matières organiques en décomposition, telles que le bois pourrissant, les cadavres d’animaux,
ou celles contenues dans la terre. »
Les végétaux sont aussi désignés sous
le nom de plantes. Pour celles à fleurs,
on explique la croissance des graines,
les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les arbres. Il est aussi question des plantes carnivores, des plantes aquatiques et des plantes des déserts.
Les invertébrés désignent l’ensemble d’animaux le plus nombreux et le plus diversifié sur Terre. Exemples : escargots, pieuvres, anémones de mer, coraux, méduses, étoiles de mer, vers, insectes, parasites, scorpions, crabes et crustacés.
Les poissons, apparus il y a près de 500 millions d’années, furent les premiers animaux à développer une colonne vertébrale. On explique les sens des poissons, la nage, la reproduction,
la migration, le camouflage et la vie en bancs. Deux pages sont consacrées aux étranges poissons des abysses vivant à partir de 1 800 m sous la surface jusqu’au fond de l’océan.
Les amphibiens sont apparus il y a environ 370 millions d’années. Ils sont les premiers vertébrés à vivre sur la terre. Il en existe trois grands groupes : d’abord les gre-nouilles et crapauds, puis les salamandres
et tritons, ensuite les cécilies qui sont strictement tropicales.
Les premiers reptiles ont évolué à partir
des amphibiens. Ils dominèrent la vie sur notre planète durant l’ère mésozoïque (entre -250 et -65 millions d’années), époque à laquelle apparurent les dino-saures. Il est question de serpents, iguanes, crocodiles et tortues.
Les oiseaux ont évolué à partir d’un groupe de dinosaures il y a plus de 150 millions d’années. On explique, entre autres, leur squelette, les types de becs, les plumes,
les ailes, les nids, le vol, les rapaces nocturnes, les aigles, les canards, les oiseaux plongeurs et les autruches.
Les mammifères, eux, ont évolué à partir de formes primitives de reptiles il y a quelque 220 millions d’années. Les premiers vivaient dans l’ombre des dinosaures, mais après la disparition de ces derniers, ils purent se diversifier : carnivores, herbivores, insectivores, rongeurs, planeurs et fouisseurs.
Le dernier chapitre porte sur les habitats naturels. Il est question de forêts,
de prairies, de montagnes, de déserts,
de toundra, de régions polaires, d’océans, lacs et rivières.
Porté par un texte clair et accessible,
cette incroyable encyclopédie visuelle rend simples et captivants même les phénomènes scientifiques plus complexes. La nature s’y dévoile dans toute sa créativité et son ingéniosité.
3 octobre2025
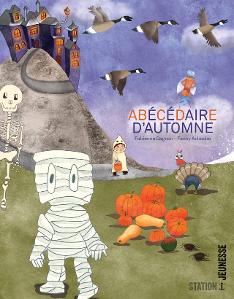
Fabienne Gagnon, Abécédaire d’automne, album illustré par Fanny Achache, Montréal, Éditions Station T du groupe Productions Somme toute, coll. Station jeunesse, 2025, 40 pages, 24,95 $.
Une saison reçoit
ses lettres de noblesse
L’automne est synonyme de récolte et rentrée, de couleurs et costumes. Après avoir publié Abécédaire d’hiver, Fabienne Gagnon et Fanny Achache nous offrent Abécédaire d’automne, un album plein
de poésie et d’humour.
« Alerte aux araignées / L’automne est arrivé ! » Ainsi commence l’abécédaire.
La lettre A engendre 5 mots sur 6. La lettre Z, elle, en réunit 4 sur 5 : « Zut ! Les zombis zieutent Zouzou ! » Quant aux illustrations de Fanny Achache, elles sont coquines et éveillent une pure fascination.
La poésie de l’autrice Fabienne Gagnon virevolte avec les feuilles d’automne pour nous divertir et nous faire rêver. Ses courts textes s’éloignent des lieux communs normalement présentés dans un album pour jeune lectorat. Pour la lettre Q, il n’y
a pas que le Québec, loin de là :
« Pour qui les quatre quatre-quarts aux quatre-épices du Québec ?
Pour Quentin le quincailler et ses quintuplés »
Quand j’ai commandé cet album, je me suis dit que, pour la lettre H, il serait inévitable-ment question de l’Halloween. Je ne me suis pas trompé, mais je ne m’attendais pas à autant d’originalité :
« Horace l’horrible harpiste
Et Hubert le hamster hurleur
Habitent là-haut
Dans le hameau hanté de l’Halloween »
Dans ce genre d’album, on met souvent en évidence un seul mot pour chaque lettre de l’alphabet. L’imagination débridée de Fabienne Gagnon lui permet d’être on
ne peut plus généreuse. Tous les noms, adjectifs, verbes et adverbes entrent dans
la ronde. Sous la lettre S, il y a même
une préposition qui s’ajoute :
« Un soir de septembre
Sous les saules
Souris et souricettes
Sorcières et squelettes
Savourent en secret
De la soupe aux serpents »
Ce livre est parfait pour explorer l’automne avec ses plaisirs, ses évènements et même ses inconvénients à certains moments.
Des personnages humains, des animaux et des symboliques rendent les illustrations tour à tour dynamiques, drôles ou touchantes.
Fabienne Gagnon est née entourée de livres. Dès son plus jeune âge, elle écrit des poèmes en s’inspirant de la nature,
ce qu’elle fait toujours aujourd’hui. Animés par le rythme des saisons et les émotions de l’enfance, ses écrits valsent entre l’humour et l’émerveillement. Abécédaire d’automne est son sixième livre pour
la jeunesse.
Fanny Achache démarre sa vie profession-nelle en France, tout d’abord dans le cinéma, puis dans la publicité. À son arrivée au Québec, elle étudie le graphisme et se lance dans l’illustration. L’automne aux couleurs éclatantes et à l’ambiance mystérieuse est pour elle une véritable source d’inspiration.
27 septembre2025

Catherine Ferland, À boire! Alcools et buveurs, 16e-21e siècles, Québec, essai,Éditions du Septentrion, 2025, 168 pages, 19,95 $.
Fresque québécoise
de la consommation alcoolique
Le cidre, le vin, la bière, le caribou et le champagne ont arrosé le gosier des Québécois depuis plus de quatre siècles. Catherine Ferland retrace leur histoire et leur adaptation aux réalité d’ici dans À boire! Alcools
et buveurs, 16e-21e siècles.
Lors de son troisième voyage vers
le Canada à l’été 1541, Jacques Cartier fait embarquer 100 tonneaux de cidre breton. Quelques siècles plus tard, on cultivera religieusement la pomme : les cisterciens à Rougemont, les moines bénédictins à Saint-Benoît-du-Lac.
Les habitants tentent de produire leurs propres boissons alcooliques dès le 17e siècle, à commencer par la bière d’épinette, puis la root beer ou racinette et la bière
de gingembre.
Les Récollets, les Jésuites et les Sulpiciens sont les premiers à établir de petites brasseries à Québec, Trois-Rivières et Montréal. La voie est tracée pour les éventuelles tavernes. Elles seront un point de convergence des hommes du quartier.
« C’est presque une sorte de confessionnal laïc. Ce qui se dit à la taverne reste à
la taverne : c’est pratiquement le credo implicite du lieu, le code d’honneur des habitués. On ne trahit pas un chum. »
Lors de la prohibition au début du 20e siècle, le Québec tient un référendum en 1919 et la population vote massivement
en faveur de l’exclusion de la bière, du vin et du cidre de la loi sur la prohibition.
C’est d’abord l’importation de vins européens qui permettra de remplir
les verres des épicuriens de la Nouvelle-France. L’idée de cultiver la vigne et de produire du vin ne s’impose que dans
le dernier tiers du 19e siècle.
Les vignerons cisterciens se démarqueront grâce au monastère d’Oka. Ce dernier devient, en 1893, l’École d’agriculture des pères trappistes. On y compte 5 000 pieds de vigne, on y produit plus de 10 000 gallons de vin par année.
L’auteure précise que « le vin québécois n’occupe toutefois que 0,5 % des parts du marché entre 1999 et 2003. Les producteurs de l’Ontario, de la Colombie-Britannique,
de la Californie et du Chili livrent une concurrence particulièrement féroce.
Un mot sur le célèbre caribou, emblématique du Carnaval de Québec.
Il s’agit d’un mélange de vin et de whiskey. Dès 1936, l’écrivain Claude-Henri Grignon en parle comme une « boisson explosive, alcool diabolique, élixir des braves et
des draveurs ».
L’eau-de-vie, écrit Catherine Ferland, « enivre de manière rapide, voire foudroyante ». Elle mérite, ajoute-t-elle, une place à part dans la « constellation » des boissons alcooliques. L’eau-de-vie entraîne des croisades de tempérance.
Le 22 janvier 1906, l’archevêque de Québec ordonne la création d’une société
de tempérance dans chaque paroisse de
son diocèse.
Un chapitre du livre est consacré à l’absinthe, une boisson vénérée et controversée. En 1609, Marc Lescarbot, compagnon de Champlain, écrit que
le « breuvage d’absinthe » prévient
le scorbut.
Surnommée la Fée verte, l’absinthe est associée à l’univers artistique. On allègue que ses effets stimulants, « légèrement sédatifs et euphorisants », favorisent le travail créatif. La plante absinthe croît bien au Québec, notamment dans l’Estrie et
la Montérégie.
Le dernier chapitre porte sur le roi des vins, le champagne. On y apprend que 700 bouteilles sont arrivées au port de Québec en 1730. Le prix demeure cependant prohibitif. Associé aux célébrations, il est néanmoins servi lors de baptêmes et de mariages, voire lors de compétitions sportives comme les courses de Formule 1.
À boire! Alcools et buveurs, 16e-21e siècles paraît dans la collection Aujourd’hui l’histoire avec, qui propose un travail de médiation historique. L’auteure dirige
cette collection aux Éditions du Septentrion.
14 septembre2025

Raymond Ouimet, La vengeance des mal-aimés, Trois drames oubliés, essai, Québec, Éditions du Septentrion, coll. Dossiers criminels, 2025, 174 pages, 24,95 $.
Détourner le meurtre
en ordonnant
l’assassinat public
Passionné d’histoire et de généalogie, Raymond Ouimet a puisé dans
les archives judiciaires et dans
la presse du début du XXe siècle pour revisiter trois affaires criminelles ayant fait à leur époque couler beaucoup d’encre, mais ayant depuis sombré dans l’oubli.
Il les présente avec force détails dans La vengeance des mal-aimés, Trois drames oubliés.
La première affaire criminelle se déroule en 1904 à Sainte-Scholastique, dans le district judiciaire de Terrebonne. Théophile Bélanger ne supporte pas le beau-frère avec qui il est tenu de vivre. La situation s’enflamme et un meurtre est perpétré. L’accusé écope de la peine capitale et, curieusement, meurt deux fois.
Le deuxième drame se passe à l’Ile aux Allumettes, dans le Pontiac, en 1933. Michael Bradley avoue avoir assassiné cinq membres de sa famille. Il répond à deux critères du MOM : moyen, occasion, mobile. Ce dernier critère ne saute pas aux yeux des policiers.
La troisième affaire criminelle a lieu dans
la ville de Québec en 1934. Le facteur Rosario Bilodeau est accusé de six assassinats et de deux tentatives de meurtres. Était-il fou? Que reprochait-il
à toutes ces personnes?
Dans Les Souffrances du jeune Werther, Johann Wolfgang von Goethe écrit :
« Il suffit qu’une injustice du sort nous touche d’une manière fictive ou bien réelle pour que l’émotion attachée à la vengeance originaire se réveille… » D’où le titre qui coiffe l’essai de Raymond Ouimet :
La vengeance des mal-aimés.
Ouimet explique avec minutie comment « Trois homme ont causé la mort de douze personnes par désespoir et par vengeance pour mettre fin à leur souffrance. »
Il souligne que la justice de la première moitié du XXe siècle avait le bras lourd,
trop lourd.
« Souvent le gouvernement refusait même de commuer la peine capitale dans des causes où le meurtrier avait perdu la tête, et ce, même si le jury avait souligné que
le condamné pouvait se prévaloir de circonstances atténuantes. »
L’ouvrage de ce passionné d’archives fourmille de renseignements historiques.
On y apprend que la première peine de mort a été infligé en 1642 quand le sieur
de Roberval a fait pendre six hommes pour rébellion.
Entre 1642 et 1960, environ 351 personnes, dont 17 femmes, ont été exécutées au Québec. « La plus jeune personne pendue au Québec a été un certain B. Clément,
13 ans, exécuté à Montréal pour avoir volé… une vache.
« La dernière personne à avoir subi
la peine de mort au Québec a été Ernest Côté, exécuté le 11 mars 1960 à Montréal pour homicide lors du braquage d’une banque à Témiscaming le 10 juin 1959. »
En 1902, le journal Le Temps (Ottawa) a appelé à l’abolition de la peine de mort.
Ni la population ni même l’Église catholique n’étaient en faveur. Ce n’est qu’en 1976 que le Canada révoquera la peine capitale par une majorité de six voix à la Chambre des communes.
Voilà un ouvrage qui démontre à quel point il est absurde de punir l’homicide et de détourner les citoyens de l’assassinat en ordonnant… l’assassinat public.
10 septembre2025

Lamara Papitashvili, Une Terre, quatre visages, roman, Ottawa, Éditions David,
coll. 14/18, 2025, 156 pages, 18,95 $.
À la découverte
de nouveaux arrivants
Trouver sa place dans un nouveau pays pose souvent des défis.
Elle-même issue de l’immigration, Lamara Papitashvili propose, dans Une Terre, quatre visages, les récits entremêles de quatre adolescents, chacun avec son propre passé,
ses espoirs et ses blessures.
Athéna a quitté la Grèce pour Toronto.
Le Libanais Tarek s’est installé à Ottawa. Alex a suivi sa famille vietnamienne à Sudbury. Naomi a rejoint sa mère sénégalaise à Montréal. Entre déracinement, quête d’identité et espoir d’un nouveau départ, ces quatre adolescents suivront des trajectoires aussi chaotiques qu’émouvantes.
Une nouvelle amitié demeure bénéfique. C’est le cas d’Athéna avec Amy, deux filles bizarres, la première vivant dans un milieu pauvre, la seconde évoluant dans une famille très à l’aise. Elles peuvent compter sur la présence de leur père, « contraire-ment à 12 % des pères d’enfants de Toronto qui ne le sont pas », précise la romancière.
En se fabriquant surtout une image des Canadiens différente de la sienne, Tarek ne s’entend guère avec eux, ne s’intègre pas.
Sa mère lui dit : « Tu t’es refermé sur toi-même face à l’adversité d’un nouveau pays. » Résultat : deux ans après son installation au Canada, Tarek se sent toujours comme un étranger
Je ne sais pas si c’était voulu ou non,
mais Lamara Papitashvili s’est fait poétique lorsqu’elle écrit : « En onzième année,
les notes au bulletin ne sont plus
une rigolade. Or celles de Tarek sont en pleine dégringolade. » Belle rime.
À Sudbury, Alex fréquente Jessy,
une personne non binaire que l’auteure désigne sous le pronom iel. Contrairement
à Tarek, il s’intègre à pieds joints dans
son nouveau pays, ne cherchant pas, loin
de là, à vivre dans une bulle vietnamienne comme le fait sa mère.
La maman de Naomi s’est envolée vers Montréal pour des soins médicaux.
Elle parraine la venue de sa fille et de
son mari. Les retrouvailles sont difficiles
car et la mère et la fille transportent
une montagne d’émotions qu’il n’est pas facile de partager.
Un épilogue permet de réunir les quatre adolescents à l’Université de Toronto.
En passant, c’est là où l’auteure étudie présentement en littérature comparée.
Amy et Jessy sont aussi du nombre. À six, ils discutent, « certains heureux de commencer une nouvelle vie, d’autres anxieux à l’idée du changement, mais tous se remémorant leur périple d’un coin de
la planète jusqu’à L’autre bout du monde ».
C’est sans doute un cliché mais il importe de rappeler, comme le clame haut et fort Lamara Papitashvili, que ce qui fait la beauté du Canada, c’est l’union de gens issus de parcours différents. Son roman
est d’ailleurs dédié « aux nouveaux arrivants ».
La romancière est issue d’une famille aux origines géorgienne, ukrainienne et russe. Parallèlement à l’écriture de romans, Lamara Papitashvili participe à l’émission littéraire mensuelle À échelle humaine
sur les ondes de Radio-Canada. Elle anime également des ateliers de création littéraire pour adultes et adolescents.
Polyglotte, l’auteure a vécu en Géorgie,
en Syrie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Canada. Cela lui a permis d’enrichir son imaginaire avec diverses influences culturelles.
30 août2025

Pierre-Michel Tremblay, Entendre à rire, carnet thérapeutique sur les bienfaits de l’humour, Montréal, Éditions Somme toute, 2025, 132 pages, 24,95 $.
Essai poignant sur
les vertus curatives
de l’humour
En quelques minutes, un émissaire du rire peut instaurer un climat
de confiance et de détente tantôt auprès d’un enfant atteint de cancer, tantôt auprès d’une personne en perte cognitive. Pierre-Michel Tremblay en témoigne avec brio dans Entendre à rire, carnet thérapeutique sur les bienfaits
de l’humour.
Selon l’auteur, des centaines d’études « montrent sans équivoque que le rire renforce le système immunitaire, augmente la tolérance à la douleur, bonifie la santé cardiovasculaire, améliore le sommeil et l’humeur, diminue le stress, enrichit
les relations sociales ».
Dans son essai, Tremblay explore les vertus curatives de l’humour en analysant notre rapport au rire comme nécessité vitale pour affronter les zones d’ombre de nos existences, surtout en milieu hospitalier. Persuadé que l’humour est une excellente médecine, il choisit de partager le quoti-dien de quelques docteurs clowns du Saguenay, son coin d’origine.
Il ne s’agit pas de porter un sarrau blanc et un nez rouge pour se proclamer docteur clown. Une expérience préalable en art de la scène est nécessaire avant d’entamer
une formation exigeante combinant toutes les techniques de l’art clownesque, de l’improvisation et du savoir-être avec
les patients.
Pierre-Michel Tremblay s’est rendu dans
le Centre d’hébergement des Pensées (Saguenay) où il a suivi deux docteures clowns dont le nez rouge agit comme
une carte de visite magique indiquant à tous et toutes « allô, je n’appartiens pas
à la vie quotidienne ». En les accueillant, une patiente n’hésite pas dire « ça met de la vie de vous voir ».
« Le nez rouge donne l’autorisation d’être malcommode, de transgresser les règles, d’être libre des contraintes de bienséance, de faire le pitre. » L’auteur décrit une scène où il ne fait aucun doute que la docteure clown et une vieille petite dame immergée dans une absurdité perpétuelle et involon-taire se comprennent.
Quelques portes plus loin, lorsque
la réponse à la question « comment ça
se passe pour toé aujourd’hui ? » est
un morne « ouais, correct… », la docteure clown sait très bien que ça veut dire « vous le voyez bien tabarnak que j’ai pas de cheveux, que chu maigre comme un clou de six pouces pis que chu écœuré d’être malade ».
En entrant dans le Département d’oncologie-pédiatrie de l’hôpital de Chicoutimi, Pierre-Michel Tremblay demande à la docteure clown si elle sait de quel type de cancer souffrent les enfants. Elle lui répond d’abord que le diagnostic n’est pas ce qui importe, puis ajoute « sauf si c’est incurable parce que, dans ces cas-là, inévitablement, une relation d’attachement se développe ».
Chaque fois que Tremblay a accompagné des clowns thérapeutiques, il a vu des hommes et des femmes se transformant
en « étonnantes figures au nez rouge provenant d’un univers différent, des personnages possédant le pouvoir d’invoquer la joie, la légèreté et la tendresse ». Des endroits cliniques ou fonctionnels se transformaient dès lors en lieux d’épanouissement et de sérénité.
C’est parce qu’il a rencontré ces clowns sans cynisme, ces bouffons pleins de bonté, ces femmes et ces hommes pratiquant
un rire tendre pour les humains les plus fragiles de notre société, que Pierre-Michel Tremblay a senti le besoin d’écrire ce livre. Cela lui a permis de renouer de manière plus viscérale avec la dimension thérapeutique de l’humour.
16 août2025

McSkyz, Enquêtes avec McSkyz, Spécial serial killer, album, Éditions Dark Side Hachette, 2025, 64 pages, 15,95 $.
Enquêter, analyser
et décoder
Les enquêtes criminelles vous passionnent ? Voici un album qui vous plongera au cœur de cinq affaires glaçantes. Ces Enquêtes
avec McSkyz ont fait frissonner
le monde entier.
McSkyz est le pseudonyme de Joris Lavarenne, est un auteur, youtubeur et podcaster français. Ce passionné de crimes réels publie une nouvelle « histoire vraie
et flippante » (HVF) chaque vendredi soir depuis 2018. Ses HVF comptent aujourd’hui entre un demi-million et un million et demi de consultations.
Disparitions mystérieuses, séquestrations, meurtres, toutes les affaires sont décorti-quées par ses soins, de la découverte du crime à sa résolution. Dans cet album, McSkyz nous entraîne sur la trace de cinq serial killers à Hong Kong, en France et aux États-Unis.
Le premier tueur en série est Lam Kor-wan, surnommé « le boucher de Hong Kong ». Dans les années 1980, il a à peine 27 ans, le visage séduisant, la voix douce. Or, dans sa chambre fermée à double tour, il se livre en moins de cinq mois à quatre crimes sexuels inimaginables.
Au fil de l’enquête, quelques médecins légaux « abandonneront devant l’insoutenable vision de certaines vidéos
où le serial killer se met en scène en train de démembrer ou violer les corps. »
McSkyz présente le cas d’un tueur qui a pour projet de sacrifier douze personnes, une pour chaque signe astrologique.
Il envoie après coup des lettres aux médias avec des messages cryptés et signées
Le Zodiaque.
L’enquête devient « un véritable manège
à sensations ». Un suspect est reconnu coupable et condamné à 232 années de réclusion. Or, il s’agit d’un copycat. « Mais quid du Zodiaque originel ? » Et on n’est pas à l’abri d’un Zodiaque III ou IV.
Les autres tueurs en série incluent
un prédateur du numérique avant l’heure, un routier du cauchemar et un monstre dissimulé en père de famille. Chaque affaire est racontée dans une ambiance aussi terrible qu’angoissante.
Pour chaque cas, McSkyz propose des jeux de logique, d’observation et de culture générale. Les solutions figurent à la fin de l’album. Il y a un jeu qui vous invite à trouver le nom de six armes (saurez-vous faire la différence entre le revolver et le pistolet ?). Un autre jeu présente quatre
clés et quatre menottes qu’ils faut jumeler correctement.
Le cahier Enquêtes avec McSkyz a reçu des critiques généralement positives, soulignant sa qualité, son originalité et son aspect divertissant. Les lecteurs apprécient le style de McSkyz ainsi que la combinaison d’histoires et d’énigmes. Les inconditionnels du true crime trouvent que le cahier de 64 pages se termine trop rapidement, bien entendu.
10 août2025

Patricia Cornwell, Identité inconnue, roman traduit de l’anglais par Dominique Defert, Paris, Éditions JC Lattès, 2025, 384 pages, 41,95 $.
Nouvelle enquête
de Kay Scarpetta
Les livres de Patricia Cornwell se sont vendus à plus de cent vingt millions d’exemplaires. Son nouveau roman Identité inconnue décortique une vingt-huitième enquête de Kay Scarpetta, cheffe d’un institut médico-légal en Virginie du Nord, aux États-Unis.
La Dr Scarpetta est appelée sur une très étrange scène de crime. Dans un sinistre parc d’attractions abandonné, un corps à
la peau curieusement rouge a été retrouvé au centre d’un agroglyphe de pétales.
Horrifiée, elle découvre que la victime est nul autre que son ex-amant Sal Giordano, scientifique récompensé par le prix Nobel, que l’on surnomme « le chasseur d’ET » A-t-il été tué par des extraterrestres…?
L’astrophysicien a été jeté dans le vide du haut d’un objet volant. On apprend que balancer un corps dans le vide, au milieu des montagnes, de la mer ou d’un lieu perdu, a jadis été une spécialité russe.
Ces vols de la mort ont aussi été pratiqués « par le Japon, la Colombie, l’Indonésie et
la France pendant la guerre d’Indochine
et d’Algérie. »
Si un humain tue un autre humain, c’est
un homicide. Si la cause de la mort est due à un animal, il s’agit d’un accident. « Mais
si ce sont des ET, je n’ai pas de terme pour cela », affirme la médecin légiste.
Dr Kay Scarpetta pratique l’autopsie, mais il faut 19 chapitres avant que cela commence. On a d’abord droit à des descriptions fort détaillées d’un vol cahoteux en hélicoptère, puis à un interrogatoire sur la vie privée de la médecin légiste avant qu’elle ne puisse toucher au cadavre.
Juste avant cette enquête, la médecin
légiste a pratiqué une autopsie sur le corps d’une fillette. On découvre qu’il y a
un dénominateur commun entre cette mort et celle du scientifique. Peut-on croire que la même personne les a tués…?
Côté style, certaines comparaisons sont finement ciselées. La romancière écrit que Dr Kay Scarpetta « dissèque son âme comme le corps de ses cadavres ».
Les membres raides dans une housse mortuaire évoquent « un insecte tentant
de s’échapper de sa chrysalide ».
Une ancienne greffière est « une fouine avec une ouïe de chauve-souris ».
Comme le roman met en scène une médecin légiste, les rares mots scientifiques sont monnaie courante. Il est question,
par exemples, d’une hémorragie intraparenchymateuse, de cellules photovoltaïques, de taux élevés d’halopéridol, de lorazépam et de diphénhydramine.
Il y a plusieurs références à des organismes américains bien connus, notamment au FBI, à la CIA et à la NASA. S’ajoutent d’autres entités comme AFIP (Armed Forces Institute of Pathology), AFMES (Armed Forces Medical Examiner System), AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) et DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).
Quand on fait remarquer à Kay Scarpetta qu’elle va devoir surveiller ses arrières,
elle répond que c’est devenu chez elle « une seconde nature ». Et pour l’adjoint de la médecin légiste, deux plus deux ne font pas toujours quatre.
Ce roman illustre plusieurs choses : le mal est dans notre nature, il faut parfois penser en dehors du cadre normal, l’Enfer existe bel et bien… sur Terre, il y a toujours des extrémistes qui veulent abattre la démocratie, sans oublier qu’il n’y a rien de pire que la jalousie. « C’est la principale cause des horreurs en ce monde. »
25 juillet2025
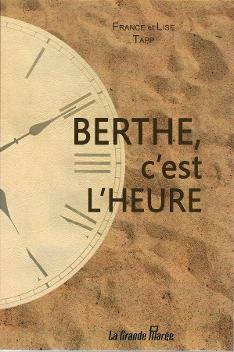
France et Lise Tapp, Berthe, c’est l’heure, roman, Tracadie, Éditions La Grande Marée, 2025, 518 pages, 32,95 $.
Roman à quatre mains
sur comment s’adapter
à la vie
Des nouveau-nés à l’arrière-grand-mère, il a fallu quatre mains et
500 pages pour décrire les tribulations d’une famille où l’amour, la tendresse et l’affection règnent à profusion. Le résultat est Berthe, c’est l’heure, roman de France
et Lise Tapp.
Les personnages principaux sont Blanche (arrière-grand-mère septuagénaire), Jeanne (grand-mère quinquagénaire) et Berthe (mère trentenaire). Soi-disant orpheline de père, Berthe a, très jeune, transposé sa mère dans le rôle de père et identifié sa grand-mère dans celui de sa mère.
Lise Tapp confie : « J’ai retrouvé, dans
le style de ma sœur France, le mien et m’y suis sentie à l’aise pour lui donner encore plus de substance et de vie ». Dans ce roman, la vie charrie bien des adversités avec lesquelles il faut composer.
Berthe Leclerc est élevée par des femmes
et enseigne dans un collège de filles. Bien qu’il y ait peu d’occasions de rencontrer
un homme, elle fait la connaissance
d’un radiologue nommé Charles Blais et l’épouse vers 1989. « C’est à qui dit aimer l’autre davantage. »
Émotions et évasions, sentiments et raisonnements, hésitations et interrogations, tout est décrit avec moult détails, avec
une vivacité qui se transforme tantôt en ensorcellement tantôt en litanie.
Mais lorsqu’il s’agit de moments amoureux au lit, on a tout simplement droit à un bout de phrase comme « se prodiguant mutuellement la tendresse et la volupté que leur dictent leurs élans ».
Selon les romancières, il faut laisser
les peines du passé de côté et se préparer
à vivre les joies présentes et celles à venir avec l’homme que l’on chérit. « Ce que
l’on ne pouvait changer, on se devait de l’accepter, de comprendre et de s’adapter ».
Les épreuves que Berthe traverse avec
sa famille et son mari apportent avec elles une multitude de bouleversements. Raison de plus pour affirmer que « La vie nous emporte là où nous devons aller, cela est notre destin. L’acceptation, puis l’adaptation, sont les meilleures solutions entre toutes. »
France et Lise Tapp se demandent pourquoi des gens posent certaines actions qui nous semblent incompréhensibles. La réponse qui s’impose semble être la suivante : « Parce qu’ils ont trop mal, la souffrance les aveugle, ils ne savent comment réagir. »
Le vocabulaire de Berthe, c’est l’heure est soigné. Les romancières nous servent parfois des mots rares, dont voici quelques exemples : « plaisirs réservés aux séides de l’amour, amoureux en plein amuïssement, c’est de la palinodie pure, avouer sa hâblerie, cette céphalée du réveil… ».
Curieusement, l’éditeur a décidé d’éliminer plusieurs accents circonflexes, une fantaisie dont nous nous serions bien passés. Nous avons droit à : maitriser, apparaitrait, reconnait, disparaitre, fraiche, gouter, coute, affut, entraine, au faite et j’en passe.
Il aurait été préférable d’accorder plus d’attention à la mise en page. Lors d’une question ou d’une exclamation, il arrive trop souvent que le point d’interrogation
ou d’exclamation se retrouve seul au début de la ligne suivante.
On connaît l’expression « la vie est
un long fleuve tranquille ». Elle est née sous la plume de l’écrivain et avocat français Denis Langlois, et fait partie d’une expression plus grande : « La vie est
un long fleuve tranquille, ce sont les rives qui sont dangereuses. »
L’action de Berthe, c’est l’heure se déroule principalement face au fleuve Saint-Laurent. Selon les saisons de la vie,
les personnages ne manquent pas de voguer sur des rives dangereuses.
16 juillet2025

Freida McFadden, La femme de ménage
se marie, novella traduite de l’anglais par Karine Forestier, Paris, City Éditions,
coll. Poche, 2025, 112 pages, 8,95 $.
Novella meurtrière
« Je vais te trancher la gorge, Millie Calloway. » Voilà la première phrase du premier chapitre de
la novella La femme de ménage
se marie, de Freida McFadden. Phrase prononcée le jour du mariage de Wilhelmina Calloway, alias Millie. Le texte est court, saccadé et trépidant.
Je vous ai déjà parlé de Millie dans
ma recension des romans Les secrets de
la femme de ménage et La femme de ménage voit tout. J’ai aussi passé en revue le roman La Prof, également de Freida McFadden.
Enceinte, Millie Calloway s’apprête à épouser Enzo Accardi, l’homme de ses rêves. Alors qu’elle devrait se préoccuper uniquement de sa robe et de sa coiffure, Millie est confrontée à un sérieux problème : quelqu’un ne veut pas qu’elle vive assez longtemps pour prononcer ses vœux.
Elle reçoit des appels d’un homme qui épie ses faits et gestes, comme s’il était caché dans la penderie, « une lueur meurtrière dans les yeux ». Un bref coup de fil lui apprend que cet homme veut voir le sang se répandre partout sur sa robe de mariée.
Bien que prise au piège, Millie décide de
ne pas se laisser intimider. Elle entend se marier coûte que coûte, pour le meilleur
et pour le pire. Mais le pire pourrait bien arriver plus tôt que prévu…
Frieda McFadden écrit que Millie est
un mélange à part égales de nervosité et d’excitation. « Je suis nervexcitée. » Ce qui est censé être le plus beau jour de la vie de Millie se transforme en une succession de tragédies.
Ses parents, avec lesquels elle est brouillée depuis quinze ans, ont promis d’assister à l’union civile. Or, voici qu’ils annulent leur présence quinze minutes avant la cérémonie présidée par un commissaire adjoint aux mariages dans l’hôtel de ville de Manhattan, État de New York.
Millie et Enzo savent qu’ils auront une fille. Entre les appels meurtriers (que Millie garde pour elle-même) et la robe qu’un tailleur doit ajuster à la dernière minute, les futurs époux discutent du prénom à donner à leur enfant : Felicity, Nadine, Violet, Allison, Ada.
Le roman et la nouvelle sont des genres littéraires très connus. La novella demeure plus rare. Elle compte entre 17 500 et
40 000 mots, se concentrant sur une intrigue principale, sur un événement central avec quelques événements connexes.
Freida McFadden est un pseudonyme. Originaire de New York, l’autrice est née d’un père psychiatre et d’une mère podologue. Elle est médecin spécialisée dans les lésions cérébrales. En France,
le roman Les Secrets de la femme de ménage s’est classé parmi les 10 livres
les plus vendus en 2024, trois mois seulement après sa parution.
5 juillet2025

Guy Bélizaire, Rue des rêves brisés, roman, Ottawa, Éditions L’Interligne, 2025, 208 pages, 26,95 $.
Immigration et racisme,
deux thèmes chers
à Guy Bélizaire
Malgré toutes ses crises et ses situations impossibles, Haïti demeure un pays magique qui a « un effet
de coup de foudre, attractif, ensorcelant ». Voilà ce que Guy Bélizaire illustre avec brio dans
le roman Rue des rêves brisés.
La réédition de cet ouvrage en vaut
le coût-coup !
L’action se déroule à Montréal où Christophe est né de parents haïtiens. Le père veut imposer à son fils de 17 ans un voyage
d’un mois au pays de ses ancêtres. Christophe n’y tient pas car il craint de perdre
sa première petite amie, Mélodie. Loin
des yeux, loin du cœur.
Le narrateur de ce roman est le fils, plus souvent appelé Chris. Guy Bélizaire le campe dans des situations où l’ado finit par aimer son père tout en étant emmerdé par
sa présence. Il l’apprécie, mais préfère le plus souvent se passer de sa compagnie.
Au début, Mélodie n’accueille pas très bien
le projet de voyage de son petit ami. Cela bouleverse tous ses plans. Son chagrin,
sa déception et sa colère mettent visiblement des bâtons dans les roues de son raisonnement.
L’auteur explore largement le thème du racisme, utilisant au besoin le mot en N. Jimmy, le meilleur ami de Chris, ne laisse personne l’insulter, surtout pas un Blanc.
Cela se produit une fois et Jimmy flanque
un coup de poing à son agresseur. « Désormais, je suis sûr qu’il réfléchira avant d’insulter un Noir. »
Le racisme est mis en épingle dans plus
d’une scène impliquant des policiers. Jimmy est abattu lors de l’une de ces altercations.
De toute évidence, Chris en veut à cet homme en uniforme qui a tué son meilleur ami. Il en veut « au Bon Dieu qui laissait se produire
ce genre de choses, à la société qui entretenait une telle injustice ».
Des dialogues courts mais percutants nous permettent de voir comment Chris en vient à comprendre que la vie est une vilaine comédie, une farce qui vise à faire mal, à faire souffrir. « Elle se présente avec son plus beau sourire, fait plein de promesses et un jour, paf! elle vous casse la gueule, vous laisse en miettes, avec dans la bouche un goût de fiel. »
Guy Bélizaire explore aussi le thème de l’exil, de l’immigration. Le père de Chris préfère
sa maîtresse à sa femme et elle s’appelle Haïti. L’enfant est né au Canada, il n’est pas un immigrant comme son père. « Tu ne traînes pas avec toi un passé, des habitudes et
une histoire d’ailleurs. »
Le romancier excelle dans l’art de brosser
le portrait d’un homme tiraillé entre
ses obligations de mari et de père, d’un part,
et un amour inconditionnel qu’il porte à
son pays natal, d’autre part. Le fils voit son paternel passer d’une situation autoritaire à des moments où il devient « en proie au doute, habité par un rêve plus grand que lui ».
Né à Cap-Haïtien, Guy Bélizaire vit au Québec depuis quarante ans. Il est diplômé en sciences économiques, en relations industrielles et possède également une maîtrise en administration publique. Ancien cadre supérieur à la fonction publique fédérale, l’auteur vit dans la région de l’Outaouais.
29 juin 2025

Marc Poirier, L’Acadie avant astheure, Chroniques d’histoire acadienne, Québec, Éditions du Septentrion, 2025, 234 pages, 24,95 $.
Marc Poirier, un passionné d’histoire acadienne
L’histoire est un arbre qui ne cesse de grandir. Encore faut-il l’arroser de notre curiosité et de l’éclairer de nos recherches. C’est exactement ce que fait Marc Poirier dans le recueil intitulé L’Acadie avant astheure.
L’ouvrage comprend quarante chroniques choisies parmi la centaine rédigées par Marc Poirier pour le journal Acadie Nouvelle, situé à Caraquet (N.-B.). Chacune aborde un petit bout d’histoire, chacune permet d’en savoir plus sur les origines et le destin du peuple acadien.
Le drame que fut la Déportation des Acadiens constitue un élément charnière de l’histoire de cette population, mais ne se limite évidemment pas qu’à cela. Poirier y consacre quelques chroniques, notamment à leurs architectes.
Dans « Robert Monckton : la tête de pont
de la Déportation », il note que certains qualifient ce lieutenant-colonel de « bourreau » et considèrent qu’il est coupable d’avoir participé à un nettoyage ethnique avant la lettre.
La ville de Moncton a été nommée en
son honneur (le k fut omis par erreur et l’orthographe maintenu ainsi). Ironie du sort, « Moncton est devenue l’un des chefs-lieux de la communauté acadienne, abritant plusieurs de ses institutions majeures, dont l’Université de Moncton. Certains Acadiens d’aujourd’hui y voient un pied de nez à l’histoire, alors que pour d’autres, c’est une insulte à la mémoire du peuple acadien. »
Une autre chronique présente Charles Morris comme l’architecte de la Déportation. Originaire de Boston, il est nommé arpenteur en chef de la colonie; c’est lui qui présente au lieutenant-gouverneur Charles Lawrence « un plan complet et détaillé de l’état des lieux et des façons de mener à bien l’expulsion de tous les Acadiens ».
Dans « L’expérience difficile des Acadiens au Poitou », Poirier indique que l’installation de ces derniers commence
en 1773. Environ 1 500 se dirigent vers
les « brandes » (lieux incultes) du Poitou. Le bilan de l’expérience demeure « loin
des premiers espoirs : de 100 à 150 Acadiens à peine vont y rester et ils s’intégreront peu à la population française locale ».
Contrairement à ce qu’on rapporte souvent, ce n’est pas Louis J. Robichaud qui a été
le premier Acadien à occuper le poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick. L’auteur souligne qu’il s’agit plutôt de Pierre Veniot, député libéral qui remplace son chef démissionnaire Walter Foster de 1923 à 1925. Il sera aussi « le premier Acadien à accéder au cabinet fédéral en tant que ministre des Postes sous le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King ».
Poirier rappelle que, au début des années 2000, un grand débat secouait la société acadienne entourant la demande d’excuses auprès de la Couronne britannique pour
la Déportation. La Société nationale de l’Acadie (SNA) s’est adressée en vain à
la reine Élisabeth II. « De longs pourparlers ont alors eu lien entre la SNA et le gouvernement, avec comme résultat l’adoption d’une proclamation royale désignant le 28 juillet (date de l’adoption de l’ordre de Déportation, en 1975) de chaque année Journée de commémoration du Grand Dérangement ».
J’aurais aimé que ces chroniques d’histoire acadienne incluent un tableau chrono-logique de la colonisation et de la déportation, avec une référence aux hommes et aux femmes qui ont façonné
ce parcours très particulier dans l’espace
et dans le temps.
Marc Poirier œuvre dans le milieu journalistique depuis plus de 35 ans. Après avoir couvert l’actualité pour l’Acadie Nouvelle, il a été reporter aux affaires publiques à Radio-Canada en Atlantique pendant 22 ans. Il siège au conseil d’administration de la Société historique acadienne depuis plusieurs années.
24 juin 2025

Katherine Girard, Helena, tome 1, Les rêves piégés, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 356 pages, 27,95 $.
Une histoire avant l’émancipation des femmes
Katherine Girard excelle dans l’art
de montrer comment les hommes
et les femmes pouvaient avoir de
la misère à se dire les vraies affaires à l’époque des carcans contraignants du catholicisme. Elle campe une femme énergique et déterminée dans Helena, roman basé sur
son arrière-grand-mère.
L’action se déroule principalement au Lac-Saint-Jean entre 1917 et 1922. Helena Gaudreau est la fille d’une femme qui « n’avait jamais ressenti de transports particuliers lorsqu’il avait été question d’étreintes charnelles ». Sa mère subissait, pour le plaisir de son mari, les relations sexuelles que ce dernier lui imposait. Résultat : quinze enfants.
L’aînée Helena a 17 ans quand son père décide de la marier à Liguori Simard.
Leur relation est basée sur l’amitié, sur une bonne entente. « Si le sentiment amoureux ne venait pas, peut-être que les plaisirs
de la chair, eux, seraient au rendez-vous ». Le mari est une belle pièce d’homme aux yeux pétillants, aux lèvres bien garnies,
aux fesses rebondies.
Lors de son voyage de noces à Québec, Helena rencontre un ami de Liguori, François dont le regard d’un vert d’été lui coupe le souffle. « Il se dégageait une gentillesse mêlée de tristesse qui lui alla droit au cœur ». François va hanter l’imaginaire de la jeune épouse… et ses nuits.
En prenant Liguori comme mari, Helena
doit vivre avec sa belle-mère. En posant
les pieds dans sa nouvelle demeure,
tout commence à aller de travers : comportement acariâtre et mesquin de
sa belle-mère, mari enrôlé dans l’armée, envoyé au front, revenu atteint de tuberculose et parqué dans un sanatorium.
Liguori se sent « comme un moins que rien, indigne de vivre, indigne d’aimer ». Helena, elle, s’accroche à son fils François-Xavier. Elle est « plus en mode survie
qu’à la recherche du bonheur ».
Pendant presque 300 pages, ce sont la solitude et tous les malheurs imaginables qui meublent la vie d’Helena, qui peuplent son âme. Heureusement, « la folle détermination et la fierté rude » l’empêchent de flancher. L’ère n’est cependant pas encore à l’émancipation
des femmes.
La vie racontée par Katherine Girard est celle où l’homme décide de tout, où
la femme obéit à son père, à son mari,
à son curé. « Sans homme, la femme n’était rien. Elle ne pouvait pas disposer de son argent, ne pouvait pas aller dans le monde librement, devait se surveiller constamment, n’était pas prise au sérieux. »
Le style de la romancière épouse l’intrigue, tantôt poétique comme les rêves de la protagoniste, tantôt saccadé comme la série de malheurs qui s’abat sur elle. J’ai noté une intéressante comparaison au sujet d’Helena, devenue veuve dans l’ombre omniprésente de François : « son goût pour le célibat s’envolait tranquillement, comme les oies qui partaient en grappes serrées vers des cieux plus cléments » (remarquez que tranquillement rime avec cléments).
Je ne vous cacherai pas que François
et Helena vibrent au même rythme.
Leurs lèvres s’unissent, leurs langues s’entremêlent, leurs souffles saccadés s’accordent. Ils se sentent en confiance, protégés de tous les tourments de l’existence. Évidemment, ils se trompent.
À suivre dans le tome 2 intitulé
Les bonheurs vacillants…
13 juin 2025
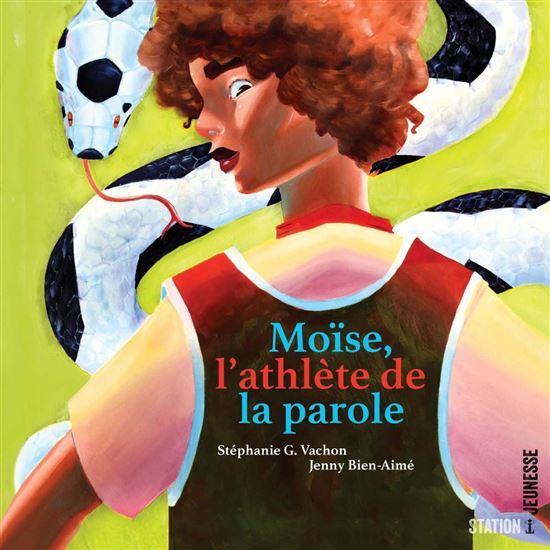
Stéphanie G. Vachon, Moïse, l’athlète de
la parole, album illustré par Jenny Bien-Aimé, Montréal, Éditions Somme toute, 2024, 32 pages, 25,95 $.
Surmonter le bégaiement est tout un sport
Lorsqu’une personne bégaie, c’est parce que le cerveau et les muscles n’ont pas travaillé en équipe.
Tel est le cas d’un jeune joueur
de soccer dans Moïse, l’athlète de
la parole, album de Stéphanie G. Vachon (texte) et Jenny Bien-Aimé (illustrations).
Moïse aimerait bien parler aussi facilement qu’il manie le ballon. Mais dans sa bouche les mots se répètent, restent pris et s’étirent. Le jeune athlète se questionne sur sa façon de parler, et bégayer le dérange de plus en plus.
À l’école primaire (années 1950), je bégayais passablement. On ne connaissait pas alors
le mot orthophoniste. Ni mes parents ni mes enseignantes savaient quoi faire pour m’aider à surmonter ce problème d’élocution. Cela ne m’empêchait pas d’être bavard en classe et d’être puni.
En 10e et 11e années, j’ai eu un professeur qui m’a proposé des exercices de diction.
Je crois que c’est grâce à son encoura-gement assidu et à mon propre degré de confiance que j’ai pu prendre le taureau par les cornes et réussir à parler un peu plus facilement. Étrangement, je bégayais moins en anglais.
Lorsque j’ai appris que les Éditions Somme toute publiaient Moïse, l’athlète de la parole, j’ai tout de go demandé un service de presse de cet album. En 32 pages, Stéphanie G. Vachon campe un jeune joueur de soccer aux prises avec un bégaiement gênant, voire humiliant. Il bute plus sur
les mots lorsqu’il semble vivre de grandes émotions ou lorsqu’il parle à des étrangers.
Grâce à son entraîneur au soccer, les tirs
de Moïse deviennent plus précis après
des centaines, voire des milliers d’essais. « C’est le même principe pour développer une parole fluide : il doit s’entraîner. » L’orthophoniste Julie devient son entraîneur de la parole.
Avec sa famille, Moïse n’est pas sans remarquer que bégayer est un sujet tabou. Juste d’en parler avec Julie, ça le soulage.
Il lui faut aussi mettre les bouchées doubles. Comme un sportif en vue d’une compétition, il se présente aux séances chaque semaine et se pratique constamment pour s’améliorer.
Ce qui est intéressant dans cet album, c’est que Moïse devient énergisé par ses progrès en orthophonie, au point de soumettre une demande à son entraîneur sportif : « Coach, j’ai toujours joué en défensive, sauf que jeee préfèrerais être à l’attaque. » Vous deviner qu’il va marquer un but.
L’album tisse si bien prouesses en sport et progrès en élocution que nous en venons à la seule conclusion qui s’impose : vouloir, c’est pouvoir.
L’auteure Stéphanie G. Vachon est ortho-phoniste; ses petits patients lui inspirent de grands personnages. Par ses couleurs et ses détails, Jenny Bien-Aimé illustre comment le texte ne dit pas tout.
5 juin 2025

Nelle Lamarr, La fille qui venait la nuit, roman traduit de l’anglais par Karine Forestier, City Éditions, 2025, 368 pages, 39,95 $.
L’indispensable
meurtrière
Auteure de thrillers psychologiques au suspense haletant et aux multiples rebondissements, Nelle Lamarr décrit la mince frontière entre justice et vengeance dans
La fille qui venait la nuit.
L’action se déroule à Los Angeles, lieu de résidence de l’auteure, et met en scène Marley, une nounou qui travaille de nuit pour Ava et Ned, de jeunes parents qui méritent « un gros 0/20 en rouge ».
Elle va rapidement devenir indispensable.
Ava croit que, avec cette nounou, les choses ne peuvent que s’améliorer pour elle et
son mari, pour le bébé et elle, pour tous
les trois. « L’infirmière Marley va réparer notre mariage. Et m’aider à garder mon secret », lit-on au début du roman.
Ned, pour sa part, est intelligent, plein de succès et aussi beau que Henry Cavill
(j’ai dû fouiller pour apprendre que Cavill est l’acteur britannique ayant joué le rôle de Superman). Ned affirme qu’il n’est pas fait pour avoir une femme ou un enfant.
Et quand l’homme d’affaires a un mal de tête, c’est « de la taille du Texas ».
Il maudit son père qui l’a forcé à marier Ava. Pourquoi ? La romancière entretient
le suspense. Ava, elle, regrette de ne pas avoir épousé Gabe, le meilleur ami de Ned.
Le mot « mari » a sur sa langue une consonnance si étrangère qu’elle n’a pas l’impression de l’appréhender. Alors pour ce qui est de le prononcer… Être avec Gabe est viscéral, tellement mal et pourtant tellement bien, ce qu’il y a de plus naturel.
Quant à la nounou Marley, elle a un corps tonique et svelte, son visage a des yeux exquis d’améthyste, à la fois violets et violents pour toiser sa cible. Cette célibataire a un quotient intellectuel de 165; selon la romancière, cela pourrait permettre à la nounou de « s’en sortir après un meurtre ».
J’ai appris, en passant, que les roses blanches peuvent symboliser la paix et l’amour, mais également la mort.
Le roman m’a surpris en signalant que
la criminalité à Los Angeles a augmenté de près de 25 % au cours des trois dernières années. Après Détroit et Chicago, Los Angeles est perçue comme la troisième ville la plus dangereuse des États-Unis, selon un récent sondage Gallup.
En lisant La fille qui venait la nuit, j’ai
eu l’impression que la romancière avait finement élaboré une intrigue, l’avait travaillée dans ses moindres détails, et avait réussi à nous sidérer puisque l’issue s’avère encore meilleure que ce que nous pouvions imaginer.
Or, dans une lettre de l’auteure à la fin
du roman, on apprend que Nelle Lamarr n’avait absolument aucune idée de l’intrigue lorsqu’elle a envoyé le résumé d’une histoire de nounou diabolique à
son éditeur. Dire que la romancière a paniqué quand elle a reçu le feu vert
serait un euphémisme.
Avec La fille qui venait la nuit, l'auteure cherche à « remettre le karma dans
la bonne direction. Justice ou vengeance ? La frontière est mince entre les deux.
Ou peut-être s’agit-il des deux faces
d’une même pièce. »
23 mai 2025
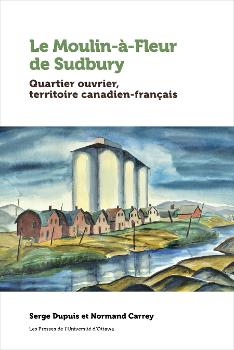
Serge Dupuis et Normand Carrey,
Le Moulin-à-Fleur de Sudbury, quartier ouvrier, territoire canadien-français, essai, Ottawa, Les Presses de l’Université
d’Ottawa et le Centre de recherche sur
les francophonies canadiennes, coll. Amérique française, 2025, 354 pages, 41,95 $.
Étude exhaustive
d’un quartier sudburois
Il y a un quartier urbain qui représente le fondement de la vie culturelle, économique et politique des Franco-Ontariens. Serge Dupuis et Normand Carrey le présentent et l’auscultent dans Le Moulin-à-Fleur de Sudbury, quartier ouvrier, territoire canadien-français.
Ce quartier correspond grosso modo aux frontières de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Le premier chapitre explique comment quatre décennies d’efforts (1902-1945), déployés par les Jésuites et les familles ouvrières canadiennes-françaises, ont suffi pour constituer un quartier, des institutions, une culture et une identité propre au Moulin-à-Fleur : catholique, ouvrière et francophone.
Le deuxième chapitre porte sur la période de 1946 à 1967, qui constitue l’âge d’or du Moulin-à-Fleur. On y naît, on y grandit et on s’y instruit : écoles Nolin, Sainte-Marie, l’Assomption et Collège du Sacré-Cœur.
On y travaille (Laberge Lumber) et on y consomme (épiceries Dominion et Lapalme).
Les auteurs notent que, « à leur apogée,
les 1 670 élèves des quatre écoles franco-catholiques du Moulin-à-Fleur représentent 65 % des élèves de langue française de la ville ». Les Sœurs grises
de la Croix et les Jésuites veillent au grain.
Dès les premières lignes de leur troisième chapitre, Dupuis et Carrey soulignent que les décennies 1970, 1980 et 1990 font subir un mauvais quart d’heure aux quartiers populaires. « Le renouveau urbain,
la prolifération de l’automobile personnelle ainsi que le développement des banlieues et des centres commerciaux, écrivent-ils, accélèrent la dévitalisation des vieux quartiers ethniques. »
Pendant ces trois décennies, les Moulin-à-Fleurois ne se résignent pas aux courants
à la mode qui les laisseraient au dépourvu. Recommencer, créer, croire et se mettre en valeur demeurent toujours à l’ordre du jour.
Le Moulin-à-Fleur est le seul endroit à Sudbury où l’on obtient une offre active de services en français dans les commerces. Alors que le Centres des Jeunes et les Éditions Prise de parole emménagent dans l’ancien Hôpital Saint-Joseph au centre-ville, le Théâtre du Nouvel-Ontario opte plutôt pour le Moulin-à-Fleur.
Le quartier réussit à freiner l’érosion de
la qualité de vie et à se mettre en valeur. Mais les investissements pour développer les routes vers les banlieues et construire un collège francophone en périphérie privent le Moulin-à-Fleur de sommes publiques significatives.
Le dernier chapitre de ce monumental essai démontre que la conjoncture à laquelle est confronté le Moulin-à-Fleur depuis 1998 n’est pas facile. Or, « le développement économique et l’amélioration de la gou-vernance municipale indiquent qu’une prise en charge demeure possible. »
Le quartier ne vit pas ses dernières heures, loin de là, « mais il n’est pas encore sorti
de l’auberge ».
Le Moulin-à-Fleur de Sudbury est
un ouvrage truffé d’environ 1 000 notes
en bas de page. La bibliographie compte quelque 230 sources primaires et secondaires (journaux, fonds d’archives, articles, thèses, mémoires, textes législatifs, entretiens, courriels et sondages). C’est de loin la première histoire exhaustive du quartier, de ses origines à nos jours.
4 mai 2025

Luc Martel, L’Étranger de l’Isle-aux-Grues, tome 2 : Un rêve inachevé, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 328 pages, 26,95 $.
Un roman où fiction
et faits historiques font
bon ménage
Eva et Frédérick sont de retour
dans un second tome de L’Étranger de l’Isle-aux-Grues. Luc Martel
les campe dans une intrigue qui
se déroule au rythme des anses et des falaises plongeant dans le fleuve Saint-Laurent.
Nous sommes en 1947 et le bonheur
de ce couple est menacé de toutes parts. Maintenant professeur de musique à l’Université Laval, Frédéric subit la pression d’un espion soviétique qui cherche à
le contraindre à retourner dans son Allemagne natale.
Pour Eva, connaître la maternité demeure essentiel à son bonheur. L’épouse est heureuse d’avoir Frédéric à ses côtés,
mais elle a davantage d’amour à donner. Luc Martel exploite ce filon pour farcir son roman d’intrigues douloureuses, pour
ne pas dire criminelles. On assiste à la plénitude de porter la vie, puis à la peine énorme de voir tout s’effondrer.
La trame romanesque oblige Eva à mentir plus d’une fois. Si certains s’enfargent dans les fleurs du tapis, elle espère juste pouvoir s’habituer à ne pas trop s’enfarger dans ses menteries. Il faut dire que la jeune femme a de l’expérience puisqu’elle a réussi à cacher l’origine de son Allemand à tout le monde pendant des mois.
Le roman regorge de rebondissements spectaculaires. Frédéric, qui a connu la violence des nazis, sait que les hommes sont capables des pires atrocités en temps de guerre. « Seulement, il ne pouvait concevoir que, dans la vie de tous les jours, un individu utilise sa force physique pour terrasser une femme et la violer. »
C’est souvent autour d’un repas que
la parenté se serrent les coudes. À une
de ces occasions, les femmes préparent
« des darnes d’esturgeon assaisonnées
de sel, de poivre et de salicorne séchée, ramassée sur les battures à marée basse ».
Nous avons droit à quelques ébats amoureux avant le mariage, où « la gêne
et la pudeur initiales [font] place à une intimité parfaite… malgré les avertissements répétés du curé ». Dans le cas des deux ados concernés, jamais il ne leur vient à l’esprit qu’ils commettent un péché grave.
Frédérick est un violoniste réputé, invité à se produire sur les plus grandes scènes
tant au Québec qu’aux États-Unis. Lors
d’un mariage, il a l’occasion d’interpréter
La marche nuptiale de Mendelssohn et
le Canon en ré majeur de Pachelbel.
Le curé, pour sa part, livre un sermon interminable sur la fidélité et les responsabilités des époux. « Eva tressaille lorsque l’homme en soutane évoque l’obligation d’obéissance de la femme, alors que l’époux n’est pas soumis à la même règle. »
Elle se demande combien de temps il faudra attendre pour que cette règle stupide soit abolie. Heureusement, Eva ne
se sent pas concernée, car Frédéric n’a jamais exigé la soumission, « sachant fort bien qu’il serait vain d’essayer ».
Ce roman m’a appris pourquoi on ne souhaite pas bonne chance à un artiste avant son entrée sur scène; on lui dit plutôt Merde! Pourquoi? Selon le romancier, l’expression aurait commencé à être utilisée au siècle dernier lorsqu’on se déplaçait à cheval ou en calèche.
« Si un concert ou une pièce de théâtre connaissait un certain succès et que l’achalandage devant la salle était si grand, il y avait inévitablement beaucoup de crottin de cheval dans la rue. Alors, depuis ce temps, les artistes se souhaitaient beaucoup de merde. »
Le style de Martel est souvent coloré. Lorsqu’une pente est abrupte, il écrit :
« ça monte comme dans le front d’une bœuf ». Il joue parfois sur les mots, notamment lorsque monsieur Beaulieu baptise son bateau Le Beau Lieu, en référence à l’Isle-aux-Grues, « un beau lieu pour vivre ».
D’une plume évocatrice, Luc Martel entremêle fiction et faits historiques méconnus avec brio pour peindre des tableaux savoureux, où les émotions fortes se mêlent aux embruns marins du Saint-Laurent.
22 avril 2025

Simon Boulerice, Ma vie au micro-ondes, récit d’infortunes culinaires, Montréal, Éditions Cardinal, 2025, 198 pages, 29,95 $.
Simon Boulerice,
hôte terrible
et excellent hôte
Si la nourriture que l’on avale nous aide à nous propulser, le four à micro-ondes domestiqué dans
les années 80 est un ressort nécessaire à chacun des bonds en avant de Simon Boulerice qui signe Ma vie au micro-ondes, récit d’infortunes culinaires.
Cet électroménager a changé sa vie.
La table des matières va de Comment fonctionne votre four à micro-ondes… jusqu’aux Trucs qu’il est bon de connaître, en passant par Hors-d’œuvre, Soupes, Viandes, Poissons et fruits de mer, Desserts, Gâteau et tartes. Ce ne sont que des titres de chapitres; n’y cherchez pas des suggestions de recettes au micro-ondes.
Pour les Soupes, Boulerice se rappelle comment sa grand-mère Janine « mélangeait tous les légumes et ça goûtait la vitamine autant que le ciel ». Rien à voir avec une soupe aux pois Habitant en canne.
Jehane Benoît publie son classique L’encyclopédie de la cuisine canadienne
en 1963. La cuisine micro-ondes paraît
en 1975. Boulerice ponctue son récit
de dialogues fictifs avec celle qu’il qualifie de « Julia Child québécoise ».
S.B. : Le journaliste t’appelait Jehane comme Jeanne. C’est-tu ça qui faut dire?
J.B. : J’te l’ai dit : tu dis c’que tu veux, Simon.
S.B. : Bon, ben, je retourne à ma narration, OK?
J.B. : Vas-y. Je te lis. Mais juste avant, j’vas m’assurer que tout est beau avec ton four.
S.B. : C’est donc ben smatte!
Simon Boulerice fait souvent référence à son amant Philippe qui maîtrise chaque bouton, contrairement à lui qui contrôle juste la touche Popcorn. « Ma tâche, dans notre relation culinaire amoureuse, est de laver les chaudrons et els poêlons. »
Quand le couple reçoit, Philippe sort
la nappe et ses meilleures bouteilles. Simon se contente de ses napperons de chats et
de son carton de jus Oasis. Il précise que
le mot « hôte » dit une chose et son opposé : la personne qui reçoit et celle qui est reçue. « Je suis un hôte terrible, mais
je suis un excellent hôte. »
Philippe cuisine si bien que Simon a
les lèvres perpétuellement lubrifiées à force de saliver devant le repas que Philippe lui concocte. Lubrifiées, non lubriques, lol!
En lisant Ma vie au micro-ondes, j’ai
appris que, au Québec, voir quelqu’un
dans sa soupe, c’est en être amoureux.
Depuis son enfance, Simon a une féroce passion pour toutes les sortes de fromages, du Gorgonzola au Velveeta, du Pied-de-Vent au triangle La vache qui rit, jusqu’au plus ludique de tous : le mini Babybel dans son écrin de cire rouge, « avec les promesses de clownerie qu’il recèle ».
Comme l’auteur, je persiste à percevoir
la tomate comme un légume, bien que
ce soit un fruit. Certaines certitudes ne se désapprennent pas. Et à son instar, « c’est dans le lavabo que je procède à ma détente Palmolive ».
Comédien bien connu, Simon Boulerice note qu’il n’a aucune créativité dans la cuisine
ni aucun instinct, à part danser sur du Rihanna entre les électroménagers. Lorsqu’il écrit, c’est dans la salle à manger, en périphérie du frigo. Le four micro-ondes n’est jamais loin.
Né en 1982, Simon Boulerice possède
une impressionnante collection de cordes à son arc. Comédien, dramaturge, scénariste, animateur, danseur, chroniqueur, poète, romancier, nouvelliste et auteur prolifique pour la jeunesse, il est l’une des figures centrales de la scène culturelle québécoise.
16 avril 2025

Jean-Pierre Charland, Le bien d’autrui
tu ne prendras, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 416 pages, 27,95 $.
Encouragé par plus d’un million de lecteurs au Canada et en Europe, Jean-Pierre-Charland puise de nouveau dans les Commandements de Dieu pour nous offrir Le bien d’autrui tu ne prendras, sixième enquête d’Eugène Dolan, inspecteur de police à Montréal en 1912.
Ce roman historique s’ajoute à Père et mère tu honoreras (2016), Un seul Dieu tu adoreras (2018), Impudique point ne seras (2019), Homicide point ne seras (2022) et L’œuvre de chair ne désireras (2023).
L’inspecteur Dolan doit enquêter sur deux crimes, l’un impliquant un homme disparu et l’autre, plus compliqué, portant sur
un détournement de fonds. Le romancier nous conduit dans les bas-fonds de la ville, d’une part, et dans le monde des affaires, des banquiers et d’autres gros bonnets pour qui la discrétion est une vertu cardinale, d’autre part.
Dans un cas comme dans l’autre, la justice avance prudemment, donc lentement, ce qui autorise Charland à noircir facilement 400 pages. Il nous montre Dolan qui, pour fouiller l’âme d’un suspect, a tantôt recours à une voix onctueuse, tantôt à une voix d’inquisiteur. Afin d’obtenir des informa-tions essentielles, l’inspecteur n’hésite pas
à interroger des mauvais garçons.
L’enquête principale porte sur Henri Lamoureux, comptable à la Banque d’Hochelaga. Il est poursuivi pour fraude, pour avoir rédigé de faux chèques d’un gros montant, puis de les avoir encaissés dans une autre banque en se présentant sous une identité d’emprunt.
Le romancier écrit : « Se faire voler par
les Anglais, ça, tout le monde s’y attend. Mais par d’autres Canadiens français, c’est vécu comme une trahison. » Les relations entre francophones et anglophones sont subtilement auscultées dans Le bien d’autrui tu ne prendras.
Autre dichotomie : un fils de bonne famille peut purger trois ans dans la très moderne prison de Bordeaux après avoir volé trente-cinq mille dollars; un autre, né dans un logement d’arrière-cour, peut y croupir pendant dix ans pour en avoir subtilisé cinquante.
Dans le Québec des années 1910, la messe est une obligation incontournable chaque dimanche matin. Henri Lamoureux sait que se soustraire à « ces simagrées ridicules » entraînerait « sa mise au ban de la société ».
Quelques chapitres nous conduisent chez
le bijoutier Birks. Ceci permet à l’auteur d’écrire que ces « maudits Anglais arrivaient sans trop se forcer à donner
des complexes d’infériorité à n’importe
quel Canadien français ».
Dans ce roman, certains personnages portent des prénoms aujourd’hui fort inusités comme Achille, Perpétus, Rédempteur, Pacifique, Zéphire et Gabélius. On passe d’une vieille masure dans
une ruelle plutôt infecte à un logis sale et délabré pour découvrir que « certains milieux ne peuvent produire autre chose que des criminels ».
Il y a une référence à Ottawa, ville décrit comme un endroit où on meurt d’ennui à moins de se passionner pour la politique. Charland mentionne la nouvelle gare Union (1911), le poste de police de la rue Elgin et le marché By. En face, à Hull, il y l’usine
de la E. B. Eddy.
À travers les yeux d’Eugène Dolan, inspecteur perspicace qui enquête sur
un crime de col blanc, nous découvrons
le Montréal tour à tour prolétaire, bourgeois, familier ou insolite de 1912.
6 avril 2025

Gilles Lacombe, Chétive magnificence – Anthologie 2000-2025, poésie, préface de François Paré, Ottawa, Éditions L’Interligne, 2025, 216 pages, 23,95 $.
Seule la poésie est rivée
à l’essentiel
Depuis un quart de siècle, Gilles Lacombe se loge à l’enseigne
d’une écriture singulière, expression de la quête métaphysique et spirituelle d’un poète qui a su s’élever au-dessus des modes et construire une œuvre qui puise à l’essence des choses et des êtres.
Lacombe a choisi de réunir des extraits
de treize recueils publiés aux Éditions L’Interligne entre 2000 et 2022, plus un texte inédit, pour créer une anthologie qui s’intitule Chétive magnificence. Il explique, en avant-propos, que des changements s’imposaient pour assurer une claire lisibilité.
Il a d’abord fallu avoir recours à une typographie et à une mise en page uniformes, différentes de celles des recueils. Il a aussi été décidé de faire disparaître
la dimension picturale qui jouait un rôle dans la construction de certains poèmes (Lacombe est également artiste visuel).
Dans sa préface à cette anthologie, François Paré écrit : « Comme le peintre qu’il est aussi à ses heures, le poète devenu observateur n’est jamais indifférent à ce qu’il voit. Au contraire, le visible ne cesse de l’interpeller; et ce qu’il veut saisir en
ces moments plus contemplatifs de sa vie, c’est la nature même de cette convocation que le paysage met en œuvre. »
Le préfacier se demande pourquoi Lacombe n’a pas opté plutôt pour le roman. Idée qui est rejetée du revers de la main parce que « la trame romanesque est un spectacle qui ne peut qu’éloigner l’écriture de l’essentiel ». La poésie, quant à elle,
se tient à l’écart de la « vie fomentée, manigancée » (propre au roman) pour devenir une « chétive magnificence ».
François Paré conclut que les textes du poète incarnent « le désir de transfiguration de soi qui anime toute l’œuvre de l’écrivain ». Il ajoute que la poésie de Lacombe est « cette hésitation, cette défaillance, ce clair-obscur, qui le libèrent de l’arrogance de la littérature ».
L’anthologie commence par des extraits
du recueil Éphémérides et courants d’air (2000). On y lit : « Je le dis simplement;
s’il y a une chose que j’ai accomplie jusqu’ici, c’est regarder et contempler des paysages. Aussi ai-je appris à les accueillir avec modestie et recueillement, dans l’ignorance de ce qu’ils voudront bien que je retienne de leur passage; aussi en suis-je venu à les considérer comme des verbes imaginaires qui ont parfois la capacité de révéler les autres vies que l’on porte en soi et tout l’effet des dormeurs dans la lumière. »
Le recueil termine par le poème inédit Presque, sur cette note : la poésie est « Celle qui a été pénétrée / Corps et âme / Par l’esprit / Partout vivant / D’une chétive et limpide magnificence ».
Né à Ottawa en 1946, Gilles Lacombe a publié une vingtaine de livres, surtout des recueils de poèmes, dont plus de la moitié aux Éditions L’Interligne. Il est aussi artiste visuel, ayant exposé ses œuvres dans la région d’Ottawa et au Mexique.
3 avril 2025
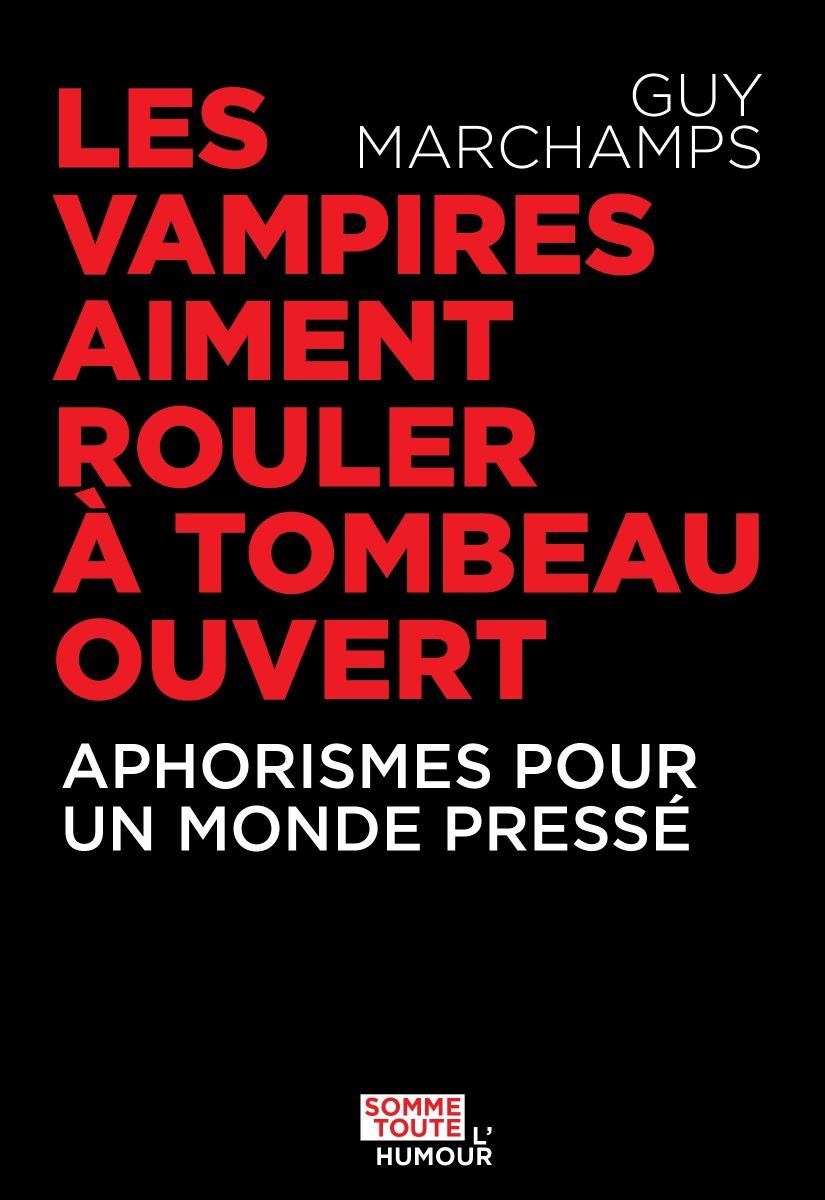
Guy Marchamps, Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert. Aphorismes pour un monde pressé, Montréal, Éditions Somme toute, coll. L’humour, 2025, 112 pages,
19,95 $.
Jeux de mots tendres, humoristiques ou corrosifs
Que dit un écrivain sur son lit
de mort? «Je suis en phrase terminale.» Voilà la première de quelque 750 perles littéraires que Guy Marchamps nous sert, rire en coin, dans Les vampires aiment rouler à tombeau ouvert. Aphorismes pour un monde pressé.
L’aphorisme est un procédé d’écriture – souvent basé sur un jeu de mots – qui résume une idée, une opinion, un concept ou une vision du monde dans une phrase concise et percutante. Le pouvoir d’évocation de ces trouvailles réside justement dans leur brièveté.
Les aphorismes de Marchamps sont tantôt poétiques, tantôt humoristiques. Ils relèvent tour à tour les absurdités de la vie, les contradictions au cœur de tout être humain, les petits et les grands bonheurs de la vie.
Les quelque 750 aphorismes sont présentés à la queue-leu-leu, sans thématiques.
Je me suis permis d’en regrouper une vingtaine sous cinq rubriques de mon cru :
Écriture
- J’aime bien qu’il y ait le mot «vain»
dans «écrivain», cela incite à la modestie. Ah, oui! Et aussi le mot «rire» dans «écrire».
- Souvent et curieusement, les écrivains griffonnent dans des cafés qui ne paient
pas de mine.
- L’arbre aime les vers de Racine, mais sur ses branches, les corvidés préfèrent Corneille.
- Le poète est nu comme un vers.
- L’homme invisible a beau être invisible,
il laisse des traces. (Je n’ai pas pu faire autrement que penser au recueil du poète Patrice Desbiens, L’homme invisible /
The Invisible Man.)
Politique
- Quelle boucherie que cette révolution! Les Français n’avaient plus toute leur tête.
- Il n’y a pas de trou assez profond sur notre planète pour enterrer la hache de guerre.
- Dans l’eau chaude, le homard change
de couleur, le politicien, de sujet.
- Une société est riche quand elle n’a plus besoin de banques alimentaires.
- Beaucoup de personnes à Gaza demandent l’aide médicale à nourrir.
Cuisine
- Les chauves adorent la laitue frisée.
Le capitaine de bateau déteste la iceberg.
- César, avant d’être une salade, était un vieux croûton assoiffé de pouvoir.
- Il avait tellement l’estomac dans les talons qu’il se contentait de manger de la semelle de botte.
- Tout le monde déteste être dans le pétrin, sauf le boulanger.
- Comment reconnaître un végan? Il a une tête de violon, des pieds de céleri et un cœur d’artichaut.
Religion
- Pour entrer au Vatican, il faut montrer pape blanche.
- On a fini par savoir que Noé avait construit son arche en planches de salut.
- Accumulez des points cardinaux et devenez pape!
Quotidien
- Problème épineux, il s’est fait passer
un sapin.
- Il était à cheval sur ses principes et montait régulièrement sur ses grands chevaux.
- Curieux: il faut toujours que l’argent sale soit remis en mains propres.
- Tout aussi curieux: l’avocat qui défend
les organisations criminelles devient souvent un gros légume.
Je ne vous cacherai pas que je me suis versé un verre de Vouvray et que je me suis installé dans mon fauteuil préféré pour savourer avec plaisir ces aphorismes parfois tendres ou humoristiques, souvent caustiques ou corrosifs.
27 mars 2025

Marine Sibileau, L’assainisseur, roman, Ottawa, Éditions David, coll. Indociles, 2025, 120 pages, 24,95 $.
Plonger dans les abîmes
de l’âme meurtrière
Chercher à percer les mystères d’une psyché déviante peut-il être contagieux ? Voilà la question
à laquelle la romancière Marine Sibileau tente de réponde dans L’assainisseur. On oscille dangereusement entre les frontières du bien et celles du mal.
Le roman est composé d’une douzaine
de chapitres qui alternent entre le journal intime du tueur P. et les notes du journaliste chevronné Ajay Kapoor qui l’interview à cinq reprises. Le lieu de l’action n’est jamais précisé.
P. déteste le mot meurtre qui sonne trop barbare à son goût; il parle plutôt d’assainissement et se voit donc comme
un assainisseur. En trente ans, il a assaini 77 personnes avant d’être arrêté et mis
en prison.
P. est le vingt-septième tueur que le journaliste Ajay Kapoor interview. Dans
la salle de rédaction, ses collègues le surnomment Kapooral Psycho, spécialiste des psychopathes. Ce qui fait de Kapoor
un des meilleurs intervieweurs de tueurs en série de sa génération, c’est sa facilité
de « les mettre en confiance sans qu’ils m’atteignent ».
P. confie à son journal qu’il assainit
pour rendre justice à ses concitoyens.
« Je rends service en neutralisant les êtres indésirables qui ne méritent pas de faire partie du groupe. » Il n’est pas comme ces tarés qui tuent pour le seul plaisir de tuer.
P. a tué ou assainis sans jamais avoir recours à une arme, sans jamais toucher ses victimes. Il met en poudre des champignons vénéneux et camoufle le tout dans un verre de vin ou une tasse de café. « Pas une seule goutte de sang ! Que demander de mieux ? »
Ajay Kapoor note dans son carnet qu’un tueur tue, alors qu’un meurtrier commet un homicide volontaire qui peut être prémédité ou le fruit d’une impulsivité. Quant à l’assassin, il « prémédite un homicide mûri et préparé avec minutie, souvent pour de l’argent ou un gain quelconque ».
Lorsque P. explique à Kapoor pourquoi il a choisi tel individu et décidé de le prendre comme cible, le journaliste est perturbé de constater un « manque flagrant de compassion à l’égard du genre humain ». Le regard de P. trahit dès lors son esprit dérangé.
Un personnage secondaire du roman
est l’épouse d’Ajay Kapoor, Radhika.
On découvre que le mari ne connaît pas
à 100 % sa douce moitié. « Les mystères sommaires se dévoilent très vite dans
une relation, mais la profondeur de l’âme reste sous clé pendant des décennies, inviolable aux yeux des autres, même de son conjoint. »
Marine Sibileau utilise parfois des mots rares. Elle écrit qu’un je-ne-sais-quoi remue son for intérieur « tel un allergène ». Elle souligne que l’esprit de P. est absent, perdu au plus profond des pensées de « son système limbique ».
Et la police découvre chez P. des « petits champignons lyophilisés ».
Ce court roman d’à peine une centaine de pages vous réserve une fin inattendue mais pourtant tricottée finement d’un chapitre à l’autre. La surprise n’en demeure pas moins de taille…!
Originaire de France, Marine Sibileau vit à Toronto depuis plus de dix ans. Écrivaine, mais aussi scénariste, elle collabore depuis longtemps à la création de séries télévisées éducatives en français. Quand elle n’est pas en train d’écrire, Marine aime peindre des tableaux inspirés du pointillisme, son style artistique préféré.
En 2023, Sibileau a publié aux Éditions L’Interligne Les nuages du métro. L’assainisseur est son premier roman
aux Éditions David.
13 mars 2025

Claude Vaillancourt, La force de ceux qui n’en ont plus, récit, Montréal, Éditions Somme toute, 132 pages, 19,95 $.
Trois cas pour décortiquer
le suicide
Le Québec compte, en moyenne, trois suicides par jour. Claude Vaillancourt se penche sur cette septième cause
de mortalité dans La force de ceux
qui n’en ont plus, un récit très
intimiste qui se veut un vibrant exercice de partage.
Pour exorciser une obsession variable en intensité, l’auteur se penche sur le parcours très différents de trois personnes identifiées uniquement comme l’ami G., mon frère et l’amie L., tous unis par leur mort volontaire,
le suicide. L’expérience vise à « trouver
un quelconque sens, voir aussi un peu à l’intérieur d’eux, mais tout autant à l’intérieur de moi-même »
G. est un premier de classe, imbattable dans toutes les matières. Ses liens difficiles avec
les femmes le ramènent cependant « à une solitude insupportable » dont il ne parvient pas à sortir. C’est trop lourd pour lui.
Le suicide est sa seule porte de sortie.
Il l’envisage « de façon quasiment rationnelle ». Il passe à l’acte après avoir consulté en vain un psychiatre.
Le frère de l’auteur est une bombe à retardement, « c’est-à-dire une personne tranquille, mais à qui il peut arriver les choses les plus inattendues à un moment imprévu ». Claude Vaillancourt le décrit comme quelqu’un qui était incapable d’accorder son moi profond avec ce qui rend la vie agréable. Cette difficulté est ce qui l’a amené à s’enlever la vie.
L’amie L. est professeure à l’Université du Québec à Montréal, spécialisée dans le droit
du travail. Bipolaire, elle souffre de phases d’excitation maniaques suivies de moments
de grande déprime. Puis on lui diagnostique une dégénérescence frontale temporelle, soit un déclin des fonctions cognitives avec
une altération du système de la pensée,
du jugement et de l’apprentissage. « Je ne
peux pas vivre avec ça. »
G. le frère et L. se retrouvent tous dans des situations où ils ne réussissent pas à vaincre des démons intérieurs. Ils se débattent chacun à leur façon avec des douleurs que leurs proches ne soupçonnent guère.
Chaque suicide nécessite sa propre explication. Derrière G. le frère et L. se cache un roman tragique, voire une histoire compliquée dont on ne s’arrête pas de démêler les fils.
Le titre du récit de Vaillancourt s’inspire de
la nouvelle « L’endormeuse », où Guy de Maupassant affirme que le suicide est
« la force de ceux qui n’en ont plus ». L’écrivain français ajoute que le suicide,
« c’est l’espoir de ceux qui ne croient plus, c’est le sublime courage des vaincus ».
Cela vaut pour G. le frère et L.
Vaillancourt cite des œuvres de plusieurs écrivains, notamment Le mythe de Sisyphe, d’Albert Camus; Leçons de philosophie, de Simone Weil; Le suicide, d’Émile Durkheim;
La difficulté d’être, de Jean Cocteau; Les temps difficiles, de Charles Dickens. Cela donne à
son ouvrage une grande subtilité et finesse, symbiosant récit autobiographique et essai.
4 mars 2025

Deni Ellis Béchard, La Blanchité aveuglante : réflexions sur le racisme, essai traduit de l’anglais par Barbara Caretta-Debays, Montréal, Éditions Écosociété, coll. Parcours, 2025, 192 pages, 25 $.
Combattre le racisme
ancré en nous-mêmes
Désireux de partager des idées qui pourraient aider d’autres personnes à explorer la façon dont elles ont elles aussi été éduquées à être racistes, Deni Ellis Béchard a écrit
La Blanchité aveuglante :
réflexions sur le racisme.
À noter que ce livre n’est pas encore paru dans sa version originale anglaise. Il a été édité et traduit simultanément chez Écosociété. Il s’agit donc d’un inédit.
La « Blanchité aveuglante » est une formule empruntée au philosophe Charles W. Mills dans The Racial Contract (1997). L’essai de Deni Ellis Béchard demeure
une quête introspective et profondément humaniste où l’auteur cherche à comprendre comment les idées racistes
ont structuré sa pensée, ses attitudes, et comment elles façonnent encore la société tout entière.
L’auteur précise que qu’il n’est pas nécessaire de lire son livre de façon linéaire. On peut sauter des chapitres et c’est ce que j’ai fait pour me concentrer, entre autres, sur le rôle des blagues racistes et sur ce que l’auteur appelle le racisme bienveillant.
Béchard explique comment il a grandi
dans un environnement où on lui a appris à rire des autres cultures. Il écrit que
« les blagues, aussi insignifiantes qu’elles puissent paraître, influencent nos perceptions dès le début de notre développement et peuvent avoir des implications profondes sur la valeur que nous accordons à la vie des autres ».
Des blagues racistes au racisme bienveillant, il n’y a qu’un pas allègrement franchi. Lorsqu’un Blanc dit que ce Noir-là est un bon travailleur, on entend moins ce qui est affirmé que ce qui est sous-entendu sur la vaste majorité des autres Noirs.
Le language, écrit Béchard, est bien plus que des définitions dans le dictionnaire.
Il est fait d’intonations, d’inflexions, de pauses, de gestes et de cadences qui peuvent faire écho à quelque chose de dégoûtant, de méprisable, de dangereux. « Autrement dit, une personne Blanche peut proférer une insulte raciste sans
même avoir à la prononcer. »
L’auteur souligne qu’en entendant les Blancs parler et en voyant leur méfiance
à l’égard des Noirs, il a « assimilé deux ensembles de codes pour interpréter
les émotions humaines : un pour les Blancs
et un autre pour les Noirs – fondés, il va sans dire, sur les interprétations des Blancs ».
Qu’il s’agisse de la violence du langage,
du racisme « bienveillant », des fantasmes de supériorité et de victimisation, de représentation et d’appropriation culturelle, Deni Ellis Béchard livre un portrait sensible et sans détour de ses expériences liées au racisme envers les personnes Noires etles Autochtones.
Il espère « qu’en remettant en question les fictions sur lesquelles repose la Blanchité et en parlant franchement de la façon dont le racisme façonne nos esprits, nous pourrons en finir avec notre aveuglement et commencer à nous engager dans les solutions juridiques et matérielles nécessaires à la construction d’une société juste et équitable ».
Un essai puissant, pour sortir de notre aveuglement collectif et combattre
le racisme ancré en nous-mêmes.
15 février 2025

Jules Richard, Paul-Émile Borduas. Tableaux d’une vie, biographie, Montréal, Éditions Somme toute 2025, 84 pages, 19,95 $.
Paul-Émile Borduas
a brisé les cadres de l’art
Pour connaître Borduas de façon succincte, il faut lire Paul-Émile Borduas. Tableaux d’une vie, de Jules Richard. Ce sont trente tableaux
où s’entremêlent la vie (1905-1960) et l’œuvre d’un artiste visionnaire.
Né le 1er novembre 1905 à Mont-Saint-Hilaire (Québec) dans une famille catholique, Paul-Émile Borduas est d’abord formé à l’art religieux par Ozias Leduc.
Il n’aura jamais cessé de chercher, de se réinventer, de briser les codes.
Borduas publie le pamphlet Refus global
en août 1948, « un brûlot anticlérical »
qui va lui valoir l’opprobre de la société québécoise alors marquée par l’obscuran-tisme. Ironiquement, Borduas va mourir juste au moment où allait se lever le voile noir qui avait tenu le Québec dans l’ignorance.
Largement rédigé par Borduas, Refus global est signé par 8 hommes et 7 femmes,
une parité qui était loin d’être la norme à cette époque. Outre Borduas, on trouve Madeleine Arbour, Marcel Barbeau, Bruno Cormier, Marcelle Ferron, Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, Muriel Guilbeault, Fernand Leduc, Thérèse Leduc, Jean-Paul Mousseau, Maurice Perron, Louise Renaud, Françoise Riopelle, Paul Riopelle et Françoise Sullivan.
Refus global est tiré à 600 exemplaires et vendu à 1,50 $. « C’est un plaidoyer contre le cléricalisme qui engendre la peur et bâillonne la société canadienne-française de l’époque. » En raison des propos incendiaires contre le clergé, le succès du Refus global est loin d’être instantané.
Des années plus tard, Marcelle Ferron
dira que Refus global s’inscrivait dans
la continuité du tempérament de Borduas, « éternel révolté contre les injustices sociales, la collusion entre l’Église et l’État ».
Avant de s’établir à Paris, Borduas séjourne aux États-Unis (Provincetown et New York). Sa difficulté à s’exprimer en anglais l’empêche de s’épanouir pleinement au sud de la frontière. Les ventes ne seront pas
au rendez-vous lors de deux expositions, mais ce sera une belle reconnaissance.
Paul-Émile Borduas peint à Paris des toiles d’inspiration américaine. Tout comme Anne Hébert qui a écrit les plus belles pages sur le Québec en vivant à Paris, Borduas avait peut-être besoin de prendre du recul,
de la distance.
« Borduas aime intellectualiser son travail. De l’évolution de sa peinture et de son abandon de la couleur, il dira vouloir atteindre une plus grande objectivité,
une plus grande perspective. » Sa dernière œuvre s’intitule Composition 69 (1960) où d’épais pâtés de noirs appliqués à la spatule laissent filtrer un peu de blanc vers
le haut.
Dans un de ses trente tableaux, Jules Richard présente Borduas et Riopelle comme deux frères ennemis, comme « Caïn et Abel au pays de l’art ». Même des années après la mort de Borduas, ce n’est que du bout des lèvres, et encore, que Riopelle reconnaîtra son influence sur son travail artistique.
Décédé le 22 février 1960 à Paris, Borduas aura été un véritable chef de file de l’automatisme au Québec. Il aura servi d’inspiration à toute une génération de peintres : Riopelle, Mousseau, Ferron, Barbeau, pour ne nommer que ceux-là.
5 février 2025

Martine Noël-Maw, Le secret de Luca, roman, Regina, Les Éditions de la nouvelle plume, 2025, 130 pages, 16,95 $.
L’art d’être passionné
et authentique
Auteure de dix-sept livres dont
une douzaine pour la jeunesse, Martine Noël-Maw a récemment signé un roman qui touchera une corde sensible chez les jeunes adolescents en quête d’identité. Dans Le secret de Luca, le réel
et le surnaturel se côtoient.
L’histoire se déroule principalement à Regina (Saskatchewan). Le protagoniste Luca Gervais est un bel ado de 13 ans, qui se trouve plate, inutile, rejeté, pas bon dans les sports et poche en maths.
Le chien de Luca est un sheltie appelé aussi colley miniature. Il s’appelle Lasso,
un clin d’œil à la télésérie Lassie. Avec un tel nom, Luca marie son amour des chiens et sa passion pour l’univers des cowboys.
Lasso est le nom du chien, mais ça peut aussi vouloir dire qu’on est pris, capturé. Luca est de toute évidence captivé par
son amour pour Lasso, mais également « pour la lecture et pour les histoires ».
Luca met la main sur le livre Smoky de Will James. C’est une histoire écrite dans
un anglais souvent biscornu, où le cowboy Clint fait preuve d’ingéniosité pour dresser un cheval doté d’un incroyable esprit d’indépendance. Clint réussit à en faire
un compagnon d’une fidélité indéfectible.
Luca est ébahi par l’originalité de cette histoire qui se passe entre un homme et
un animal. Il n’a jamais rien lu de semblable. Sans le savoir, Smoky va l’aider à dealer avec son mal-être, son inconfort, son absence de joie et d’espoir.
J’ai utilisé l’anglicisme dealer à bon escient puisque la romancière conserve des mots anglais dans son récit. Lorsqu’il est question de rodéos, les chevaux sauvages sont appelés des outlaws. Le Far-West regorge de chuck wagons.
Dans certains dialogues, Martine Noël-Maw inclut plusieurs mots en anglais. En voici quelques exemples : « ça brasse dans ton think tank, j’ai eu le guts de foncer, je suis down, c’est pas winner, apprendre à dealer avec ça, le thrill de monter une bête ».
J’ai mentionné, au début que le réel et
le surnaturel se côtoient dans ce roman. Sans dévoiler le secret de Luca, je peux vous signaler qu’il va rencontrer Will James, décédé presque 80 ans plus tôt. Ce sont
les pages les plus enlevantes, celles qui nous prennent aux tripes.
Selon Will, « quand on a la chance de
venir au monde avec une passion, le moins qu’on doit faire c’est de la suivre et de ne pas écouter les wet blankets » (éteignoirs). « Peu importe ce que tu fais et où tu le fais, ce qui importe vraiment c’est d’être authentique. »
William Roderick James (Will), de son vrai nom Ernest Nephtali Dufault (1892-1942),
est né à Saint-Nazaire-d’Acton (Québec)
en 1892 et décédé à Los Angeles en 1942.
Il s’est surtout fait connaître comme écrivain et artiste illustrateur aux États-Unis.
Le cinéaste québécois Jacques Godbout a réalisé en 1988 un long métrage documen-taire sous le titre Alias Will James. Il relate la vie de ce cowboy sous l’angle du mythe américain.
Je signale, en passant, que le roman inclut une référence à l’artiste visuel fransaskois Joe Fafard et au roman La plus grosse poutine du monde, de la Franco-Ontarienne Andrée Poulin.
26 janvier 2025

Mélanie Côté, Éveline, roman, Montréal, Éditions Fides, 2024, 236 pages 26,95 $.
Une femme de nouveau à l’honneur dans un roman de Mélanie Calvé
Montréal et Rimouski, 1923.
Une femme et son enfant en fuite. Une famille qui ouvre ses bras.
Voilà le matériau que Mélanie Côté sculpte avec doigté dans Éveline,
un roman sur le défi de rebâtir
une vie.
« Je fais ce que je veux, quand je le veux, pis si je veux le battre jusqu’à ce que j’en fasse un homme, c’est pas toi qui vas m’en empêcher. » Ainsi s’exprime Albert lorsqu’il frappe son fils François, 3 ans, et saisit son épouse Éveline par le cou. Cette dernière pose un geste irréparable et s’enfuit avec l’enfant.
La mère et le fiston prennent le train et débarquent à Rimouski, en territoire inconnu. Seule sur le quai, Éveline est accueillie par le chef de gare, qui devine
à quel point la voyageuse est désemparée. M. Ouellet l’invite dans son hôtel face au fleuve.
Éveline et François sont accueillis à bras ouverts et traités comme les membres de
la famille Ouellet. Éveline ne tarde pas à découvrir que « Rimouski rime avec paradis ».
Or, des mensonges poussent la protagoniste à cacher sa réelle identité pour protéger son fils. Mais une ombre plane sur son bien-être, car Albert n’est pas le genre d’homme à se faire attaquer sans riposter.
Il cherche à obtenir justice. Il publie des annonces où transpire la vengeance. L’étau se resserre et la romancière ne ménage pas les rebondissements pour nous tenir en haleine.
Comme on peut s’y attendre, un des fils de M. Ouellet est séduit par Éveline. Il l’invite
à monter à bord de son canot, il lui fait visiter une île, il l’invite chez lui et raconte le naufrage du navire Empress of Ireland, survenu dans la nuit du 28 mai 1914, presque dix ans plutôt, à quelques kilomètres de Rimouski.
Mélanie Calvé s’est bien documentée pour nous faire revivre cette page d’histoire.
Elle campe bien ses personnages. Elle illustre avec brio comment « vous pouvez être à la fois triste et soulagé. Un n’enlève rien à l’autre. »
À la fin du roman, on trouve les données de SOS violence conjugale. Comme l’action du roman se déroule en 1923, c’est la famille Ouellet qui veille à ce qu’une femme comme Éveline puisse être à l’abri d’hommes comme Albert.
Le style de Calvé est juste et coloré, parfois poétique. J’ai remarqué que la première phrase ou le premier paragraphe de
la moitié des chapitres commence par
une allusion à la température, aux saisons,
à la marée.
Elle écrit, par exemple, que « l’été 1923 tirait à sa fin. Septembre attendait dans l’ombre que vienne son tour » ou que « les immenses arbres entourant l’hôtel
se métamorphosaient au rythme du vent d’automne ».
Le roman Éveline illustre comment il est important d’être entourés de bonnes personnes pour rebâtir sa vie, pour
« se reconstruire à l’abri de son passé ».
Passionnée par l’histoire du Québec et mère de quatre filles, Mélanie Calvé s’en inspire pour créer des univers où les femmes sont à l’honneur. Sa trilogie William et Eva ainsi que ses autres romans – Anaïs, Léonie et Victoria, Rosalie ainsi que Marguerite – se sont tous taillés une place importante dans le cœur de son vaste lectorat et se sont vendus à plusieurs milliers d’exemplaires.
14 janvier 2025

Ouvrages en français
avec titres en anglais
En 2024, j’ai recensé pour L’Express les romans Heartbeat, Bad Girl Reputation, Desire, Devil, Demon et Straight Park. Ils étaient tous publiés en français, mais portaient des titres en anglais. Une tendance assez courante en France.
À titre d’exemple, l’an passé les Éditions JC Lattès ont publié le polar Criss Cross de James Patterson. Le titre anglais se justifiait sans doute en raison du jeu de mot (l’inspecteur s’appelle Alex Cross). Récemment, Lattès offrait From Here to the Great Unknown, version française des mémoires de Lisa Marie Presley coécrits avec sa fille Riley Keough. Pourquoi ne pas avoir donné un titre dans la langue de Molière?
Les éditeurs français semblent se targuer de publier des ouvrages coiffés de titres en anglais. Parmi les titres les plus récents,
j’en note au moins trois parus aux Éditions Hugo Roman : Divine Darkness d’Anna Triss, The Holy Dates de Brittainy C. Cherry et More Than Words de Mia Sheridan.
Les Éditions Delcourt ont publié Fangirl, adaptation par Sam Maggs du roman à succès de Rainbow Rowell. Les Éditions Larousse ont publié When the King Falls
de Marie Niehoff. Aux Éditions Glénat, Stéphane Grodet et Theo Calmejane s’unissent pour créer l’homme de nos rêves, qu’ils appellent Pillow Man.
Les Éditions Hachette vont plus loin et donnent à une collection le titre Heroes, dont une nouveauté s’intitule Starling House d’Alix E. Harrow. Hachette est l’as
des titres en anglais. Neuf fois sur dix,
les titres de leur filiale HLAB (ou Hachette Lab) sont en anglais.
HLAB est une maison d’édition 100% numérique et dédiée aux nouveaux formats. Romance, fantastique, intrigues policières, romans historiques ou histoires « feel-good », il y en a pour tous
les goûts.
Le catalogue HLAB comprend plus de 150 ouvrages. Parmi les titres les plus populaires, on retrouve Lakestone, Heartless, Icebreaker, Flawless, Trouble Maker,
My Missing Piece, With You, Bad Me 1 et 2.
La Belgique n’échappe pas au phénomène des livres francophones coiffés de titres anglophones, mais à une moins grande échelle. Dans le cas des Éditions Alice,
un livre jeunesse d’Éléonore Desclée s’intitule Charlotte in love. Même s’il s’agit d’un clin d’œil à la célèbre romancière britannique Charlotte Brontë, un titre
en français aurait été de mise.
On peut parfaitement comprendre qu’un auteur d’expression française ressente parfois le besoin de donner un titre en langue étrangère à une œuvre. Gilles
Leroy a bien gagné le Goncourt en 2007 avec Alabama Song. À la rigueur,
on accepte de voir l’anglais utilisé en couverture d’un livre québécois quand
le texte le justifie, comme dans le cas du Volkswagen Blues de Jacques Poulin.
Si le but est de faire tendance, force est
de constater que le résultat va à l’encontre de l’objectif visé. En effet, les titres en anglais portent à confusion, et les éditeurs sont obligés d’ajouter bandeaux explicatifs ou sous-titres très longs pour indiquer
aux acheteurs que le contenu du livre est bien en français.
Ce fut le cas avec Hunter Killer, la guerre des drones par ceux qui la font, de Mark McCurley, et Winter is Coming, stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre, par Gary Kasparov.
3 janvier 2025

R. Lavallée, Le crime du garçon exquis, roman, Montréal, Éditions Fides, 2024,
310 pages, 29,95 $.
Roman policier universel
Un meurtre à la sortie d’un bordel.
La victime est française,
le meurtrier est canadien.
Un caporal est promu lieutenant provisoire pour mener rondement et rapidement l’enquête de circonstance. Voilà comment
R. Lavallée campe l’intrigue du roman Le crime du garçon exquis. Mais l’affaire est beaucoup plus nuancée qu’il n’y paraît d’abord.
Avec ce Crime du garçon exquis, Lavallée signe une nouvelle aventure de son personnage Matthew Callwood qu’on a pu voir dans Tous des loups (2022), ouvrage qui avait alors remporté le prix St-Pacôme du meilleur roman policier.
Callwood a fui les forêts sauvages du Nord canadien pour l’Europe en ruine durant
la Première Guerre mondiale. Alors qu’il pense avoir enfin largué sa vie de policier, une enquête troublante l’y replonge.
Bertie Quilliams, un jeune soldat, est accusé d’avoir tué son rival amoureux Vincent Jamenet à la sortie d’une maison close.
Si les généraux exigent des preuves qui mèneront le coupable tout désigné au peloton d’exécution, Callwood doute qu’il s’agisse d’une simple affaire de mœurs.
Mais par où commencer sa mission quand la scène de crime est un vaste champ de bataille? À qui faire confiance dans ce pays qui regorge d’espions? Et puis, que vaut
la justice des hommes lorsque tout
le monde est complice de la plus grande tuerie de tous les temps?
R. Lavallée est l’auteur franco-manitobain contemporain le plus connu et primé.
En présentant Le Crime du garçon exquis,
la Librairie Archambault indique qu’il s’agit d’un « roman policier québécois ». Quelle étroitesse d’esprit!
Les thèmes abordés sont la Première Guerre, l’espionnage, les mœurs, la xéno-phobie, l’homophobie et la trahison. Il s’agit d’un roman policier universel.
L’auteur a fait un an de recherche pour bien se documenter au niveau historique. En parlant des rapports entre Quilliams et Jamenet, ainsi que des visiteurs du bordel pour messieurs seulement, il écrit que
ce sont tous des « berdaches ». Il s’agit là d’une référence aux travestis sioux en Nouvelle-France.
Lavallée excelle dans l’art de ciseler
des dialogues où la réplique de Callwood est tour à tour inattendue, insolite, voire déconcertante. Lorsqu’on lui dit :
« Mon pauvre vieux, vous n’êtes pas sorti du bois »! il répond : « Je cherche encore
le bois. »
Quand un juriste à bout de patience lance : « Je ne vous comprends pas. », Callwood lui répond : « Nous sommes deux. » Difficile à trouver un personnage plus pince sans rire que ça.
Né à Saint-Boniface (Manitoba) en 1954, Ronald Lavallée a été le correspondant de Radio-Canada pour l’émission Le Point.
Il a reçu le Prix Champlain, le Prix Jules-Verne et le Prix Louis-Riel pour son premier roman intitulé Tchipayuk ou
le chemin du loup, publié en 1987 aux Éditions Albin Michel.
23 décembre 2024

David Vermette, Une race d’étrangers.
Le récit méconnu des Franco-Américains, essai traduit par Aimée LeBreton, Québec, Éditions du Septentrion, 2024, 474 pages, 49,95 $.
Page d’histoire du Québec en Nouvelle-Angleterre
Entre 1840 et 1930, près d’un million de Canadiens français traversent
la frontière pour s’installer aux États-Unis à la recherche de travail et d’un avenir meilleur. David Vermette raconte l’histoire méconnue de ces Franco-Américains dans un brillant essai intitulé Une race d’étrangers.
Au cours de cette période, ceux qu’on appelle Franco-Américains forment des quartiers dans les villes industrielles de
la Nouvelle-Angleterre, parfois appelés Petits Canadas, « où ils reproduisent
les institutions qu’ils connaissaient au Québec et dans l’Acadie de leurs ancêtres ».
David Vermette clame haut et fort que
la Nouvelle-Angleterre a été le moteur de l’industrialisation des États-Unis, que
les textiles de coton ont été le moteur
de l’industrialisation de la Nouvelle-Angleterre et, après 1865, que les Franco-Américains ont été le moteur de l’industrie du textile.
On estime qu’un Canadien français sur
trois vivait en Nouvelle-Angleterre au début du XXe siècle. Or, leur histoire demeure presque aussi inconnue au nord qu’au sud de la frontière. Vermette braque les projecteurs sur la période de 1865 à 1930.
Au milieu du XIXe siècle, la Nouvelle-Angleterre était la région du pays où l’acticité industrielle était la plus intense. Les produits du coton menaient la charge en capital investi, en nombre de travailleurs employés et en valeur nette.
Une seule entreprise textile employait souvent des générations d’une même famille. À titre d’exemple, quatre générations de la lignée de l’auteur David Vermette ont travaillé à l’usine Cabot de Brunswick (Maine).
« En 1880, les Franco-Américains de
la Nouvelle-Angleterre avaient fondé
pas moins de 63 paroisses et 73 sociétés nationales. Cette année-là il y avait 37 journaux de langue française en Nouvelle-Angleterre et 11 autres à New York. En 1891, les Franco-Américains avaient 53 écoles paroissiales fréquentées par plus de
26 000 élèves; en 1908, ce nombre était passé à 133 écoles avec près de 55 000 élèves, soit 41% des écoles catholiques de
la région. »
Le recensement fédéral américain montre qu’en 1900, la Nouvelle-Angleterre abritait 54% des ouvriers des usines de coton au États-Unis. Près d’un quart (24%) de tous les ouvriers des filatures de coton au pays étaient des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre.
Contrairement aux Petites Italies ou aux Petits Tokyos ailleurs aux États-Unis, les Petits Canadas formaient des communautés permanentes, des répliques du Québec, « où les Franco-Américains préservaient une culture distincte à l’intérieur des frontières des États-Unis. Les Petits Canadas servaient de centres de valorisation de
la survivance ».
Une partie de la presse américaine présente l’idée que la hiérarchie catholique romaine du Québec a conspiré en vue de conquérir la Nouvelle-Angleterre. Un journal de Boston affirme en 1889 que « ce projet visant à rendre la Nouvelle-Angleterre française et catholique a déjà pris des proportions susceptibles d’alarmer les plus optimistes ».
En 1892, le New York Times écrit que
le Québec se déplace physiquement à Manchester (N.H.), à Fall River (Mass.) et à Lowell (Mass.), que « le curé met tous
les obstacles possibles à l’assimilation de ces gens à notre vie et notre pensée américaines ».
Enfin, Vermette expose l’agitation anti-franco-américaine du clergé protestant, du Ku Klux Klan et du mouvement eugéniste face à cette « race d’étrangers ».
Il s’agit de l’ouvrage le plus fouillé sur l’histoire des Franco-Américains.
La bibliographie renferme plus de 212 livres de référence.
12 décembre 2024

Jean-Michel Fortier, Tout me revient maintenant, roman, Montréal, Éditions
La Mèche, 2024, 312 pages, 24,95 $.
Le goût de penser à toi,
à nous, pas à eux
Bienvenue dans le monde secret de Colin, un adolescent qui n’ose pas avouer qu’il écoute Céline Dion, encore moins qu’il aime les garçons. Il est le narrateur de Tout me revient maintenant, quatrième roman de Jean-Michel Fortier.
Colin, 16 ans, est le narrateur du roman dont l’action se déroule à Sainte-Foy-Québec en 2003. Il est avant tout un fan inconditionnel de Céline Dion. La voix de
la chanteuse perce ses armures et « atteint un endroit qui n’existe pas sans elle, un cœur qu’elle m’a inventé ». Mais est-ce qu’un garçon normal écoute Céline Dion…?
Il suffit à l’ado d’entendre la voix de
Céline pour sentir son existence validée.
La chanteuse-vedette constitue l’univers
de Colin. Sa musique couvre un territoire immense. « Avec Céline, il y a une chanson pour chaque humeur et chaque occasion. »
Eugénie est la meilleure amie de Colin.
Ils partagent tout, ils n’ont jamais entretenu de secrets. Mais voilà que Colin imagine « le dégoût anticipé de ma réalité »,
il s’enferme dans la panique et le silence.
Pas question, non plus, de mentionner son orientation homosexuelle à ses parents.
Le mensonge reste son rempart le plus sûr. Tous les jeunes mentent à leurs parents,
se dit-il. Colin porte encore au fond de lui « l’envie impossible d’être un garçon comme les autres ».
Lors de son anniversaire, le frère de Colin organise un party dans le sous-sol. C’est
là que Colin entrevoit Yann, 18 ans. C’est
le coup de foudre. Après trois minutes avec Yann, Colin l’aime plus que sa mère,
son père, son frère et son amie Eugénie.
En repensant à sa conversation avec Yann, ces trois minutes « sont déjà les plus
importantes de mon existence ».
L’idée même d’avouer qu’il aime un gars lui glace le sang. Il n’est pas prêt. Il ne souhaite pas qu’on le sache, ni qu’on le devine.
Or, mentir lui répugne; il évite donc le sujet.
Quant à Yann, il est un excellent nageur. Ses meilleurs amis font partie de son équipe de natation. Pas question de sortir du placard; il a trop peur de se faire écœurer avec ça. Avec Colin, voici comment il raisonne :
« C’est pas de notre faute s’il y a des affaires qui vont pas de soi; si nous deux, on va pas de soi. J’aimerais ça que tout
le monde soit déjà au courant. Un jour,
il va se passer de quoi, ils vont le savoir… Moi, j’ai juste le goût de penser à toi.
À nous. Pas à eux. »
C’est Yann qui prend l’initiative d’embrasser Colin en avouant que ça fait un mois qu’il rêve de faire ça. Le cœur de l’ado arrête
de battre; l’impensable est en train de lui arriver. Après de longues étreintes, Colin riposte : « Moi, ça fait deux mois. »
Pour une histoire au début des années 2000, je suis surpris de voir à quel point deux jeunes homosexuels craignent encore d’être jugés négativement.
Le titre du roman de Jean-Michel Fortier est tiré de la chanson It’s All Coming Back to Me Now, écrite originalement par Jim Steinman en 1989 pour le groupe Pandora’s Box. Céline Dion l’a popularisé en 1996.
7 octobre2025

Muriel Françoise, New York, petit atlas hédoniste, photographies de Sylvie Li, Éditions du Chêne, 2025, 256 pages, 62,95 $.
Le dépaysement
de La Grosse Pomme
Un séjour à New York permet de
se gorger d’une énergie nouvelle.
En signant New York, petit atlas hédoniste, Muriel Françoise et Sylvie Li illustrent comment la ville ne cesse de se réinventer avec audace.
Ce livre de voyage découpe la ville en huit quartiers : Lower Manhattan, New York Arty, Midtown, Brooklyn, Queens, Upper West Side, Upper East Side, Harlem & Bronx. On
y trouve des doubles-pages thématiques pour mieux comprendre La Grosse Pomme, des itinéraires de promenade pour flâner et découvrir chaque destination autrement, ainsi qu’un rappel des essentiels à visiter pour ne rater aucun incontournable.
Parmi les essentiels de Lower Manhattan, une photo pleine page montre One World Trade Center, cette tour qui se dresse à Ground Zero, le site des tours jumelles détruites lors des attentats du 11 septembre 2001. À 541 mètres, il s’agit du plus haut édifice de New York. L’atlas nous invite à visiter aussi Chinatown, Liberty Island, Battery Park, Wall Street et Ellis Island.
Dans le quartier New York Arty, la plus ancienne partie de Greenwich Village a été classée au patrimoine historique de la ville en 1969. Dernier rempart de coolitude, « l’hôtel Chelsea abrite encore quelques artistes qui résistent à la pression immobilière de Manhattan et qui résident
au milieu des touristes et des photographes en quête de symboles ».
Midtown offre une douzaine de lieux essentiels, dont le siège des Nations-Unies, le Rockefeller Center, Broadway, Times Square, la 5e Avenue et le MoMA (Museum of Modern Art). « Les immeubles embléma-tiques de l’Art déco – un style très en vogue en architecture et en design à New York de 1920 à 1940 – méritent une balade pour les observer sous toutes leurs facettes. Autant de chefs-d’œuvre à la mesure du gigantisme new-yorkais. »
Upper West Side est un haut lieu de culture. Le rectangle de verdure qui compose Central Park est aujourd’hui bordé de rues coloni-sées par l’élite intellectuelle et artistique new-yorkaise. Avec ses immeubles anciens, ses brownstones soigneusement entretenues et ses adresses confidentielles, l’endroit invite à une balade tranquille.
L’Upper East Side, lui, arbore ses boutiques de luxe et ses hôtels particuliers hérités
des grandes fortunes qui, au XIXe siècle,
ont contribué à l’essor de la ville. Certains d’entre eux ont été reconvertis en musées où le temps semble s’être figé : Smithsonian Design Museum, Guggenheim Museum et Neue Galerie.
« Séparés par la rivière Harlem,
les boroughs de Harlem et du Bronx se déploient aux confins de la ville. Berceau
de la culture afro-américaine, le premier concentre des lieux qui permettent d’aller à la rencontre d’une communauté artistique vibrante. Le second charme par ses quartiers rétro et ses espaces verts au bord de l’eau. De part et d’autre, l’authenticité est au rendez-vous. »
Ancien village néerlandais, Brooklyn est
le borough le plus peuplé de New York.
Il offre une multitude d’ambiances grâce à son tissu urbain qui mêle héritages industriel et résidentiel. C’est là que se posent de nombreuses familles et des artistes sensibles à son mode de vie plus doux.
Queens doit son nom à l’épouse du roi Charles II d’Angleterre, Catherine de Bragance. Il est le plus vaste borough de New York, et aussi celui où l’on rencontre
le plus de cultures étrangères grâce aux générations d’émigrés qui y ont pris racine depuis le début du XXe siècle. « Là comme ailleurs dans la ville-monde, le dépayse-ment fait partie du voyage. »
2 octobre2025

Gabriel Osson, Suzanne Louverture, d’esclave à Première dame, roman historique, Montréal, Éditions du Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, 2025, 354 pages, 30 $.
À la mémoire des femmes oubliées de l’histoire d’Haïti
Pour connaître la naissance d’Haïti, son véritable fondateur et l’épouse de ce dernier, il fait lire à tout prix Suzanne Louverture, d’esclave
à Première dame, roman historique de Gabriel Osson.
Précisions d’abord que Saint-Domingue est l’ancien nom d’Haïti. La cheville ouvrière de cette première république noire du monde est le général François Dominique Toussaint qui adopte « le nom Louverture à cause de sa facilité à créer des brèches dans les lignes ennemies », une fois que l’esclavage est aboli en 1793.
François Dominique Toussaint (1743-1803) épouse Suzanne Simone Baptiste (1752-1816) en secondes noces. Cette femme élève et éduque deux enfants, surveille un adolescent, dirige des domestiques, supervise les travaux dans les champs et tient les comptes. L’auteur écrit : « elle était véritablement au four et au moulin ».
Puisque Toussaint émerge comme
le premier gouverneur noir de Saint-Domingue, Suzanne assume son titre de première dame. Avec le temps, elle se résigne à son rôle d’oreille attentive et d’observatrice silencieuse. Elle devient
la voix de la conscience de son mari, dont « chaque nouvelle décision était un poids supplémentaire sur ses épaules ».
Toussaint rédige la première constitution
de Saint-Domingue en s’inspirant de celle adoptée en France (1789). Napoléon n’a nullement l’intention de la ratifier.
Au contraire, il veut « mettre au pas
ces nègres » et rétablir l’esclavage dans la colonie. « Que dirait le monde de la France, qui a conquis de puissants empires, si nous capitulons devant ces nègres ? »
Gabriel Osson précise que, à l’apogée de la production sucrière, caféière et cotonnière, plus du tiers des revenus de la France provenait du travail des personnes mises
en esclavage sur des plantations.
En décembre 1801, Napoléon envoie 63 navires et 30 000 soldats vers Saint-Domingue. Toussaint, son épouse, leurs trois enfants et quelques domestiques sont exilés en France, le père et son fils aîné dans
un endroit, les autres incarcérés dans une différente prison.
Suzanne se montre forte et en contrôle.
Elle a « l’habitude de porter le poids des événements sur ses épaules sans se laisser abattre ». Durant son exil à Bayonne, puis à Agen, la Première dame choisit toujours
la dignité.
Plusieurs années de recherche et de documentation permettent à l’auteur
de donner voix à une femme de courage et de résilience, dans un récit qui mêle histoire, mémoire et imaginaire. Tout en respectant les dates et les lieux par où Toussaint et Suzanne Louverture ont transité, Gabriel Osson a pris quelques libertés pour écrire cette fresque historique. « Il y a une volonté biographique de ma part, tout en restant dans un roman. »
Suzanne Louverture, d’esclave à Première dame est une œuvre magistrale qui contribue à la mémoire des femmes oubliées de l’histoire d’Haïti. On y découvre une personnalité stoïque qui ne montre jamais son désarroi.
26 septembre2025

Marc Ménard, À tout prix, roman, Montréal, Éditions Tête première, coll. Tête ailleurs, 2025, 202 pages, 27,95 $.
Roman axé sur le cours
des événements
Le communisme, le socialisme et
le fascisme n’épargnent pas
le Québec des années 1930. Marc Ménard le démontre dans son roman À tout prix où il est question de luttes ouvrières et de tumulte social.
L’action se déroule en 1937, principalement
à Montréal mais aussi à Paris. La métropole québécoise est décrite comme
« une catalogne cousue à la hâte, sans
souci d’harmonie ou de cohérence,
où s’entrecroisent, sans vraiment se mêler, toutes les classes de la société ».
Le personnage principal est Stanislas,
un jeune homme au caractère véhément, qui reprend les slogans des uns et répond aux appels des autres. Il a beau prévoir le pire, il est certain de manquer d’imagination.
La première partie du roman décrit la grève déclenchée par les ouvrières du vêtement. L’auteur souligne à quel point les patrons des manufactures ont l’appui du premier ministre Maurice Duplessis, de l’Église et de la police. Les syndicats sont perçus comme des bolchéviques qui cherchent à détruire la foi et la morale.
En se rangeant du côté des grévistes et
des gars de l’union, Stanislas est obligé de lutter contre « des crapules, de la racaille
et des bandits sans conscience ». Certains passages du roman illustrent comment un homme qui se trouve dans un dénouement total finit par n’avoir plus rien à perdre.
Fait intéressant, Marc Ménard inclut des références à la visite d’André Malraux à Montréal en 1937 et à des œuvres exposées par Alfred Pellan à Paris. Stanislas va justement rencontrer l’artiste québécois
dans la Ville Lumière.
Attaqué à quelques reprises par un fier
à bras dans les ruelles de Montréal et craignant pour sa vie, Stan est obligé de changer d’identité et de fuir à Paris sous
le nom d’Henri Chiasson. Il visite l’Expo-sition universelle et l’auteur décrit plusieurs pavillons où les arts et les techniques sont appliqués à la vie moderne.
La lutte contre le fascisme en France occupe quelques chapitres d’À tout prix. On peut y lire qu’il « faut barrer la route à l’extrême droite, l’empêcher de se répandre davantage. Mieux, l’éradiquer. » Il est temps que
les convictions se transforment en action significatives.
Le meilleur ami de Stan-Henri conduit
des volontaires pour combattre les fascistes en Espagne. Notre protagoniste décide de ne plus voguer à la dérive, de poser un geste mûrement réfléchi. En route pour l’Espagne… et fin du roman.
Au cours de notre lecture, on se rend compte que deux femmes ont une relation et que le meilleur ami de Stan préfère
les hommes. Années 1930 obligent, l’auteur passe vite sur cette réalité clandestine.
En dépit des tumultes sociaux, Marc Ménard adopte un style pondéré. Ses comparaisons n’ont rien de révolutionnaire. Il écrit,
par exemple, qu’un oncle a « un crâne lisse comme une boule de bowling », que
« des sourcils ressemblent à des nids de corneille » ou qu’une tache est aussi visible que « du ketchup sur une chemise blanche ».
Par-delà le communisme, le socialisme et
le fascisme, ce sont l’amitié et la solidarité qui ressortent dans ce roman sur la quête identitaire.
13 septembre2025

Samuel Larochelle, Les queers qui ont changé le monde, essai, Montréal, Éditions Québec Amérique, coll. Documentaire jeunesse, 248 pages, 26,95 $.
Faire briller
l’excellence queer
Trop peu de gens connaissent
des athlètes, artistes, entrepreneurs, politiciens ou scientifiques LGBTQ+ qui ont laissé leur marque dans l’histoire. Pour remédier à cette situation, l’écrivain-journaliste Samuel Larochelle publie un essai révélateur intitulé Les queers
qui ont changé le monde.
L’ouvrage présente une soixantaine de courts portraits (3 à 5 pages). Samuel Larochelle a choisi de mélanger les disciplines (arts, sciences, politique, sports, affaires) parce que cela lui semblait plus vivant, parce que « les personnes queers aiment faire éclater les petites boîtes dans lesquelles tant d’humains aiment s’enfermer ».
J’ai choisi de parler de ce livre le 11 octobre parce qu’il s’agit de la Journée internationale du coming-out (sortie du placard) qui souligne le mérite de s’afficher ouvertement comme personne 2ELGBTQ+ (voir note en bas de page).
La seule façon de présenter Les queers
qui ont changé le monde est de donner
un exemple pour chaque discipline,
y compris le militantisme. C’est aussi chercher à inclure divers pays (les États-Unis sont surreprésentés dans ce WHO’S WHO de l’excellence queer).
À tout seigneur, tout honneur. Je commence avec le patineur canadien Eric Radford,
né en 1985. Lors des Jeux olympiques en Corée du Sud en 2018, il devient le premier athlète à gagner une médaille d’or aux compétitions d’hiver en étant ouvertement gai. Il n’a pas attendu d’être à la retraite pour s’afficher publiquement. « C’est loin d’être anodin ! »
Sans le mathématicien anglais Alan Turing (1912-1954), la Seconde Guerre mondiale aurait pu être gagnée par les nazis. Membre des services secrets britanniques, il a décrypté les communications des troupes allemandes, a décodé l’ennemi, a permis
aux Alliés de prendre le dessus.
Quelques années après avoir sauvé
le monde, Turing a été arrêté et condamné pour « outrage aux mœurs » parce qu’il était homosexuel en 1952. Pour éviter
la prison, il a accepté de se faire castrer chimiquement.
La Banque d’Angleterre a émis des billets
de 50 livres à son effigie à partir de 2022, « ce qui a fait de lui la première personne LGBTQ+ à apparaître sur un billet d’argent. »
En 2024, la série documentaire Alexandre
le Grand – Au rang des dieux présente « l’intérêt du personnage historique pour les hommes ». Lui et son confident Héphaistion sont bien plus que des amis,
ils se caressent et s’embrassent. Héphaistion n’était pas seulement un mai très cher, « mais sans doute aussi son plus grand amour ».
Première sportive à faire son coming-out, militante pour l’égalité hommes-femmes et légende du tennis, l’Américaine Billie Jean King (1943-) gagne l’US Open en 1972 et reçoit 15 000 $ de moins que le champion masculin. Elle met au défi le tournoi de changer les règles, sinon elle le priverait
de sa participation l’année suivante. « L’équivalent d’un smash en pleine gueule ! » En 1973, l’US Open devient le premier tournoi majeur à offrir des prix égaux aux hommes et aux femmes.
Dans le monde de la mode, on songe à Christian Dior et Giorgio Armani. Je m’arrête à Yves Saint Laurent, un des plus grands créateurs du XXe siècle. « Il n’a pas seulement imposé de nouvelles façons de penser le vêtement, il a carrément repensé la façon de voir le monde de la mode. »
Sa relation avec l’homme d’affaires Pierre Bergé est bien connu. Saint Laurent est
le premier créateur de mode vivant à avoir été exposé au prestigieux Metropolitan Museum of Art de New York.
Avec un nom par pays (Canada, Angleterre, Grèce, États-Unis, France), j’ai dû passer
sous silence Michel Tremblay, Florence Nightingale, Harvey Milk et combien d’autres.
________________
Note sur la signification de l’acronyme 2ELGBTQ+ :
2E = deux esprits (personnes bispirituelles chez les Premières Nations),
L = personnes lesbiennes.
G = personnes gaies.
B = personnes bisexuelles.
T = personnes transgenres.
Q = personnes queers.
+ = personnes des communautés de
la diversité sexuelle et de genre qui utilisent une autre terminologie.
9 septembre2025

Guillaume Hennette, 50 États d’Amérique,
Un nouveau regard sur les États-Unis, album illustré par Playground Paris, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025,
240 pages, 29,95 $.
Road trip
chez nos voisins du Sud
Depuis le retour de Trump, il est question des États-Unis à presque chaque téléjournal. Si vous pensez tout connaître de ce vaste pays, Guillaume Hennette croit que
vous n’avez encore rien vu. Pour
le prouver, il publie 50 États d’Amérique, Un nouveau regard
sur les États-Unis.
Les 50 États sont classés en ordre alpha-bétique, avec priorité donné au vocable français s’il y a lieu (Californie, Louisiane, Pennsylvanie, Géorgie, Nouveau-Mexique, Virginie Occidentale, Hawaï, Caroline du Nord et du Sud, Dakota du Nord et du Sud).
Dans une présentation un peu criarde, l’ouvrage consacre trois pages à chaque État, le tout étant coiffé d’un titre accrocheur.
En voici quelques exemples : L’État le plus grand (Alaska), L’État qui a vu naître
les gratte-ciel (Illinois), L’État le plus français (Louisiane), L’État du blues (Mississippi), L’État de Tom Sawyer (Missouri).
On présente d’abord des renseignements de base : superficie, population, capitale, ville
la plus peuplée et drapeau. Sous la rubrique #1, on signale en quoi l’État se distingue des autres. On apprend, ainsi, que la ville la plus chaude est en Arizona; un jour sur deux,
il fait 37,7 degrés Celsius à Phoenix.
Le #1 du Michigan est fort étonnant;
on y compte plus de 11 000 lacs, les plus importants étant Michigan, Supérieur, Érié, Huron et Sainte-Claire. Quant au Kentucky, il est premier producteur de bourbon
des États-Unis. Le Vermont est premier producteur de sirop d’érable chez nos voisins du Sud.
Une autre rubrique intéressante est L’enfant du pays. Pour Hawaï, il s’agit bien entendu de Barak Obama. Le Tennessee, qui est sous-titré L’État d’Elvis, a comme enfant du pays Al Gore, sérieux rival de George W. Bush en 2000. Le Wisconsin se targue d’avoir Barbie, originaire de Willows, ville fictive de cet État.
Une demi-douzaine de capsules serve
à décrire une facette de chaque État.
On apprend, ainsi, que le New Hampshire
est l’État qui fabrique le plus d’armes à feu, secteur qui emploie 4 400 personnes et rapporte 1,3 milliard de dollars.
Une courte anecdote précise que le CIO a accordé les Jeux d’hiver de 1976 à Denver (Colorado), mais que la population a refusé à 60% de les accueillir lors d’un référen-dum. Ils ont finalement eu lieu à Innsbruck en Autriche.
Un tableau indique l’année où chacun
des 50 États a fait son entrée dans
la république fédérale. Onze États forment
le premier groupe en 1787. Alaska et Hawaï sont les derniers en 1959. Une page en appendice explique le deuxième amende-ment de la Constitution, qui autorise à posséder des armes à feu.
En terminant, Guillaume Hennette propose un quiz de 50 questions pour savoir si vous avez bien lu son livre. L’une d’elles est assez facile : la capitale de la Louisiane porte
un non français avec une couleur dedans; est-ce Baton Rouge, Bâton-Bleu, Bâton-Jaune ou Bâton-Orange? Réponse : la ville sans accent circonflexe et sans trait d’union.
Une question plus difficile : avec 580 000 habitants, quel État est le moins peuplé? Kansas, Nebraska, Dakota du Sud ou Wyoming. Réponse : le dernier dans liste alphabétique des 50 États.
L’auteur signe un road trip unique et haut en couleur à travers les 50 États américains. Il nous offre une exploration unique,
à la fois instructive et divertissante,
de l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui.
29 août2025

Benoit Jodoin, Archives de nos amitiés imparfaites, essai, Montréal, Éditions Triptyque, coll. Queer, 2025, 138 pages,
29,95 $.
Phraséologie de l’amitié masculine
En puisant dans sa correspondance et ses photos, Benoit Jodoin s’adresse à un ami d’adolescence pour réfléchir sur l’amitié entre hommes gais au prisme de la pensée queer. Son essai intitulé Archives de nos amitiés imparfaites est le résultat d’une démarche dans le doute
et la fragilité.
Jodoin a grandi au Québec dans les années 1990, lorsque le mot gai était bien campé et que le mot queer était encore à découvrir. Dès le premier chapitre, le trentenaire explique ce qu’il a appris de lui-même en affirmant : « Est queer ce qui autorise que les choses restent brouillées, incomprises, inachevées, confuses, complexes. »
La pensée queer invite à créer de nouvelles manières d’entrer en amitié, à célébrer l’amitié « dans ses échecs et ses imper-fections, dans ses itérations parfois inspirantes, parfois douloureuses,
à l’occasion passionnelles ou cruelles,
et souvent affaiblies par le temps ».
L’auteur s’inspire de biographies et de correspondances où sont relatés des récits d’amitiés masculines avant Stonewall (1969). Il est d’abord question de la relation entre
le Canadien Fred Vaughan et le célèbre poète américain Walt Whitman. Les deux hommes font l’amitié comme on faisait l’amour (to court) au 19e siècle, c’est-à-dire « se fréquenter, tenter de plaire à autrui pour s’y lier ».
Dans sa correspondance, Gandhi témoigne de ses sentiments pour son ami Kallenbach. Il serait facile d’interpréter cela dans le sens d’une passion amoureuse. Or, leur compa-gnonnage raconte autre chose, « soit l’élaboration d’une manière d’être ensemble pour deux hommes dans l’intimité ».
Jodoin fait brièvement allusion à l’histoire d’amitié tumultueuse entre Marcel Proust
(22 ans) et le comte Rober de Montesquiou (38 ans). Dans une lettre adressée au comte en 1910, Proust écrit : « je ne vous ai encore parlé que de moi, mais parce que c’était pour vous parler de nous ».
Les beaux mots que l’auteur d’À la recherche du temps perdu trouve pour parler d’amour, il les convertit pour décrire les relations hétérosexuelles de son œuvre. Pour écrire sur l’homosexualité, il ne lui reste que des mots de vulgarité, de solitude et d’exclusion.
Peu le savent, mais deux des plus grands génies espagnols du 20e siècle ont vécu ensemble « une histoire d’amitié passion-nelle, impétueuse, ambiguë », comme le sont d’ailleurs les personnages eux-mêmes,
le peintre surréaliste Salvador Dali et
le dramaturge et poète Federico Garcia Lorca. Le premier était hétéro, le second était homo.
Avec ces exemples à l’appui, Jodoin explique comment il peut régner une confusion ambiante entre deux registres affectifs : l’amour et l’amitié. Il arrive souvent que des sentiments soient « capitalisés pour combler un besoin d’attention ».
Puisant dans sa propre expérience, avec son ami d’adolescence, l’auteur voit en quelque sorte sa relation comme « une amitié-rempart, une amitié-refuge ». Je souligne que, sur les bancs d’école, les deux garçons étaient efféminés, maniérés, nuls en sport et passionnés de mode, donc cibles idéales de quolibets homophobes.
Les homos et les hétéros, écrit Jodoin, ont
un même problème : « la culture patriarcale marginalise les désirs de proximité avec
les hommes ». Il croit que les queers peuvent contribuer à créer une culture de la connexion, inventer un monde où deux hommes amis peuvent se dire « je t’aime ».
Une seule conclusion s’impose à l’essayiste : les amitiés masculines sont imparfaites, « non pas dans le sens de ce qui fait défaut, mais dans le sens de ce qui reste inachevé, incomplet, perfectible ».
15 août2025

Jules Faulkner Leroux, La rue dévore, novella, Ottawa, Éditions L’Interligne, 2025, 72 pages, 21,95 $.
Une novella sur
un concentré
de sujets sensibles
Dès la première page de La rue dévore, Jules Faulkner Leroux précise que des sujets sensibles seront abordés. Il sera question de dépendance, d’itinérance et
de santé mentale.
L’auteur indique qu’une liste de ressources figure à la fin de son livre. « N’hésite pas à y recourir si tu en ressens le besoin pendant et/ou après ta lecture. »
La rue dévore est une novella, c’est-à-dire une œuvre de fiction qui se situe entre
la nouvelle et le roman en termes de longueur et de complexité. Le mot novella vient de l’italien « novella », signifiant « nouvelle ou histoire courte ».
Le narrateur est un homme qui se laisse aspirer par la rue. On ne sait pas si c’est lui ou si c’est la société qui est malade. Il avoue avoir eu son lot de petites contrariétés, de choses banales comme le divorce de ses parents, les déménagements à répétition,
les changements d’écoles, l’alcoolisme de
son père et les copains de sa mère.
Puis il ajoute : « Rien, en soi, de bien différent de vous ni de la plupart des ados. » Cela m’a fait froncer les sourcils.
Je n’entre pas dans cette norme, je n’ai pas vécu ce genre d’adolescence.
Le protagoniste abandonne sa femme et
son travail dans un bureau d’avocats pour rejoindre les rangs des plus démunis.
Il souligne comment « la carrière est
une puissante échappatoire […], un outil
par excellence pour échapper à propre vie ».
En choisissant de vivre en marge, tout
en demeurant visible, il découvre à quel point une ville énorme comme Montréal avalent toutes les ressources, disséminent les relations interpersonnelles, nous dénature, nous déshumanise.
« Ne sachant que faire de ces individus
qui n’aspirent ni à acheter des choses pour se rendre heureux, ni à manger pour se rassasier, les gouvernements ont construit des cités dont les rues sont capables, ultimement, de les DÉVORER. »
L’utilisation de mots anglais est trop fréquente dans cette novella. En voici quelques exemples : mad vibes, crack house, passed out, turnée on, stiff, staff, shift. Cela m’a énervé au point de porter plus attention au contenant qu’au contenu.
On peut longuement épiloguer sur
la dépendance, l’itinérance et la santé mentale. En adoptant la novella, Jules Faulkner Leroux a choisi une approche concentrée. Cela donne plus de vigueur à
sa réflexion.
L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs joue un rôle discret dans cette courte histoire. Il figure en tête de liste des quelque vingt ressources proposées à la fin du livre. On fournit leur site Internet ou leur numéro de téléphone dans le cas de SOS Itinérance.
Jules Faulkner Leroux a étudié le droit et
le journalisme mais n’exerce ni un ni l’autre. Aujourd’hui, il est facteur et écrivain.
En 2024, il a fait paraître chez L’Interligne le recueil de nouvelles Qui suis-je où vais-je . La rue dévore est sa première novella.
9 août2025

Swann Périssé et Guillaume Meurice, Bouffons ! L’Humour est-il un sport de combat ? essai, Paris, Éditions du Faubourg, coll. Dialogue, 2025, 104 pages, 18,95 $.
Pas besoin de diplôme
pour faire rire
Quelle place l’humour occupe-t-il dans notre société aujourd’hui? Swann Périssé et Guillaume Meurice, de France, s’interrogent sur leur métier, sur ce qui fait rire ou pas, dans Bouffons ! L’Humour est-il
un sport de combat ?
L’ouvrage prend la forme d’un dialogue drôle mais sérieux entre ces deux humoristes. Guillaume Meurice précise,
au départ, que l’humour est une mise à distance du réel. « Rire du réel, c’est une façon de lui dire qu’on a pas peur de lui. »
Il ne cherche pas à être moralement correct. En tant qu’humoriste, il pense « qu’il faut accepter que ce qu’on écrit peut choquer ».
Quand on est drôle, souligne Swann Périssé, il est facile de manipuler les gens. « C’est pour ça qu’on a une énorme responsabilité, sur les sujets qu’on traite et sur comment on les traite. » Elle ajoute qu’une blague peut être à la fois méchante et hilarante.
L’humour était peut-être dévalorisé vingt, trente ou quarante ans passés. Mais aujourd’hui, pense Swann Périssé, « c’est devenu une arme massive ou un truc de séduction énorme ». Elle ajoute du même souffle qu’être drôle, c’est montrer son intelligence. « Au moins ses capacités à manier la langue, quelles que soient
tes convictions. »
L’humour au féminin occupe une place de choix dans ce dialogue. Un homme qui fait des trucs sur scène, y lit-on, « c’est edgy, c’est innovant ». Une femme qui fait les mêmes trucs, « c’est cringe, c’est gênant ».
Swann Périssé a appris à ne pas se poser plus de questions que ses collègues masculins, à laisser de côté les remarques « mais t’as pas honte de parler de ça ? », « et ta famille, et ton mec, ils vont penser quoi ? ».
Elle adore jouer avec l’imaginaire collectif. Une fois, elle a dû se moucher sur scène
et s’est cachée derrière une table. « Mais,
en me penchant, tout le monde a vu mon cul. Donc c’est drôle de faire semblant de se cacher, d’être pudique, en ayant le résultat inverse. »
Guillaume Meurice conclut ce dialogue en affirmant que ce qui compte, c’est d’avoir
un public et de faire rigoler, peu importe où, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux… « Pour être humoriste, il faut avoir envie de faire rire : pas besoin de diplôme pour ça. »
Quand j’ai choisi de m’intéresser à ce livre, je n’ai pas remarqué que les auteurs allaient parler de leur seule expérience française.
Il n’y pas de référence à des humoristes comme Sol ou Yvon Deschamps. Tous
les contextes culturels, sociaux et politiques concernent l’Hexagone.
Il est question d’artistes qui me sont complètement inconnus : Lou Trotignon, Zaïd Sahebdin, Nordine Ganso, Ali Wong, pour n’en nommer quelques-uns seulement. On mentionne Benjamin Tranié qui fait des sketches à la Pierre Palmade ou le numéro brillantissime de Florence Foresti sur la maternité.
Guillaume Meurice est humoriste et chroniqueur de radio. Il anime l’émission
La Dernière, sur Radio Nova, tous les dimanches. Il est également auteur de plusieurs romans, bandes dessinées et essais.
Swann Périssé est humoriste et productrice. Elle anime et produit le podcast Y’a plus d’saisons, un talk-show sur l’écologie.
Elle est également autrice de centaines de vidéos rigolotes sur les réseaux sociaux.
24 juillet2025

Claude Lavoie, Herbe à poux, 100 ans
de guerre contre le rhume des foins, essai, Éditions MultiMondes, 2025, 198 pages,
22,95 $.
Tout savoir sur une des pires mauvaises herbes
au monde
L’herbe à poux est la plante la plus nuisible au monde pour la santé humaine. À cause d’elle, plus de 120 millions de personnes sur la planète souffrent de rhinite allergique.
Le biologiste Claude Lavoie raconte l’histoire de cet incroyable envahisseur dans Herbe à poux,
100 ans de guerre contre le rhume des foins.
La fièvre des foins, appelée « rhume des foins » au Canada français à partir des années 1940, est principalement causée par la petite herbe à poux qui produit un pollen allergène. En 1936, le chercheur américain Oren Durham écrit que cette plante « ne produit rien d’utile, rien de beau, et ne mérite qu’un seul sort : l’extermination ».
Dans son livre Your hay fever, Oren attribue à la petite herbe à poux le titre d’ennemi numéro un de la santé publique à l’est des montagnes Rocheuses. « Cette maladie porte bien mal son nom : ce n’est pas un rhume, elle ne provoque pas de fièvre et n’est pas causée par le foin. »
Bien que l’herbe à poux soit considérée comme une des pires mauvaises herbes au monde, bien qu’elle infeste les cultures de maïs, de soya et de tournesol, bien qu’elle résiste aux herbicides les plus puissants,
elle rend ironiquement service à l’humanité.
L’herbe à poux est l’une des premières à s’installer sur les sols mis à nu après un labour ou sur les chantiers de construction. « Ses racines stabilisent la terre et la rendent moins vulnérable à l’érosion par
le vent et l’eau. Elles remontent aussi près de la surface des nutriments qui servent à nourrir d’autres espèces de plantes. »
La plante controversée migre du Midwest américain vers le Canada à la fin du XIXe siècle. On l’observe une première fois en 1845 en Nouvelle-Écosse, en 1914 à l’Île-du-Prince-Édouard, en 1927 à Terre-Neuve et en 1929 au Nouveau-Brunswick.
En ‘absence de médicaments efficaces à portée de la main, l’une des plus anciennes solutions aux gens affectés par le rhume
des foins est de se réfugier où la maladie est pratiquement inexistante. Plusieurs de ses endroits sont au Québec.
Des établissements illustres moussent leur réputation de sanctuaires. C’est le cas de Far Hills Inn (Val-Morin), du Manoir Richelieu (La Malbaie), du Mont-Tremblant Lodge et de Seaside House (Métis-sur-Mer).
Les médicaments, notamment les anti-histaminiques, sont un moyen moderne de lutter contre le rhume des foins. En 2021,
la moitié des Américains souffrant d’une allergie consomment des antihistaminiques par voie orale. En 2022, ces médicaments « rapportent aux entreprises pharma-ceutiques plus de 211 millions de dollars ». Cela pourrait atteindre 293 millions en 2028.
La rhinite allergique affecte une personne sur cinq aux Canada et aux États-Unis, c’est-à-dire 20 fois plus qu’au début XXe siècle. L’herbe à poux demeure encore et toujours la plante la plus problématique pour la santé publique. Or, les gouverne-ments ont d’autres chats à fouetter, d’autres priorités où attribuer leurs ressources.
Avec les opioïdes, l’itinérance, les maladies mentales, le SRAS et la Covid, on peut comprendre que le rhume des foins ne figure pas exactement au haut de la liste lorsqu’il s’agit d’améliorer la santé des citoyens. « Après tout, bien peu de gens meurent d’une rhinite. Pour se soulager,
on peut se procurer en vente libre des médicaments relativement bon marché. »
Claude Lavoie est biologiste et professeur titulaire à l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional de l’Université Laval. Expert des plantes exotiques envahissantes, il a publié en 2024 Pissenlit contre pelouse .
15 juillet2025
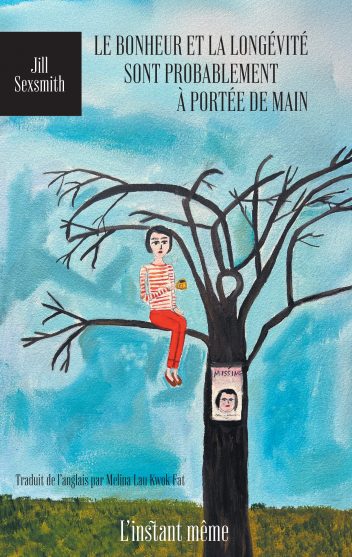
Jill Sexsmith, Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main, nouvelles traduites de l’anglais par Melina Lau Kwok Fat, Longueuil, Éditions L’instant même, 2025, 216 pages, 29,95 $.
Une dizaine de nouvelles sur la complexité humaine
Un premier livre explore souvent
la fragilité humaine. Jill Sexsmith y tire son épingle du jeu en mêlant humour absurde, mélancolie, ironie et tendresse dans une dizaine de nouvelles dont la première donne
le titre à son recueil : Le bonheur
et la longévité sont probablement
à portée de main.
C’est Melina Lau Kwok Fat qui a traduit l’ouvrage original intitulé Somewhere a Long and Happy Life Probably Awaits You. Elle a bien compris comment toutes les nouvelles sont liées par un fil rouge subtil, c’est-à-dire par une exploration de la fragilité humaine et des voies inattendues en vertu desquelles nous tentons de donner du sens à notre existence.
Qu’il s’agisse d’un combat désespéré pour sauver un orme malade, de la solitude du désert ou des illusions et désillusions de
la maternité, chaque histoire révèle une part de notre propre condition. Le recueil se construit ainsi comme un casse-tête émotionnel, une constellation d’instants décalés qui, mis bout à bout, esquissent un portrait saisissant de la complexité humaine.
Une femme enceinte affirme qu’elle veut être comme une patineuse artistique.
« Me lancer dans le vide sans filet de secours. » Un autre personnage est certain d’une seule chose : « quoi que je décide
de faire, il faut que ça m’aide à tourner
la page ».
Dans la nouvelle Les aléas font les bons voyages, Frank et Madison aiment passer
du temps ensemble, « mais seulement en petites doses – dès que leurs échanges dépassent une phrase, les choses risquent de dégénérer ».
Dans Vigueur hybride, le père du prota-goniste est partout et nulle part, « tout
le monde et personne ». Ailleurs, il y a vingt-sept os magiques dans chaque main de la pianiste Tulipe, de quoi les assurer pour « plus d’un demi-million de dollars s’il arrivait malheur ».
Les nouvelles de Jill Sexsmith explorent
les lieux particuliers où nous cherchons une validation, un but, une vie que nous pourrions reconnaître comme entièrement nôtre. Pendant que les protagonistes luttent contre le drame de leur vécu quotidien,
la nouvelliste s’attaque à des moments crus et intimes pour montrer à quel point
les gens peuvent être étrangement insensibles à leur situation désespérée.
Tantôt sage et sûre d’elle-même, tantôt drôle ou poignante, Jill Sexsmith s’aventure là où l’imagination n’ose pas toujours plonger.
On sent qu’elle s’élance résolument, le cœur battant.
Jill Sexsmith est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université de la Colombie-Britannique. Ses nouvelles ont été publiées dans des anthologies et des magazines tels que The Walrus et Fiddlehead. Le bonheur et la longévité sont probablement à portée de main a été finaliste pour le prix Margaret Laurence (fiction), le prix McNally Robinson du livre de l’année et le prix John Hirsch de l’auteure la plus prometteuse du Manitoba.
4 juillet2025

Scott Thornley, À feu nourri, roman traduit de l’anglais par Éric Fontaine, Montréal, Édition Boréal, coll. Noir, 2025, 510 pages, 32,95 $.
Polar campé dans
le Centre-sud ontarien
Nouvelle enquête pour l’inspecteur MacNeice à Hamilton, lieu qui prend le nom de Dundurn dans le roman
À feu nourri de Scott Thornley.
Un mort, un disparu, plusieurs victimes non confirmées, MacNeice voit peu à peu se confirmer ce
qu’il redoute : des tueurs à gages sont en ville et les contrats
ne manquent pas.
Pour les lecteurs et lectrices du Centre-sud ontarien, les lieux d’action sont familiers. D’un chapitre à l’autre, nous nous promenons de Grimsby à Burlington, nous prenons une sortie de l’autoroute 403, nous nous arrêtons sous les arbres de Niagara Parkway, nous croisons les rues Kenilworth et King (bien connues à Hamilton), nous composons l’indicatif régional 905.
Nous n’avons pas à nous aventurer bien
loin pour découvrir que la nature humaine semble suivre une drôle de règle :
si une personne fait une grosse connerie, elle a souvent tendance à en faire
une seconde pour essayer de réparer
la première.
L’inspecteur MacNeice fonctionne à l’adrénaline et à la caféine. Il sait bien que « le champ de bataille le plus effrayant est celui qui se trouve entre vos deux oreilles. » MacNeice est entouré de subalternes qui ont chacun des caractéristiques particulières.
Pour l’un, le diable est dans les détails. Pour l’autre, elle vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Sous oublier celui pour qui une enquête est comme un sac de pistache : « il y en a toujours une qui refuse de s’ouvrir ». Ou celui qui n’hésite pas à avouer : « J’ai pas peur de dire que j’ai eu peur en ostie. »
Dans cette enquête, un précieux témoin est Jack, un chien dont le témoignage ne serait pas accepté en cour, mais qui encourage MacNeice dans sa démarche. On apprend que, dans un stade plein à craquer, en dépit de l’odeur de chaque personne présente, certains chiens sont capables de détecter une odeur précise même si elle se trouve
à l’autre bout des tribunes.
Il y a un criminel qui aime utiliser un mot choc. Il dit « incroya-fucking-blement »
et explique que l’insertion d’un mot à l’intérieur d’un autre en créé un nouveau, « un néologisme en quelque sorte. Je ne suis pas certain que ça va passer à l’usage, mais ça force l’admiration. »
Quand MacNeice donne un ordre, il obtient presque toujours ce genre de réponses : « C’est comme si c’était fait, inspecteur…
Ce sera fait dans l’heure… Je suis déjà sur
le coup, inspecteur… C’est déjà fait, il ne devrait pas tarder à me répondre…
Le laboratoire médicolégal envoie
une équipe de geeks. »
Pour vous donner une idée des soubresauts de cette enquête, je mentionne tout simplement que pour avoir une bonne chance de survie, il aurait fallu qu’un protagoniste ne finisse pas dans… la chambre de combustion d’un crématorium.
Quand le patron de MacNeice le supplie
de lui dire qu’il reprend le contrôle de
la situation, l’inspecteur lui répond : « Nous sommes dans le feu de l’action, monsieur.
Il est difficile de parler de contrôle dans
de tels moments. »
Quand MacNeice laisse ses pensées dériver, l’une d’elles se refuse à bouger, « celle de prendre une retraite anticipée et de partir à la pêche, là où les poissons étaient gros et les conversations limitées ». Ce n’est pas pour demain car je soupçonne Scott Thornley d’être déjà en train de concocter une nouvelle enquête pour son inséparable inspecteur.
Originaire de Hamilton, Scott Thornley est membre de l’Académie royale des arts du Canada et de l’Ordre du Canada. Sa série de romans policiers consacrée à l’inspecteur MacNeice, qui compte maintenant cinq tomes, a remporté un franc succès au Canada et à l’étranger.
28 juin 2025

André Duchesne, Ça s’est passé ici :
25 petites histoires derrière l’Histoire, chroniques, Montréal, Éditions La Presse, 2025, 320 pages, 36,95 $.
Petites histoires derrière l’Histoire du Québec
Chaque grande ville possède et revendique des histoires hors du commun. Le Québec n’y échappe pas, comme en fait foi André Duchesne dans Ça s’est passé ici :
25 petites histoires derrière l’Histoire. Et ce n’est pas toujours une question de gros sous ou de retombées économiques.
De Benjamin Franklin à Greta Thunberg en passant par Harry Houdini, Charles Lindberg, Churchill et Roosevelt, John Lennon et Yoko Ono, Nadia Comaneci et The Backstreet Boys, pour n’en nommer que quelques-uns, des grands de ce monde ont foulé le sol québécois et choisi de faire une différence.
Journaliste à La Presse pendant plus de
24 ans, André Duchesne a récolté une imposante brochette de petites perles d’histoires méconnues. Il nous invite à redécouvrir le Québec à travers 25 récits
de figures emblématiques.
Dans la première chronique, on apprend
que Benjamin Franklin et Fleury Mesplet (fondateur du premier journal montréalais) se sont rencontré plusieurs fois. « À défaut de convaincre les Montréalais et les habitants de la province de Québec de joindre les colonies américaines, Benjamin Franklin a légué un héritage insoupçonné à la métropole québécoise : l’imprimerie ».
Au fil des décennies, plusieurs présidents américains ont séjourné au Québec avant, pendant ou après leur mandat. « Mais aucun n’est venu aussi souvent que William Howard Taft, dont le nom est désormais associé à une rue de La Malbaie. » Lui et les membres de sa famille y ont passé des dizaines d’étés en vacances.
La venue de Sarah Bernhardt à Montréal
en décembre 1880 demeure assez mouvementée. L’évêque Édouard-Charles Fabre voit d’un mauvais œil le passage de « la Divine » dans la ville aux cent clochers. Qu’à cela ne tienne, le poète Louis-Honoré Fréchette l’accueille en ces vers :
« Salut donc, ô Sarah! salut, ô dona Sol! / Lorsque ton pied mignon vient fouler notre sol, / Te montrer de l’indifférence serait à notre sang nous-mêmes faire affront, / Car l’étoile qui luit la plus belle à ton front, / C’est encore celle de la France! »
André Duchesne souligne que le cinéaste français Julien Duvivier a fait un tournage mémorable de Maria Chapdelaine, roman
de Louis Hémon, au Lac-Saint-Jean en
1934. La distribution incluait, entre autres, Madeleine Renaud (Maria), Jean Gabin (François Paradis) et Alex Rignault (Eutrope Gagnon).
Antoine de Saint-Exupéry a assurément puisé à plusieurs sources pour écrire
Le Petit Prince. L’une d’elle inclurait le philosophe Thomas De Koninck alors âgé de 8 ans. Son père Charles De Koninck reçoit l’auteur à la maison familiale du 25, rue Sainte-Geneviève à Québec en mai 1942. Thomas se souvent que Saint-Exupéry était très chaleureux, lui posait des questions et faisait des petits avions qu’il envoyait dans les airs.
Saviez-vous qu’Alfred Hitchcock a présenté son film I Confess (La loi du silence) en première mondiale à Québec le 12 février 1953? « Et pour cause! Toutes les scènes extérieures du film avaient été tournées à
la fin de l’été 1952 dans la Vieille Capitale. »
Moins de quatre mois après avoir renversé le dictateur Fulgencio Batista, Fidel Castro débarque à Montréal le 26 avril 1959. Cette visite éclair est très suivie par La Presse,
Le Devoir, Le Petit Journal et Radio-Canada. « Parmi la foule de journalistes, caméra-mans et photographes, on reconnaît René Lévesque qui tend son micro à Castro. »
Je termine avec la plus jeune mais non
la moindre vedette, Greta Thunberg, adolescente suédoise à l’origine de la grève scolaire pour le climat. Le 27 septembre 2019, les autorités prévoient un rassemble-ment de 300 000 personnes; elles sont quelque 500 000. « Ce jour-là, la métro-pole québécoise s’est trouvée au cœur des revendications citoyennes pour une planète plus verte. »
23 juin 2025

Jean-Louis Grosmaire, Mouvance
et espérance, roman, Ottawa, Presses
de l’Université d’Ottawa, 2025, 524 pages,
34,95 $.
Amour est plus fort qu’Armée
Peut-on changer la trajectoire du destin? Peut-on influer, ne serait-
ce que légèrement, sur l’avenir?
Un soldat français et une paysanne acadienne le croient et le démontrent dans Mouvance
et espérance, nouveau roman
de Jean-Louis Grosmaire.
L’action se déroule entre juin 1755 et septembre 1760, d’abord en Acadie puis au Québec. Passer d’un endroit à l’autre, c’est comme vivre dans deux pays différents.
Le roman met en scène le soldat Tonin Grandmont et la jeune Acadienne Delphine Brassaud qui veille à son chevet.
Une complicité immédiate les unit, mais
la guerre les emporte dans des directions opposées. Bien que constamment séparés,
ils attendent toujours de se retrouver. Ils ne savent ni où ni quand. Leur vie en est
une de mouvance et d’espérance.
Le romancier parle de « tempête sur
les eaux et sur les cœurs ». Il y a parfois
de belles éclaircies dans leur longue et tumultueuse mouvance. Mais plus souvent qu’autrement, ce sont les angoisses qui apportent une lourdeur sur l’amour du jeune couple.
Delphine est une enfant des marais, du vent, de la mer et des aboiteaux qui chantent en français. Le berceau de Tonin est la Comté (France), il ressemble plus à un troubadour qu’à un soldat. Il a quitté son village
comtois qu’il considère comme l’enfer
pour la forteresse de Louisbourg qui est l’antichambre de la mort.
La fougue de Tonin est bien plus qu’un désir physique. Delphine y voit « la soudure de deux personnes désireuses de bâtir
une vie d’amour, de tendresse, dont la seule extravagance serait la passion d’être ensemble ». Tonin n’est pas noble de rang mais de cœur.
Le 15 septembre 1755 à 15 heures, dans l’église Saint-Charles-des-Mines à Grand-Pré, on lit l’ordonnance de la Déportation des Acadiens. Le romancier y consacre à peine quelques lignes. Il s’attarde plutôt à
la peur et à la terreur qui harcèlent Tonin
et Delphine, à la maladie et à la mort qui ne cessent de les talonner.
Tonin tient un journal, une sorte de correspondance avec Delphine. On y lit : « La lumière de tes yeux, la force de notre amour sont mes raisons de vivre. L’amour sera plus fort que la guerre. Armée, Amour, deux mots si proches, si différents. »
Le romancier écrit qu’un personnage s’épanche tel un grand bavard. C’est parfois ce qu’il fait lui-même en multipliant
les embûches et obstacles qui parsèment
le parcours de Tonin et Delphine.
Dans ce roman, les soldats britanniques et français s’affrontent partout : de la forteresse Louisbourg aux Plaines d’Abraham en passant par l’anse au Foulon, la Pointe-Lévy et la rivière Saint-Charles. « Ça grêle de partout, ça tonne, ça pète, ça claque, ça casse, ça détruit, ça brûle, ça tue. »
Le style de Grosmaire nous réserve souvent de très belles tournures, parfois poétiques (« son mari pâlot et falot »). Parlant de
la maladie qui est sournoise, il écrit qu’elle « attend son heure pour notre malheur ». Ses comparaisons sont colorées (« discours aussi chaleureux que celui d’un bourreau sur l’échafaud »).
Quelques mots du parler comtois émaillent Mouvance et espérance. Feuille de Turquie remplace feuille de maïs; moutiatou désigne un petit enfant; gaichenots, de petits garçons.
Une recherche méticuleuse sous-tend
la rédaction de ce roman finement architecturé. La bibliographie comprend plus de 200 ouvrages consultés. Il n’est pas rare de lire des notes en bas de page. Certains chapitres en comptent 18, 28, 39, voire 59.
12 juin 2025

Annie Bacon, La Légende de Paul Thibault, album illustré par Sans Cravate, Montréal, Éditions Les 400 coups, 56 pages, 22,95 $.
L’art d’émerveiller
un jeune lectorat
Vrai comme vous êtes là, Annie Bacon nous présente « un héros qui vivait au nord de nos contrées. C’était à l’époque des grands coureurs des bois. » Il donne son nom à l’album intitulé La Légende de Paul Thibault et illustré par Éric Chouteau-Tissier, alias Sans Cravate.
L’écriture en vers et les illustrations en mouvement donnent un rythme endiablé à trois histoires : L’épinette de la colline, Pique-nique sur feuilles mortes et Sur la piste du siffleux. En compagnie de son ami Grugeux le castor, Paul Thibault y fait toujours preuve d’un courage légendaire.
Avec cet album destiné aux 6 ans et plus, l’auteure et l’illustrateur créent un univers décalé où vérités historiques, folklore et éléments fantastiques s’entremêlent pour nous offrir une œuvre unique en son genre.
Dès la première page, nous apprenons que Paul Thibault, « parti de son village pour trouver des fourrures, a pris goût à cette vie de folles aventures. De saison en saison,
le temps a passé, et le coureur des bois n’est plus jamais rentré. »
Coureur des bois à la barbe fournie et aux mains géantes, Thibault lutte tour à tour contre l’épinette à tentacules, le golem de feuilles ou le terrible siffleux. Il se nourrit
de trèfle, de fourmis et de tacos aux champignons, tout en menant une vie trépidante et remplie d’aventures.
L’écriture en vers ne se prête pas toujours à une richesse digne d’un Émile Nelligan où candide rime avec sordide et pervers avec hiver dans le poème « Mon âme ». Non, c’est plus léger, plus débonnaire, plus bon enfant, comme en témoigne cet extrait :
« Cet arbre maudit aux rameaux menaçants / terrorise les bêtes des grandes forêts d’antan. / Il attaque les loups, les renards,
les oiseaux. / Même les grands ours bruns n’y frottent pas leur dos. »
Dans la deuxième histoire, le coureur des bois fait la connaissance de Louisette,
« la meilleure bûcheronne de toute la forêt boréale », et de Sam, maître-draveur qui « a le rire polisson, le sourire franc, le regard fier ». Leur Pique-nique sur feuilles mortes est rempli d’allégresse, mais un terrible danger se cache sous leurs fesses…
Lorsque Paul Thibault est Sur la piste du siffleux, il s’engage dans une dure joute où gagner la paix d’esprit repose parfois sur « le noble art de négocier ». L’auteure et l’illustrateur ne négocient pas, eux, leur art d’émerveiller un jeune lectorat.
Les livres d’Annie Bacon ont déjà été sélectionnés pour les prix du Gouverneur général, des Libraires (deux fois), Tamarac (trois fois) et Hackmatack (trois fois). Éric Chouteau-Tissier a travaillé dans plusieurs studios en ville; par soif de liberté, il s’est installé en Estrie et a pris le pseudonyme Sans Cravate.
4 juin 2025

Agnès Ledig, Un abri de fortune, roman, Paris, Éditions Albin Michel, 2023, 380 pages, 32,95 $.
La force de
notre for intérieur
Au coeur de la forêt vosgienne,
un couple accueille dans son refuge des gens brisés par l’existence. Agnès Ledig raconte le parcours de trois
de ces êtres blessés dans Un abri
de fortune, roman axé sur la force du silence intérieur, le sens de
la solidarité et le bienfait du partage.
C’est grâce au club de lecture à Place Saint-Laurent, seule résidence pour aînés franco-phones à Toronto, que j’ai découvert Agnès Ledig, sage-femme de Strasbourg devenue romancière pour « prendre soin »
des autres, son verbe de vie.
Le roman met en scène Clémence (18 ans), Karine (45 ans) et Rémy (28 ans) qui débarquent chez Capucine et Adrien, pour panser leurs plaies. Le jeune couple accueillant a lui aussi vécu des moments douloureux. Il a décidé d’ouvrir un havre où s’offrir un nouveau destin.
Lentement mais sûrement, on voit les trois rescapés se dévoiler et s’apprivoiser, sous
le regard discret mais observateur d’un homme âgé, leur voisin. On est témoin
d’une bonne dose de douceur, de tendresse, d’entre aide, de soutien, de solidarité et de bienveillance.
Parallèlement, le roman aborde le thème
de l’écologie par le biais d’une petite communauté qui s’engage dans la perma-culture. L’intrigue finement tissée par
la romancière illustre comment se tourner vers les autres devient une façon de faire pousser en soi des racines plus profondes de joie et de confiance, sources de la plus heureuse des fortunes.
Agnès Ledig montre avec brio comment, grâce aux travaux de la ferme, à la luxuriance du jardin et au doux amour
des bêtes, on peut découvrir des ressources insoupçonnées en son for intérieur :
« A- t- on le droit de renaître à soi- même, de passer l’éponge et de jeter aux rapaces les miettes de son passé triste, de faire comme si on apparaissait au monde, vierge de tout, pour se laisser une deuxième chance ? » Oui, sans l’ombre d’un doute.
Clémence, Karine et Rémy ont chacun
un sombre secret lié à leur passé. Le roman prend dès lors l’allure d’une enquête qui va s’avérer longue tant les langues vont refuser de se délier. Et paradoxalement, ce qui va être découvert va permettre à tous de tracer une croix sur leur passé douloureux pour accepter, enfin, d’avancer serein.
Même si Un abri de fortune est basé sur
la notion de résilience, il y a suffisamment de suspens pour nous tenir en haleine jusqu’à la fin.
Agnès Ledig est née en 1972 à Strasbourg
de parents instituteurs. Un drame personnel qui est à l’origine de sa vocation d'auteure : la mort de son fils de 5 ans victime d’une leucémie. Cette expérience douloureuse lui a inspiré son premier succès en 2013, Juste avant le bonheur. Elle a maintenant à son actif douze romans et trois livres-jeunesse.
22 mai 2025

Pierre-Luc Bélanger, Le dilemme de Zoé, suite de Prise Deux, roman, Ottawa, Éditions David, coll. 14/18, 2025, 254 pages, 18,95 $.
Une intrigue au pas,
au trot, au galop
Le cheval Canadien est de retour. Les tiraillements entre cœur et raison sont également au rendez-vous dans Le dilemme de Zoé, suite de Prise Deux du romancier
Pierre-Luc Bélanger.
On renoue avec les aventures de Zoé et
de Darius, chacun aux prises avec leurs défis personnels. Zoé poursuit son travail avec les chevaux de l’écurie Prise Deux
et entretient maintenant une relation amoureuse avec Luc, son voisin fermier.
Darius, l’ex de Zoé, est un circassien dont
le spectacle à Vegas a dû être interrompu
en raison de la COVID-19. Il s’exerce maintenant à des prouesses de cirque équestre et fréquente assidument le ranch Prise Deux.
L’action se déroule principalement à Renfrew (Est ontarien) en 2020, durant
la pandémie de la COVID-19. Cette attaque virale donne lieu à des scènes de confinement et de distanciation, voire de quarantaine. C’est « la vie et l’amour qui vaincront l’ennemi viral ».
Zoé apprécie la compagnie de Darius, mais
a tourné la page pour écrire un nouveau chapitre avec Luc. Darius, pour sa part, affirme que « même ramasser du crottin de cheval est plaisant » quand il est avec Zoé. Cette dernière clame d’un ton ferme que Darius n’est qu’un bon ami, mais cette affirmation manque de conviction.
L’auteur nous fait monter à cheval, avec
tout l’attirait nécessaire : tapis, selle, garrot, pommeau, sangle, boucles, étriers, licou, bride et mors. Si les chevaux ne ressentent pas de confort, les cavaliers et cavalières auront des remords. Ces bêtes se nomment Zara, Dante, Freddie, Wanda, Ursule, Karl
et Kimmy.
Pierre Luc Bélanger excelle dans l’art de décrire le déchirement amoureux. Il illustre bien comment Zoé a la nette impression que son cœur est un élastique tendu, ou que l’on joue au souque à la corde avec son cœur.
La jeune femme en vient à se demander
si la compagnie des animaux n’est pas la meilleure. « Eux, au moins, ne lui brisent pas le cœur. »
Comme ce fut le cas dans Prise Deux,
le romancier développe son intrigue avec minutie, d’abord au pas, puis au trot et
enfin au galop. Résultat? On a droit à une montagne russe d’émotions. Et Bélanger ne semble pas avoir dit son dernier mot,
une suite se pointant déjà à l’horizon.
Je m’inspire de la citation de Françoise Boudreault sur le cheval, en exergue du roman, pour conclure que Pierre Luc Bélanger a guidé son lectorat tout autant qu’il s’est fait mener par lui. Osmose indispensable pour séduire le jeune public de la collection 14/18 des Éditions David.
Né à Ottawa, Pierre-Luc Bélanger a fait
ses études à l’Université d’Ottawa où il a terminé un baccalauréat en lettres françaises et en histoire, avant de compléter une maîtrise en leadership en éducation. Depuis, il est enseignant de français au secondaire et conseiller pédagogique en littératie. Le dilemme de Zoé est son septième roman pour ados.
3 mai 2025

Julie Rivard, L’Affaire Chanelle Fitch, roman, Paris, Éditions Hugo, 2025, 348 pages, 27,95 $.
Revers et revirements
d’une enquête policière
Ce que tout sergent-détective redoute comme la peste noire,
c’est un cold case, une affaire non résolue et reléguée aux oubliettes. Julie Rivard lève le voile sur un tel cas dans L’Affaire Chanelle Fitch.
Je vous dis tout de go que ce roman mêle allègrement angoisse, espoirs déçus, frustration, revers et revirements spectaculaires. L’intrigue met en scène
le policier Henrik Hansen, de la Division
des crimes contre la personne. L’action se déroule dans les Cantons de l’Est (Québec) en 2025.
L’affaire non résolue concerne une femme
et son enfant disparus seize ans plus tôt, dans des circonstances obscures. Et voilà qu’un étrange villageois déclare être la clé du mystère! Le sergent-détective Hansen plonge dès lors dans un environnement teinté par la légende d’une sorcière…
Le suspect prend certaines libertés avec
la réalité. Il s’adonne à quelques légères distorsions. Ses remarques font sacrer Hansen, mais la romancière n’écrit pas tabarnak ou câlice; elle dit que le sergent-détective pousse « quelques mots d’église exprimés avec verve ».
En reprenant cette enquête vieille d’une quinzaine d’années, le sergent-détective
voit son quotidien revêtir « des airs
d’une sinueuse descente dans les rapides ».
Un interrogatoire l’entraîne sur
« un chemin de Compostelle morbide
et interminable ».
Dans ses remerciements, la romancière souligne l’apport d’une neuropsychologue d’expérience qui lui a fourni des expli-cations fort éclairantes sur le cerveau et
ses diverses fonctions. Cela a permis à Rivard d’inclure quelques pages sur le taux de sérotonine, cette molécule qui joue
un rôle majeur dans la transmission de messages entre les neurones et les cellules nerveuses.
Parallèlement à l’enquête policière, l’auteure braque les projecteurs sur la relation entre Henrik et sa conjointe Léane. Cette dernière annonce qu’elle est enceinte, ce qui ne figure pas dans les plans du paternel âgé
de 42 ans.
On a droit à un très beau passage sur comment les enfants peuvent être à la fois « les plus importantes sources de stress et les plus grands bonheurs, […] sans doute l’un des fascinants paradoxes de l’existence ».
Quand Henrik est loin de Léane en raison de son travail, il rêve d’explorer « les monts et vallées » du corps de sa douce. À son retour, les ébats amoureux se matérialisent dans « une douce literie et un oreiller moelleux ».
Le sergent-détective entraîne un jeune policier. Il lui montre comment il ne faut jamais prendre des raccourcis simplistes
qui pourraient altérer le jugement final.
Ce dernier se doit d’être éclairé et rendu en toute connaissance de cause.
Auteure québécoise, Julie Rivard a publié près d’une trentaine d’ouvrages, notamment des polars (https://l-express.ca/nouvbelle-orleans-louisiane-bayou-affaire-lily-julie-rivard/), des romans d’époque et des livres jeunesse.
21 avril 2025
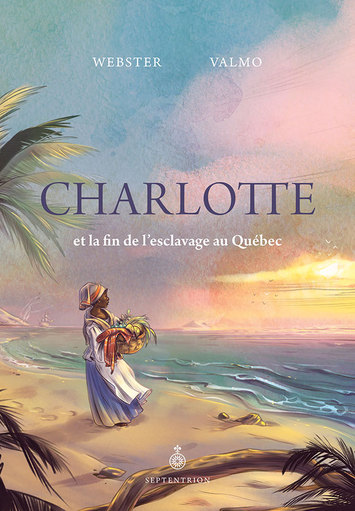
Webster, Charlotte et la fin de l’esclavage
au Québec, album illustré par ValMo, Québec, Éditions du Septentrion, 2025,
96 pages, 19,95 $.
Pour replacer Montréal et le Bas-Canada dans le cadre du système international de la traite transatlantique des Africains et Africaines, Aly Ndiaye, alias Webster, publie Charlotte et la fin de l’esclavage au Québec. L’album
est basé sur un fait vécu.
« À la fin du 18e siècle, l’esclavage n’était pas légal au Bas-Canada (Québec), c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de loi qui encadrait cette pratique. Il n’était donc pas illégal non plus, les gens pratiquaient l’esclavage par habitude. »
La Charlotte de cet album serait née en Afrique de l’Ouest vers 1762. Elle fut enlevée dès son enfance, déportée vers les Antilles anglaises, puis vers le Canada. Webster s’est inspiré de cette histoire peu connue pour concocter un récit résonnant de courage
et de résilience.
Le texte prend la forme d’un long poème dont voici un court extrait :
« Nous avons marché.
Marché sous le soleil
et marché sous la lune,
traversé le Sahel
parmi l’acacia et les dunes. »
L’acacia est un arbre très répandu dans le Sahel, région africaine qui fait la transition entre le désert du Sahara au nord et la savane au sud. Acacia et Sahel sont inclus dans un glossaire d’une soixantaine de mots tantôt moins connus d’un jeune public, tantôt carrément étrangers.
On y trouve, par exemples, cauris (coquillage servant de monnaie d’échange en Afrique de l’Ouest du 16e au 19e siècle), signares (femmes du Sénégal mariées avec des Européens) ou astaghfiroullah (formule musulmane signifiant Que Dieu me pardonne, en arabe).
L’album magnifiquement illustré par ValMo permet de mieux comprendre la manière dont le Québec s’est inséré dans le réseau de la traite esclavagiste transatlantique
au 18e siècle et, surtout, comment
les personnes asservies y ont résisté. L’ombre d’un personnage révèle souvent une ambiance, une atmosphère.
L’auteur clôt son récit par un court essai
sur l’esclavage au Québec. On y apprend que, selon l’historien Marcel Trudel,
il y aurait eu environ 4 185 personnes en esclavage au Québec entre 1629 et le début des années 1800. De ce nombre, les deux tiers étaient autochtones et le tiers était africain ou afrodescendant. L’historien
Brett Rushforth relate que plus de 10 000 esclaves vécurent au Canada durant
le 18e siècle.
Webster est le pseudonyme d’Aly Ndiaye,
un vétéran de la scène hip-hop québécoise. Il s’intéresse à la présence afrodescendante au Québec et au Canada depuis l’époque de la Nouvelle-France. L’illustratrice ValMo est native de Québec et vit à Montréal. Elle a œuvré dans le domaine du jeu vidéo où elle a développé son coup de crayon pendant quatorze ans, pour ensuite créer un univers bien à elle.
15 avril 2025

Rick Mofina, Disparue, roman traduit de l’anglais par Pascal Raud, Lévis, Éditions Alire, 2025, 420 pages, 29,95 $.
Nouveau page turner
de Rick Mofina
Une fille de 12 ans disparaît
au milieu de la nuit. A-t-elle simplement fugué, a-t-elle été attirée à l’extérieur de sa chambre par un amant secret, a-t-elle été enlevée par un pédophile… ? L’écrivain ontarien Rick Mofina n’écarte aucune piste, aucune
théorie, aucun suspect dans
le thriller Disparue.
L’adolescente s’appelle Maddison Lane
et l’action se déroule principalement à Syracuse, dans l’État de New York.
Sa disparition devient vite l’Affaire Maddie Lane. Elle mobilise les forces de l’ordre à tous les niveaux : Syracuse Police Department, la police du comté d’Onondaga, celle de l’État de New York et le FBI, auxquels s’ajoutent une entreprise de sécurité privée dirigée par l’oncle de Maddie et des associations de quartier.
Ancien journaliste spécialisé dans les affaires criminelles. Rick Mofina dispose de toutes les connaissances de base en ce qui a trait aux enquêtes policières. La structure de son roman en 93 courts chapitres y confère un aspect cinématographique indéniable et excitant.
Mofina campe les inspecteurs Stan Zubik
et Fran Asher. Ils cherchent « la proverbiale aiguille dans la botte de foin ». Ils inter-rogent des dizaines de personnes – parents, amis, collègues, voisins, gardienne, livreur
de pizza – mais tous ont des alibis vérifiés.
Parmi les pistes explorées, il y a la maison de transition d’ex-détenus récemment ouverte dans le quartier. On a ainsi droit à une virée vers les sites les mieux gardés
du dark web, ceux des pédophiles.
Le père, la mère et le frère de Maddie sont soumis au test du polygraphe, expérience décrite comme « une autopsie émotionnelle ». Le fils dit la vérité,
les réponses de ses parents sont non concluantes.
Vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous dans un tribunal. Vous avez
le droit à un avocat…
Mofina est un maître du suspense.
L’intrigue se développe en dents de scie,
au gré de rebondissements spectaculaires. Les personnages nous plongent dans
des montagnes russes émotionnelles.
La classique réponse des inspecteurs Zubik et Asher – « ne peut ni confirmer ni infirmer » – retentit comme un écho pendant quatre ans. Des rapports sans fondement mènent toujours nulle part.
Ce n’est qu’à la page 345 qu’une véritable bombe éclate, que l’Affaire Maddie Lane explose de tous les côtés.
« On pense qu’on connaît les gens. Ce n’est pas le cas. One ne connaît jamais ce qu’ils ont dans leur cœur. Ce qu’ils cachent,
ce dont ils sont capables quand ils sont piégés et qu’ils ne voient pas d’issue. Leur premier instinct est de mentir et la plupart d’entre eux le font. »
Dans ce nouveau roman, Mofina ose s’attaquer à un sujet délicat, la sexualité précoce des jeunes d’aujourd’hui, facilitée par les réseaux sociaux. Une autre particularité de l’auteur réside dans
son talent pour la nuance. Les méchants
ne le sont jamais gratuitement ; quant aux bons, il existe aussi souvent chez eux
une part d’ombre.
Né à Belleville, Mofina a commencé à écrire des histoires dès l’école primaire et a vendu sa première nouvelle à un magazine du New Jersey à l’âge de quinze ans. Il a étudié le journalisme et la littérature anglaise à l’Université Carleton. Ses romans ont été traduits dans plus d’une vingtaine de langues.
5 avril 2025

Alain Bernard Marchand, Les visages de Rembrandt, poésie, Montréal, les éditions du passage, coll. Poésie, 2025, 112 pages, 21,95 $.
Quarante autoportraits
de Rembrandt
Dans Les visages de Rembrandt,
le poète-nouvelliste-romancier-essayiste Alain Bernard Marchand parcourt quarante autoportraits du maître flamand, une matière que
ses mots explorent comme autant
de coups de pinceau ou de burin pour interroger ce que ces visages lui donnent à voir.
Le vers et la prose, l’écriture de soi et l’histoire de l’art se côtoient dans ce recueil tour à tour contemplatif et philosophique.
Il n’y a pas de reproductions des quarante autoportraits (1625 à 1669), mais j’en ai consulté quelques-uns pour mieux comprendre le regard du poète.
Il faut, en effet, voir Rembrandt aux yeux hagards (eau forte et burin, 1630) pour comprendre pourquoi Alain Bernard Marchand écrit : « Entre les lèvres, un oiseau noir. » Et pour apprécier son regard traduit en ces mots : « Ce que tu vois et que je ne vois pas est une énigme que seule l’imagination peut résoudre. »
Rembrandt a à peine vingt ans lorsqu’il peint La lapidation de saint Étienne (huile sur panneau, 1625). Il y apparaît pour la première fois, juste au-dessus de la tête
du saint. Cela peut être considéré comme l
e témoignage de son engagement spirituel. Ce qui fait dire à Marchand : « Je fais mon visage à mon image comme Dieu m’a fait à son image. En imaginant la ressemblance. »
Dès le début des années 1600, on conseille aux artistes de se regarder dans le miroir et de s’entraîner à rendre leurs états d’esprit. C’est ce que fait souvent Rembrandt, tour à tour en colère, horrifié ou souriant. Chacune de ces émotions reviendra plus tard dans son œuvre.
Pour montrer à quel point Rembrandt
revêt des déguisements ramenés d’ailleurs, le poète commente Portrait de l’artiste en costume oriental avec caniche (huile sur bois de chêne, vers 1631-1633). Dans le cas d’Autoportrait avec un bonnet à plumes blanches (huile sur bois de hêtre, 1635), « Rembrandt se déguise pour trafiquer
le reflet des miroirs ».
Alain Bernard Marchand a fait une recherche méticuleuse des œuvres du peintre flamand pour dénicher une quarantaine d’autoportraits. Il présente Rembrandt aussi bien dans la vingtaine
qu’à 34, 51 ou 63 ans. Il nous le montre souvent accoutré d’un béret ou d’un chapeau à large bord, d’un collier d’or
ou d’un hausse-col.
Voici ce que le poète écrit en conclusion : « Voir n’est jamais qu’une histoire. Que j’invente pendant que les siècles sont l’instant et l’éternité. Depuis les ateliers où tu inscris ton visage dans le temps jusqu’aux murs où tu me parles tout bas.
Tu me dis que ta main a suivi ton œil, et
ton œil, l’âge des miroirs. Car les portraits sont plus durables que nous. Et font de
nos os ressurgir la chair.
Né à Trois-Rivières mais établi à Ottawa depuis des décennies, Alain Bernard Marchand a fait de sa langue maternelle
une terre d’élection qu’il parcourt à grands pas depuis sa venue à l’écriture. Les visages de Rembrandt est son quinzième ouvrage, les précédents ayant tous été publiés aux Herbes Rouges.
2 avril 2025

François Charbonneau, L’Affaire Cannon. Enquête sur le combat d’un médecin afro-américain contre la discrimination raciale au Château Frontenac, essai. Montréal, Éditions du Boréal, 2025, 328 pages, 32,95 $.
Deux Noirs vs Château Frontenac en 1945
Le Dr George Dows Cannon et son épouse Lillian Moseley se voient interdire l’accès à la salle à manger du Château Frontenac (Québec) en 1945 parce qu’ils sont Noirs. Quatre-vingts ans plus tard, dans un essai intitulé L’Affaire Cannon, François Charbonneau révèle les tenants et aboutissants du combat de ce médecin afro-américain contre
la discrimination raciale
en terre québécoise.
Je vous préviens que l’ouvrage a les allures d’une thèse de doctorat. On y trouve 576 notes en bas de pages. La bibliographie comprend 219 articles de journaux ou de revues, 94 rapports, livres, thèses et parties d’ouvrages, 18 écrits de George D. Cannon,
16 fonds d’archives, 12 entretiens et courriels avec l’auteur, ainsi que 11 sites Internet.
Ce n’est qu’à la page 189 que nous apprenons l’infortune du couple Cannon-Moseley au Château Frontenac. Nous avons d’abord droit à une description fouillée du tumultueux parcours universitaire et professionnel de ce médecin afro-américain, auquel s’ajoute son militantisme acharné en faveur des droits de la minorité noire aux États-Unis.
Le 29 juillet 1945, le couple se voit assigner la chambre 4119 au Château Frontenac, « l’hôtel canadien le plus célèbre au monde ». Les 30 et 31, il soupe au son de
la musique classique dans la salle à manger. Mets excellents et serveurs prévenants. « I was drinking deep from
the cup of enjoyable life. Du moins, jusqu’au soir du mercredi 1er août. »
Le maître d’hôtel explique à George qu’il
ne peut pas les servir, selon un ordre catégorique du directeur de l’hôtel. L’adjoint de ce dernier explique qu’ils ont reçus des plaintes de clients américains indignés de
la présence du couple noir les derniers soirs. Résultat : interdire à George et Lillian l’accès non seulement à la salle à manger, mais à l’ensemble des espaces publics du Château.
Cannon entend porter plainte. Son avocat new-yorkais le dirige vers le Barreau du Québec et c’est Me Édouard Laliberté qui obtient du juge Oscar Boulanger une injonction interlocutoire ordonnant au Château Frontenac de cesser de bafouer
les droits du couple Cannon-Moseley.
Elle s’accompagne d’une assignation à comparaître pour une poursuite en justice en vue d’une indemnité de 900 dollars.
À partir du samedi 4 août, le médecin et son épouse retrouvent – par ordre de
la Cour supérieure – le droit dont ils avaient été privés de se rendre à la salle à manger. Il faudra attendre plus d’un an (4 octobre 1946) pour parvenir à un règlement à l’amiable déposé à la Cour supérieure du Québec : 1 091,81 dollars canadiens (capital, intérêts et dépens ou frais d’avocats).
En plus de payer cette indemnité, le Château Frontenac demande que le règlement ne puisse être interprété comme une recon-naissance de culpabilité. Il s’engage à ne jamais discriminer quiconque sur la base
de la couleur de sa peau, mais refuse de reconnaître avoir exclu le Dr Cannon et
son épouse « par préjugé de race ».
François Charbonneau s’intéresse à la réaction du public de la Vieille Capitale et
à la couverture médiatique de ce qu’il est convenu d’appeler l’Affaire Cannon.
Le docteur et son épouse reçoivent de nombreux encouragements des résidents
de Québec qui expriment leur indignation. Constat : le Château Frontenac (anglais) a discriminé, mais la ville de Québec (française) n’est pas raciste.
Et dans la presse canadienne-française
et dans les journaux canadiens-anglais,
les mots Nègre ou Negro se retrouvent parfois dans les titres d’articles décrivant
ce qui s’est passé au Château. L’auteur note que cela, « à l’époque, n’a strictement aucune connotation péjorative ».
Chose curieuse, Charbonneau a fouillé les journaux québécois et canadiens d’octobre 1946 à octobre 1947 et a « trouvé exactement… zéro article parlant de l’entente ». Son livre est le premier à en traiter, avec une méticulosité exemplaire, dois-je préciser.
26 mars 2025
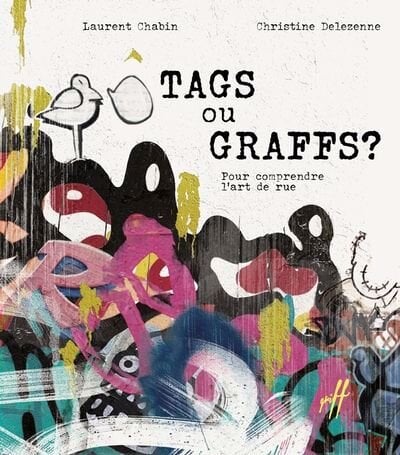
Laurent Chabin, Tags ou graffs? Pour comprendre l’art de rue, album illustré par Christine Delezenne, Montréal, Éditons de l’Isatis, coll Griff, 2025, 48 pages, 29 $.
Faussaire et assassin, tel est le tagueur
Qu’il dérange ou embellisse, l’art
de rue spontané peut être illicite. Laurent Chabin nous aide à nous
y retrouver dans cette jungle urbaine en signant un album intitulé Tags ou graffs?
Édifice public ou privé, abri de bus, wagon de métro, silo ou structure industrielle, bloc de béton, tunnel, mur, autant de surfaces où le tagueur choisit d’apposer sa signature, souvent pour détruire celle d’un autre.
Dès la première page, Laurent Chabin souligne la différence entre le graff qui est une œuvre d’art et le tag qui s’apparente plutôt au vandalisme. Le terme graffiti désigne toute œuvre réalisée sur une surface publique sans avoir été autorisée.
L’auteur élimine d’emblée les murales qui ressortent de l’art urbain de commande, « certifié, pratiqué sous surveillance et qui fait l’objet de contrats entre l’artiste, d’une part, et l’administration ou l’autorité qui est commanditaire de l’œuvre, d’autre part ».
Vouloir laisser sa marque, une trace de
son passage, une commémoration, remonte
à aussi loin que l’Antiquité. On apprend,
en effet, que des graffitis ont été retrouvés sur les murs de la ville ensevelie de Pompéi.
Le street art, qui est plus chic semble-t-il que « art de rue », fait appel à diverses techniques : charbon, craie, pinceau, bombe, pochoir, collage. Les sujets sont également variés, embrassant des revendications tour
à tour ethniques, politiques ou sociales.
Si le mur n’est pas vierge, le tagueur le recouvre et dénature ce qui existait avant lui. À ce titre, il est doublement incohérent. « Il vandalise celui dont il prétend être
le frère – et qu’il fait disparaître par la violence de son trait sans appel –, et il s’approprie ce contre quoi il se pique de s’insurger : la propriété. »
Entre le mur déjà signé et le tagueur revendicateur, c’est la guerre. Armé de sa bombe, il détruit ce qui la précédé. À noter que ce constat vaut aussi pour tous ceux qui gribouillent, grattent, rognent, signes et détériorent les monuments historiques et
les vestiges anciens : Colisée de Rome, Parthénon d’Athènes, pyramides d’Égypte
ou du Mexique.
Laurent Chabin clame haut et fort que le tagueur est un faussaire, voire un assassin. En choisissant de taguer une surface qui a déjà été peinte, il est de facto un voleur. L’œuvre qu’il recouvre est perdue à jamais. Même le nettoyage du mur n’en restituera rien.
L’auteur se penche d’ailleurs sur les coûts liés au nettoyage des tags. En 2021, selon
La Presse, ils s’élevaient entre 45 000 $ et 500 000 $ par arrondissement montréalais. Le coût annuel du nettoyage du métro de New York était estimé, il y a quelques années, à une cinquantaine de millions de dollars (à peu près la même somme à Paris).
Laurent Chabin est né en France et vit présentement à Montréal. Il a écrit plus de 90 romans policiers, dont une soixantaine pour les jeunes, son principal public. Parallèlement à la fiction, il est aussi traducteur et scénariste de bandes dessinées.
12 mars 2025

Sophie-Laurence Lamontagne, L’Habitant. Grandeur et misère d’un personnage méconnu. XVIIe- XXIe siècles, essai, Québec, Éditions du Septentrion, 2025, 172 pages, 39,95 $.
L’Habitant, figure identitaire des Canadiens français
Du début de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours, il y a acteur incontournable dans l’histoire
du Québec. Sophie-Laurence Lamontagne nous le présente
avec force détails dans L’Habitant. Grandeur et misère
d’un personnage méconnu.
L’autrice souligne que, à l’origine, les mots habitant et Canadien identifiaient les natifs du pays, soit les Autochtones. C’est suite à un glissement de sens effectué au cours des XVIIe et XVIIIe siècles que le mot habitant en est venu à identifier « celui qui habite sur sa terre et en vit ».
En 1703, l’explorateur Lahontan note que
les habitants sont des gens libres qui vivent « plus commodément qu’une infinité de gentilshommes en France », grâce à une nature accessible et généreuse où la faune et le bois abondent. Un esprit de liberté et une indocilité les caractérisent.
Sous le Régime britannique, le statut d’habitant se résume à celui de petit producteur sans envergure, comparé à l’occupant anglais dont les techniques et
les équipements sont plus productifs.
De nombreux témoignages d’historiens exacerbent l’image de l’habitant comme routinier soudé à ses traditions.
« Simultanément, et en opposition à cette dévalorisation, se croisent des regards bienveillants sur l’habitant, sur son travail de la terre, sur sa participation active aux milices, sur ses bonnes manières et son hospitalité. »
Au début du XVIIIe siècle, le trait caractéristique de l’habitant se loge à l’enseigne du maintien de valeurs traditionnelles et rurales. Certains historiens voient en lui le symbole de la culture authentique.
« On a ainsi recours à son image comme allégorie de la tradition, figure emblé-matique du patriote de 1837 ou encore icône de la nationalité canadienne-française. » Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l’État, le clergé et plusieurs élites intellectuelles s’en font les promoteurs.
Lors d’une conférence prononcée à Toronto en 1922 devant l’Empire Club et le Women’s Canadian Club, le premier ministre québécois Louis-Alexandre Taschereau ne cache pas son admiration de l’habitant,
« cet honnête fils du sol, sain, vigoureux et content. Plus vous venez en contact avec lui, plus vous l’observez à l’œuvre, et mieux vous appréciez le précieux actif qu’il constitue dans notre patrimoine national. »
L’habitant occupe une place de choix dans le marketing dès le début du XXe siècle.
La fabrication de soupe aux pois remonte à 1918. Sa commercialisation sous la marque Habitant en 1924 mise « sur la notion d’authenticité, concomitamment à celle de référence culturelle traditionnelle ».
Sous une autre forme de marketing, le mot Habitant identifie, à partir de 1910, l’équipe de hockey francophone, Les Canadiens. Dès les années 1940, la presse anglophone utilise l’abréviation HABS pour identifier cette équipe : « GO HABS GO devient alors pour les amateurs le slogan d’encouragement qu’on peut encore entendre aujourd’hui ».
En 1997, François Black a publié l’histoire de l’équipe de hockey Les Canadiens, de 1909
à 1960, sous le titre Habitants et Glorieux (Éditions Mille-Îles).
L’essai de Sophie-Laurence Lamontagne renferme une bibliographie sélective. L’adjectif surprend car on n’y trouve pas moins de 145 ouvrages!
3 mars 2025

Francis Juteau, Antonio Pizza, roman, Montréal, Éditions Hamac, 2025, 296 pages, 34,95 $.
Pizza all-dressed épicée
Une large all-dressed, deux grosses poutines italiennes, deux cokes,
58,20 $. Voilà ce que Karl doit livrer. Il nous livre aussi ses états d’âme et ses élans libidineux dans Antonio Pizza, roman de Francis Juteau.
La pizzeria Antonio est située à Rosemont (Montréal) et fournit du travail à plusieurs employés, dont quatre ou cinq livreurs.
La mécanique des livraisons donne lieu à des échanges tour à tour sympathiques, comiques ou stressants. L’action se déroule un vendredi-samedi-dimanche d’hiver où une neige abondante rend les déplacements parfois pénibles.
Karl, 32 ans, explique comment il a « d’abord consommé de la porno par interdiction, ensuite par excitation, puis par habitude, enfin par ennui ». Dans l’industrie du sexe, note-t-il, les bons comédiens sont rares. Ils excellent dans l’art de se mettre n’importe quoi en bouche… sauf des dialogues. « Quand on en trouve qui savent à la fois jouer et jouir, il ne faut pas les lâcher. »
Notre livreur-narrateur a une blonde prénommée Charlie qui semble capable de jouir longtemps. « Je ne parle pas juste d’orgasmer, plutôt de jouir de l’orgasme. […] Rien n’est encore terminé dans la douche alors qu’elle continue de frissonner un peu, preuve que son orgasme n’est pas qu’un moment, mais un espace à habiter aussi longtemps qu’elle désirer y rester. »
Quelque part entre le parmesan et
la mozzarella, Karl réussit à souligner comment la pizza est apolitique. Il parle
de Donald Trump qui vient à peine d’être élu (2016) et glisse que tout le monde mange de la pizza, les démocrates comme les républicains. « Aucune autre bouffe ne rassemble autant qu’elle. »
Les mots anglais et les anglicismes pullulent dans ce roman. En voici quelques exemples : « personne n’a le temps du small talk... le rush d’adrénaline kicke assez vite… Antho doit être hangover… tu trouves pas ça wrong… je rentre closer ma run… à la fin de mon chiffre ».
Le chiffre revient souvent et fait référence au quart de travail (shift en anglais qui est francisé en chiffre). Quant à closer, c’est tout simplement tiré du verbe anglais to close (fermer).
Francis conclut son roman sur le constat flagrant de son protagoniste : Karl sait accomplir à peu près toutes les tâches du quotidien… mais n’est pas tout à fait certain de savoir comment se masturber sans porno.
L’éditeur nous invite à explorer le rapport personnel entretenu avec la masturbation
et la porno-dépendance, un tabou qui constitue un pan crucial du développement sexuel de ceux et celles qui en consomment. Plusieurs scènes sont consacrées à la description de scènes tirées de vidéos pornographiques.
Je suis tenté de conclure en affirmant que
le sexe avec une blonde, les films pornographiques et la masturbation font
de ce roman une invitation à déguster
une pizza all-dressed très épicée.
Francis Juteau détient une maîtrise en littérature comparée. Il a fondé sa propre compagnie qui œuvre dans la conception et l’animation de quiz. Fasciné par les ruelles de Rosemont, Juteau s’y prend pour un chat afin d’espionner les gens dans leur cour arrière.
14 février 2025

Guy Delisle, Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge, bande dessinée, Paris, Éditions Delcourt, coll. Shampooing, 2024, 208 pages, 39,95 $.
Premier à photographier
le mouvement
Le nom d’Eadweard Muybridge
est inconnu du grand public.
Il est pourtant aussi illustre que
les frères Louis et Auguste Lumière ou encore Louis Daguerre. La bande dessinée Pour une fraction de seconde. La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge, de Guy Delisle, remet les pendules à l’heure.
Parlant de bande dessinée, on sait que
le shampoing lave la tête et fait des bulles… Il y a des bulles dans une bande dessinée, d’où le nom Shampooing pour la collection des Éditions Delcourt, cette maison française vouée aux bandes dessinées, aux comics et aux mangas.
Quant à Eadweard Muybridge, il s’agit du pseudonyme d’Edward James Muggeridge (1830-1904), un photographe britannique renommé pour ses décompositions photographiques du mouvement.
Il arrive aux États-Unis en 1855, d’abord à New York puis à Los Vegas, où il travaille comme libraire-éditeur. Il se rend ensuite en Californie où il se passionne pour un procédé technique qui en est à ses débuts, la photographie.
Guy Delisle illustre comment Eadweard Muybridge devient un des plus célèbres photographes de son époque. Bien avant Edison et les frères Lumière, Muybridge est le premier à dompter le mouvement et à projeter un film. Delisle tire le portrait d’un pionnier du cinéma, injustement oublié par l’histoire.
Edward James Muggeridge, alias Eadweard Muybridge, révolutionne la capture des mouvements invisibles à l’œil nu. Aidé par Amasa Leland Stanford, puissant homme d’affaires et politicien de la Californie,
il réussit à capturer la course d’un cheval en une série de photos, marquant ainsi l’histoire de la photo et préparant l'avènement du cinéma.
Cette bande dessinée de 200 pages relate brièvement l’histoire familiale de l’artiste/ scientifique. Le travail de recherche s’attarde plutôt à mettre à l’honneur les figures clefs proches du photographe. On voit Muybridge interagir, entre autres, avec Louis et Auguste Lumière, Georges Méliès, Louis Daguerre
et Thomas Edison, avant de devenir rapidement un des plus célèbres photo-graphes de son époque.
Le sous-titre La vie mouvementée d’Eadweard Muybridge est bien choisi car
le protagoniste demeure le premier à photographier le mouvement. Sa vie a aussi été tumultueuse puisqu’il a tué l’amant de son épouse. Le jury l’a déclaré non coupable en affirmant « nous aurions tous agi de
la même façon ».
Le critique-bédéiste français Arnault Lamy a écrit que cet album est « un mélange réussi entre le style minimaliste caractéristique de Delisle et une riche documentation. Quelques photographies d’époque ponctuent les pages, renforçant l’authenticité du récit. »
Je me rallie à Lamy lorsqu’il ajoute que « les dessins, bien que dépouillés, traduisent habilement l’effervescence de cette période et les paysages grandioses de l’Ouest américain. Les touches de couleur viennent subtilement souligner l’ambiance du XIXe siècle, tandis que la mise en page dynamique maintient l’attention. »
4 février 2025

Jules Faulkner Leroux, Qui suis-je où vais-je, nouvelles, Ottawa, Éditions L’Interligne, coll. Vertiges, 2024, 112 pages, 22,95 $.
Raconter son propre chemin, une lettre à la fois
Après avoir publié quelques textes dans des journaux, Jules Faulkner Leroux se livre à des questionne-ments universels dans Qui suis-je où vais-je, douze nouvelles qui peuvent être lues séparément.
C’est son premier livre.
Qui suis-je où vais-je, sans point d’interrogation car qui peut avoir la prétention de savoir avec certitude ?
On devine néanmoins que ce recueil renferme des textes bien ancrés sur terre
et dans le souvenir de l’enfance.
Dans une nouvelle, une personne commande un poke bowl au saumon et thon épicés d’un restaurant chinois qui inclut toujours un biscuit avec message.
La lecture se fait seulement après avoir mangé les deux moitiés : « Cessez de vous raconter des histoires. Tracez la vôtre. »
Et voilà que Jules Faulkner Leroux nous livre douze histoires où il se révèle, où il
se manifeste.
Une histoire met en scène deux amis,
Adam et Eliott. Ils passent tout le primaire ensemble, main dans la main. Au secondaire, Elliot devient joueur de football, quarter-back, l’équivalent de « cool, très cool ».
Quand Adam et Elliot débarquent de l’autobus les ramenant sur la Rive-Sud,
le premier voit bien que le second a envie de lui tenir la main. « Mais il était rendu beaucoup trop grand pour ça, et moi aussi. » Plus tard, Adam apprendra qu’Elliot rêvait de l’embrasser.
Ailleurs, l’auteur se met lui-même en
scène avec ses amis Marc-O, Ric et Fred.
Le quatuor se retrouve d’abord au Caffè San Marco, puis Chez Johannes, « à l’abri de
la course folle de la vie, du travail éreintant, des enfants criants ». Ces quatre amis sont comme dans un parc à chiens où les bêtes sont trop heureuses de se retrouver.
Dans la vie, Jules Faulkner Leroux est facteur. Une nouvelle s’intitule « Un homme de lettres » (joli jeu de mot) et raconte
le parcours d’un facteur sur une route qu’aucun autre employé n’avait voulue.
Ce sera un emploi « qui m’avait guéri de beaucoup de mots » (autre joli jeu de mot).
La nouvelle « Je brûle de toutes façons » remet en question l’idée que le mariage et la famille sont le sacre du bonheur. L’auteur n’hésite pas à y voir un carcan étroit, prévisible et ennuyeux. Le statut d’une femme passe d’amante à amoureuse, puis de femme à conjointe, pour devenir une simple partenaire.
« Il me fait plaisir de te revoir » est la plus longue nouvelle, presque vingt pages. L’action se déroule dans le quartier Bois-Franc, arrondissement de Ville-Saint-Laurent, à Montréal. Y résident des associés dans des boîtes d’avocats, de comptables
ou de marketing, des directeurs de firmes d’investissement et des hauts fonctionnaires.
Ils habitent les mêmes demeures, conduisent les mêmes bagnoles, s’habillent de la même façon, consomment les mêmes alcools, s’évadent dans les mêmes paradis. Vous voyez le portrait. Sauf que Jules Faulkner Leroux entend bien le faire éclater…
En empruntant le chemin qui lui ressemble, Jules Faulkner Leroux ne ressens plus
le besoin de raconter celui des autres.
« Je me contente d’écrire le mien, mon chemin, une lettre à la fois. Car ce n’est
pas le but qui compte, c’est le chemin. »
25 janvier 2025

Claire Ménard-Roussy, Un lourd prix à payer, roman, Ottawa, Éditions David,
coll. Voix narratives, 2024, 248 pages, 25,95 $.
Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs familles néerlandaises s’installent au Canada pour réaliser leur rêve dans ce pays van milk en honig (de lait et de miel), mais tout n’est pas gagné. Claire Ménard-Roussy décrit un cas tragique dans le roman Un lourd prix à payer.
Plusieurs romans ont situé l’action dans des villes ontariennes comme Ottawa, Sudbury, Toronto ou Windsor. De plus petites communautés y figurent aussi, notamment Hearst, Mattawa, Rockland ou Penetangui-shene. Claire Ménard-Roussy a choisi
un endroit peu connu, soit le canton de Glengarry, à l’est de Cornwall.
Le couple Frans et Hannah Dykstra quitte les Pays-Bas avec leurs enfants Margriet, Pieter et Adriaan pour s’installer au Canada en 1956, « à la sortie d’un petit village paisible » dont le nom n’est jamais mentionné. On sait que ce hameau est traversé par la rivière Noire. « C’est su’a County Road 17, c’est le ch’min qui mène à Williamstown, ça. »
Margriet a 12 ans et fréquente une école catholique de langue française dirigée
par des religieuses. Sa mère ne parle que
le néerlandais; son père se débrouille
un peu en anglais et baragouine quelques mots en français. La famille vit assez bien des produits de la ferme.
Les Dykstra vont à la messe tous
les dimanches, mais les voisins ne connaissent absolument rien de leur vie antérieure. « C’était encore des étrangers après tout, des gens venus de l’autre bord, avec des manières différentes, puis
une langue qui ressemblait pas mal trop
à l’allemand. »
Quand Claire Ménard-Roussy a décrit le « Social de la Paroisse » et la contribution de Hannah au souper communautaire, cela m’a rappelé les pique-niques paroissiaux de mon enfance à Saint-Joachim, dans le sud-ouest ontarien : kiosques, roue de fortune, lancement de fléchettes, peluches à gagner, repas copieux.
Le samedi 19 septembre 1959, Margriet disparaît. La police n’en est informée que
le lundi suivant. Les recherches pour la trouver s’avère infructueuse. Lors de l’enquête menée par l’Ontario Provincial Police, un homme affirme avoir vu Margriet et son père sur le bord de la rivière Noire, précisant que Frans Dykstra semblait très mécontent.
Quelques jours plus tard, l’agent se rend chez le père et prend une voix grave : « Mister Frans Dykstra, you are now under arrest and charged with the disappearance of your daughter… » Les cinq lignes et demie de l’accusation sont écrites en anglais seulement (pas de traduction en bas de page).
Parlant de langue, certaines répliques illustrent le parler populaire français; en voici un exemple : « Y para’ que la p’tite fille alla’ assez souvent au bord de la rivière en face de leu’ farme. À s’é p’t-êt’ noyée,
on sé jama’. Y disent qu’à sava’ pas nager. »
Le roman est truffé de quelques mots néerlandais. Le curé est appelé vader (père), les sabots de bois sont des klompen, la chaleur du foyer est le gezellling d’une maison accueillante. Une réplique de trois lignes figure en néerlandais, avec traduction dans une note en bas de page.
Le village entier est ébranlé et des vies
sont changées par les événements qui s’y déroulent en septembre 1959. La romancière tisse habilement psychologie et criminlogie; résultat : son roman se transforme peu à peu en un véritable thriller.
Claire Ménard-Roussy a effectué
une recherche minutieuse sur l’agriculture dans Glengarry, sur la vie dans les Pays-
Bas pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur la participation
des troupes canadiennes à la libération de la population néerlandaise.
13 janvier 2025

Georges Simenon, L’Affaire Saint Fiacre et
28 autres enquêtes de Maigret, nouvelles, Paris, Éditions France Loisirs, 2014,
1,056 pages.
Maigret, sa pipe et
une bouffée de poésie
La grève de Postes Canada ayant retardé l’envoi de nouveaux livres,
je vous présente un classique de
la littérature policière, soit L’Affaire Saint Fiacre et 28 autres enquêtes
de Maigret, figure emblématique
de l’œuvre du renommé Georges Simenon. Elles ont été rédigées entre 1936 et 1950, dont trois au Canada.
Georges Simenon est né le 13 février 1903 à Liège (Belgique) et décédé le 4 septembre 1989 à Lausanne (Suisse). Son œuvre est monumentale : 192 romans, 158 nouvelles, plusieurs textes autobiographiques et de nombreux articles et reportages publiés sous son propre nom, sans oublier 176 romans, des dizaines de nouvelles, contes galants et articles parus sous quinze pseudonymes. Les Éditions France Loisirs ont choisi de présenter 29 de ses textes
les plus emblématiques.
Simenon excelle dans l’art de raconter une histoire forte, avec un début, un milieu et une fin. Un crime est commis et le gros policier bourru Jules Maigret entre en action, pipe entre les dents, pour dénouer les fils de l’énigme. Pas je jolies phrases, pas de leçon de morale, pas de philosophie, juste une enquête, une nouvelle marquée par un art fulgurant.
Certaines enquêtes sont présentées par
des critiques littéraires. Au sujet de « Mademoiselle Berthe et son amant »,
on souligne que nous allons apprécier
le rythme, l’allégresse, l’humour et, bien entendu, le suspense.
« L’Affaire Saint-Fiacre » est la première nouvelle et la plus longue (120 pages). Patrick Poivre d’Arvor la présente et note qu’elle a été adaptée en 1959 par Jean Delannoy, avec Jean Gabin dans le rôle de Maigret. Il y voit une puissante réflexion
sur la misère et la solitude des hommes.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Simenon séjourne au Canada. « Témoignage de l’enfant de chœur » est écrit le 28 avril 1946 à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec). Pour ce texte,
il est précisé que le jeune Georges Simenon du début du siècle s’invite dans l’énigme que le puissant commissaire Maigret est en train de résoudre. « L’enfant espiègle tire
les ficelles et tend les ressorts qui font bouger le policier. »
L’enquête intitulée « Le Client le plus obstiné du monde » est aussi rédigée à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, le 2 mai 1946. L’histoire se passe à Paris et, dans
les annales de la police, jamais un suspect n’a mis autant d’acharnement ou de coquetterie à se montrer sous toutes ses faces, à attirer l’attention de dizaines de personnes, tout en projetant « l’image
la plus imprécise, la plus floue qu’il soit possible d’imaginer ».
Quant à la nouvelle « On ne tue pas
les pauvres types », Simenon l’écrit à Saint Andrews (N.-B.) le 15 août 1946. La victime est un homme quelconque dont la vie semble effacée. L’enquête va révéler que ce pauvre type était un peu moins simple
qu’il ne le semblait, un peu moins pauvre qu’il n’y paraissait.
On ne sait pas grand-chose de l’épouse
de Jules Maigret. Elle demeure de source sûre une excellente cuisinière. Dans « L’Amoureux de Mme Maigret », l’épouse mène l’enquête avec autant de sagacité que le mari… qui ne supporte pas de la voir marcher sur ses plates-bandes avec autant de talent que lui.
Dans sa présentation de L’Affaire Saint-Fiacre et 28 autres enquêtes de Maigret, Gilles Lapouge conclut que la grandeur d’une nouvelle de Simenon n’est pas la complexité ou la simplicité de ses intrigues. « C’est ce qu’on appelle communément
son atmosphère et que je préfère nommer sa poésie. »
2 janvier 2025

Serge Chapleau, Chapleau 2024, caricatures, Montréal, Les Éditions de La Presse, 2024, 120 pages, 29,95 $.
Caricatures politiques
de Chapleau
Pour la 31e fois, Serge Chapleau présente sa revue annuelle en caricatures. Pas un événement ayant marqué l’année n’échappe à son œil aiguisé dans Chapleau 2024.
C’est la scène politique municipale, provinciale, fédérale et internationale qui retient surtout son attention.
Constitué de plus d’une centaine de caricatures, l’album promet de faire rire autant que réfléchir. « Dans ce grand étal de marché qu’est la politique, il n’est pas toujours évident de trouver les ingrédients pour cuisiner un plat réconfortant, nutritif et rassasiant », écrit-il en guise d’introduction, ajoutant qu’« à défaut de trouver de quoi mitonner un bon potage, il y aura assuré-ment tout le nécessaire pour préparer
une excellente farce. »
La politique québécoise occupe le haut du pavé dans cette rétrospective (environ 50 pages sur 120). Je sais bien que Chapleau est la caricaturiste de La Presse depuis 1996, mais ce n’est pas une raison pour laisser
les autres provinces briller par leur absence.
Sur la centaine de caricatures québécoises, je n’en retiens qu’une seule. Lorsque le ministre Éric Girard est prêt pour présenter son budget, il n’a pas besoin de nouveaux souliers; il porte plutôt des patins pour « pelleter par en avant », expression qui, au sens figuré, « fait référence à quelqu’un qui déplace plus loin devant lui une quantité de problèmes qui augmentent au fur et à mesure qu’il progresse ».
Au niveau fédéral, Justin Trudeau se présente à la caisse d’une épicerie et on lui dit que la date de péremption est passée. « Pour mon yogourt? », demande-t-il. « Non, pour vous! » Quant au chef conservateur Pierre Poilievre, il hésite pour sa tenue du jour entre trois t-shirts :
« C’est la faute à Justin Trudeau. C’est
la faute à Valérie Plante. C’est la faute à Bruno Marchand. »
Du côté de la politique américaine et internationale, on voit Biden dans le bureau ovale où il téléphone à Netanyahou.
Il obtient ce message enregistré : « Il n’y a pas de service au numéro composé! »
Pour les Jeux olympiques de Paris, on voit Trudeau se présenter pour le relais 4 x 100 mètres. L’arbitre lui dit : « Hum!? Il ne reste que vous… et la course était hier! »
Quant au pape François, fort bien illustré,
il accuse Trump et Harris d’être « contre
la vie ». On le voit coiffé d’une casquette rouge arborant MAKE VATICAN GREAT AGAIN.
Diplômé de l’École des beaux-arts, Serge Chapleau a fait ses débuts comme caricaturiste professionnel au magazine Perspectives en 1971, puis il a travaillé au quotidien Le Devoir pendant cinq ans. Il est, depuis avril 1996, caricaturiste au quotidien La Presse.
Chapleau a remporté à plusieurs reprises
le prestigieux prix du Concours canadien
de journalisme. Il a publié en 2020 le livre Chapleau : depuis mes débuts consacré à
ses 50 ans de carrière.
22 décembre 2024

Kevins-Kyle et Joanie Godin, Seul son coiffeur le sait, roman autobiographique, Montréal, A éditeur, 2024, 272 pages, 26,95 $.
Mise en pli d’une histoire romantique
J’ai déjà eu un amant qui est coiffeur, ce qui m’a bien disposé à lire Seul son coiffeur le sait, de Kevins-Kyle et Joanie Godin. Quand le protagoniste n’est pas absorbé par sa quête amoureuse, il grimpe les échelons
du monde de la coiffure, faisant
des rencontres tantôt drôles, tantôt bouleversantes.
La première page nous indique que toutes les histoires et les personnages de ce roman ont véritablement existé. On y précise que les noms ont été changés et que le récit a été romancé. Seul son coiffeur le sait est
un livre librement inspiré de la vie du coauteur Kevins-Kyle.
Le coiffeur se prénomme Kevins-Kyle.
Le gars de tous les jours s’appelle Kevin. Lorsqu’il est tannant dans les bars, il est
tout simplement Kyle. Allons-y pour Kev.
Ce jeune homme qui quitte son Lac-Saint-Jean natal pour s’établir à Montréal poursuit deux objectifs : « devenir coiffeur et surtout trouver l’homme de ma vie » (avec qui il souhaite avoir des enfants).
Kev réussit à trouver un emploi dans
un salon de coiffure renommé. C’est là qu’il en apprend un peu plus sur son métier, passablement sur autrui et énormément
sur lui-même.
En parlant du showbiz, René Angélil aimait dire que la personnalité y est pour environ 80% dans la réussite et que le talent ne compte que pour 20%. C’est exactement
la même chose en coiffure.
Une douzaine de chapitres portent le nom d’une cliente du coiffeur : Christine, Manon, Magalie, Sophie, Alix, Jennifer, Juliette, Carole, Geneviève, Kimi, Karine, Florence, Abigaëlle. On y décrit presque toujours un désastre dans la coupe ou la teinture. Kevins-Kyle réussit presque toujours à sauver la mise (en pli).
Parmi ses nombreuses fréquentations,
Kev rencontre un policier qui ne cherche rien de sérieux, surtout rien d’amoureux.
Il ne se dit même pas gay. « Pour un gars qui qui jure qu’il n’est pas homosexuel,
il est plutôt doué au lit avec les hommes.
Il distribue les orgasmes à un rythme plus effréné que les contraventions dans
une trappe à tickets. »
Kev s’éprend facilement d’un beau mec.
Il a tendance à ignorer les drapeaux rouges et à mettre la majorité de ses œufs dans
le même panier. Après plusieurs échecs,
Kev rencontre finalement l’homme avec qui il veut avoir un enfant.
Antonio est né dans une famille italienne
où « les aînés ont priorité et on leur doit
le respect absolu ». Or, voici qu’une vielle tante abuse de son pouvoir et traîne Kev dans la boue. Personne ne prend sa défense, même pas Antonio.
Après des paroles blessantes, Kev apostrophe sans détour cette tante bigote : « Estime-toi heureuse de ne pas avoir dit ça à propos
de ma mère parce que c’est mon poing sur la gueule que tu aurais reçu. » Les choses ne peuvent que s’améliorer après cette sortie!
Tout comme Kev, Antonio veut devenir papa. Commence alors un long processus pour vérifier la fertilité et l’un et l’autre, pour trouver une mère-porteuse (à Toronto), pour faire don de sperme, pour passer à
la fertilisation, pour enfanter en surmontant d’incroyables embûches.
Dans ce roman autobiographique,
nous tentons de démêler le vrai du faux. Nous passons de moments très drôles à d’autres plus touchants, avec tout ce qu’il y a entre les deux.
11 décembre 2024
